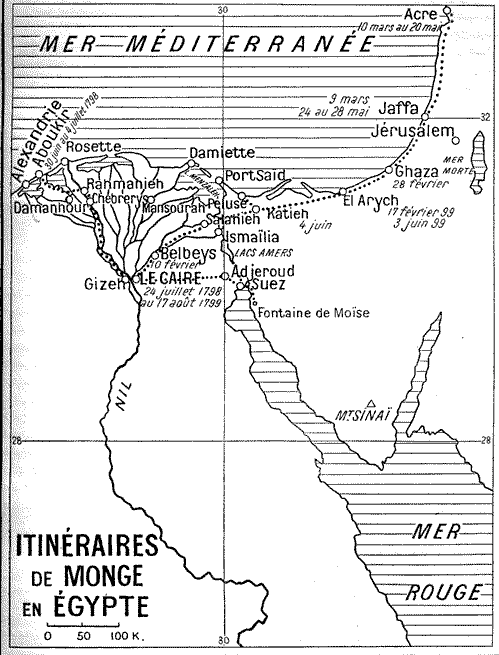
| Chapitre précédent | Table des matières | Chapitre suivant |
Publié par EDITIONS PIERRE ROGER, Paris
Le débarquement. — La bataille de Chebrérys. — L'Institut d'Egypte. — L'excursion aux Pyramides. — La révolte du Caire. — Le canal de Suez. — L'expédition de Syrie. — Le retour.
L'histoire officielle de la campagne d'Egypte est assez connue pour qu'il n'y ait pas lieu de la reprendre, malgré tout l'attrait poétique et pittoresque de cette prestigieuse aventure. Il nous suffira d'indiquer la part prise par Monge dans l'expédition, en essayant d'en reconstituer la physionomie telle qu'elle put apparaître à ses yeux. Sur ce point, les documents abondent. Ce sont, outre les lettres de Monge à sa femme constituant un véritable journal (malheureusement tronqué pendant plusieurs mois [L'Intermédiaire des chercheurs et des curieux à la date du 20 août 1897, n° 771, a signalé un fragment de 4 pages de cette correspondance passé en vente publique]), les souvenirs de Jomard, d'Arnault, de Bourrienne, de Savari, les lettres de Dolomieu, Geoffroy Saint-Hilaire, Cordier, général Morand, etc., les correspondances interceptées par les Anglais et publiées par eux, la Description de l'Egypte [1 vol. in-fol. de texte et 12 vol. in-fol. de 890 planches (1803-1828)], l'Histoire de l'expédition française en Egypte [10 vol. in-8 et 2 vol. de planches (1830-1836)], L'Armée de Bonaparte en Egypte par le commandant Guitry [Flammarion, petit in-4], les Observations sur l'expédition du général Bonaparte en Egypte [1 vol. in-8, an VII, traduit de l'anglais par André], etc., etc.
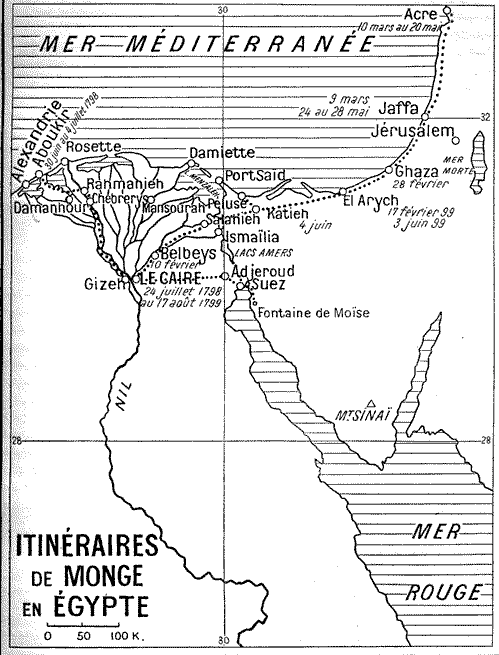
Nous sommes au 26 mai 1798. Représentons-nous le petit port de Civita Vecchia au moment du départ pour l'Egypte et l'état d'esprit de Monge ou de ses compagnons. Bonaparte a envoyé de Toulon le signal attendu et fixé le rendez-vous avec lui aux Bouches de Bonifacio. Le beau rêve de ces argonautes, de ces croisés, de ces conquistadores va se réaliser ; le plus extraordinaire, le plus inutile et, par là même, le plus romanesque prodige de notre temps : toute une armée française s'élançant à l'autre bout de la Méditerranée et peut-être plus loin encore vers l'Inde, en dépit de la flotte anglaise qui peut lui barrer la route demain, qui presque certainement arrêtera son retour ; la plus superbe folie qu'ait tentée un jeune conquérant ou inventeur de nouveau monde depuis Alexandre ou Christophe Colomb ! [Officiellement tourné en dérision par les Anglais, ce projet ne laissait pas de les inquiéter, comme le montrent les Observations sur l'expédition du général Bonaparte, publiées à Londres en 1799, après la défaite d'Aboukir, où, malgré l'événement, on polémique encore sur la possibilité de l'expédition, en envisageant la répercussion sur la Compagnie des Indes].
Bonaparte a annoncé qu'il partait le 19 mai de Toulon; une semaine s'est passée ; dans ce petit port italien, la flotte de Desaix attend pour s'élancer que le vent veuille bien tourner et permettre de franchir la passe. On suppose le grand convoi en avant [Un ouragan qui se déchaîna dans la nuit du 18 mai força Nelson à regagner les îles Saint-Pierre pour y réparer ses avaries et l'empêcha de surveiller le départ du convoi qu'il poursuivit ensuite vainement]. Mais, sur ces mers sans télégraphe, amis ou ennemis s'ignorent. Avec des navires à voiles, pauvres prisonniers des brises, on ne peut prédire ses étapes. Tout cela ne ressemble guère à la facilité banale d'un transport moderne. Le convoi qui doit emporter Monge avec Desaix s'en aperçoit avant même de quitter le port. Le vent serait favorable en pleine mer ; il ne permet pas de sortir. On est embarqué et immobile. Il y a là des bâtiments de transport de toutes les nations. Pour les recruter, on a mis l'embargo, sans distinction de nationalité, sur tous les navires marchands, turcs, algériens, grecs, suédois, hollandais, etc., qui ont commis l'imprudence de se présenter sur la partie de la côte italienne occupée par les troupes françaises. Autour de la frégate la Courageuse [La Courageuse, capitaine Eydoux, est mentionnée comme portant trente-six canons, et l'Artémise quarante. Mais l'Artémise était seule armée ; Exp. Egypte, III, 71], qui porte Monge et Desaix, installés chacun dans une belle chambre damassée, s'agitent un brick, un chebek, deux galères, trois chaloupes canonnières et une masse imposante de quatre-vingts transports.
Enfin, le soir du 26, toutes les chaloupes des navires de l'expédition arrivent pour remorquer la Courageuse et l'on sort du port. La mer est calme, le vent maintenant propice. Les voiles tendues courent sur la mer ! On est tout à la joie, à l'espérance, confiant dans l'étoile de Bonaparte, oublieux ou insouciant de l'évident péril ! Le convoi se serre comme un troupeau de moutons, sous lèvent de la frégate.
Le 3o mai au soir, grosse alerte sur la Courageuse. Le boulanger a commis l'imprudence d'accumuler du bois dans son four pour préparer la cuisson du lendemain. Le bois se carbonise et commence à prendre feu. L'entrepont se remplit de fumée. L'incendie est menaçant. On ferme toutes les issues. On fait avec une tarière plusieurs trous pénétrant jusqu'au four que l'on inonde ainsi d'eau, on le démolit, on est sauvé !
Dans la nuit du 31 mai au 1er juin, fausse manœuvre que Monge raconte avec navrement. Bonaparte, retardé, a envoyé l'Artémise à la rencontre de Desaix, et le convoi de Desaix, dirigé par l'Artémise, a cherché le grand convoi toute une nuit. Puis, un capitaine, moins discipliné qu'entreprenant, a pris sur lui de conduire la petite flotte de Civita-Vecchia droit sur la pointe ouest de la Sicile et sur Malte, alors que Bonaparte, d'après les ordres donnés, perd des journées à l'attendre ailleurs. Monge ne comprend rien à ces manœuvres et se désole à la pensée du temps perdu qui va les faire arriver au bal quand les lampions seront éteints :
« La frégate l'Artémise est venue hier soir nous faire virer de bord, afin, disait-elle, de nous rallier à la grande flotte. Elle nous a fait courir toute la nuit au nord et nous n'avons rallié que quelques bâtiments écartés de la grande flotte ; en sorte qu'à midi, aujourd'hui, nous étions au même point où nous étions hier. Si beaucoup de gens comme ceux-là se mêlent de nos affaires, je ne sais quand nous arriverons [La flotte de Bonaparte avait rallié en route les divers convois attendus, sauf celui de Civita-Vecchia, qui aurait dû se trouver aux Bouches de Bonifacio. C'est alors que l'amiral envoya l'Artémise à sa recherche et que le capitaine de l'Artèmise prit sur lui de modifier les ordres reçus : d'où fureur justifiée de Bonaparte. (Souvenirs d'ARNAULT, tome IV, 88, 115)]. Depuis les huit heures du matin, nous sommes au calme plat. Les vaisseaux n'éprouvent pas le plus petit souffle de vent. Ils sont tous là au hasard, sans aucune direction. Il fait d'ailleurs le plus beau temps du monde. Les canots sont en mer et l'on va se faire visite comme dans Venise... Quant à moi, je suis très heureux. On m'a fait une belle chambre, comme au général Desaix. Elles sont l'une et l'autre tapissées de damas cramoisi ; elles ont chacune une fenêtre sur le vaisseau et sur la mer... »
Le 2 juin, on dépasse la pointe sud-est de la Sardaigne, le temps reste beau et sans brise. Mais, pendant la nuit suivante, le vent s'élève. La frégate, obligée d'attendre son convoi, ne porte que peu de voiles et danse. Monge constate qu'il a le pied marin, mais peste contre ce qu'il appelle la nuit de Pénélope où l'Artémise les a ramenés en arrière : « Nous trouverons besogne, faite quand nous arriverons, et l'on nous dira: « Pends-toi, Crillon ! »
Le 4 juin, on double l'île de Marittimo pour enfiler la passe entre cette île et la Sicile : « Tout l'équipage est fort gai ; nous venons de chanter en chœur tous les hymnes de la Révolution... » Puis, on passe en vue de Mazzara, on longe Pantellaria et l'on se dirige sur Malte, toujours ralenti par la nécessité d'attendre les traînards. En pareil cas, sur la mer bleue semée de voiles, on recommence à se visiter; on s'invite à déjeuner et à dîner...
Le 6 juin au soir, voici Malte. Mais, au lieu prévu du rendez-vous, pas une chaloupe! Que s'est-il passé? On s'inquiète : « La Grande Armée, qui aura vraisemblablement pris plus au midi que nous, aura-t-elle rencontré la flotte anglaise et aura-t-elle été obligée de livrer combat? Que ferons-nous si elle a été battue ? » [Bonaparte avait longé lentement la côte est de la Sardaigne, puis était resté quatre jours devant Cagliaci, en envoyant des avisos chercher le convoi de Civita-Vecchia. (Expéd. d'Egypte, III, 61.)]
Les heures se passent. Toujours rien ! Le 7 juin, arrive un petit bâtiment qui s'est trouvé séparé de la grande flotte depuis le 1er juin et qui n'en a plus de nouvelles. On reste en panne à deux lieues de la ville, prêt à se réfugier vers Syracuse si l'on apprend un désastre. Le souci grandit; car, n'ayant qu'une frégate armée en guerre, on n'est pas en état de se défendre contre un seul vaisseau de ligne. Toutes les lunettes sont braquées sur Malte : « Nous distinguons les batteries. Il y en a partout et, dans quelques endroits, quatre au-dessus les unes des autres. » Puis, dans l'après-midi, fausse joie en apercevant au loin une vingtaine de voiles, parmi lesquelles quelques bâtiments de guerre. On ne doute pas que ce ne soit l'avant-garde de Bonaparte. Hélas ! ce sont des navires maltais qui rentrent d'une chasse aux barbaresques !
Le 8 juin, la mer reste vide jusqu'à l'horizon. On commence à trembler pour le succès de l'expédition. Enfin, le 9 juin, Monge écrit à cinq heures du matin, avec l'exaltation du Cid racontant l'arrivée des Maures au soleil levant :
« Les vigies nous ont d'abord annoncé trois bâtiments, puis cinq, puis douze et, à mesure que les gabiers ont monté plus haut, ils en ont découvert davantage. Leur manière d'exprimer la chose est de dire que les bâtiments sont nombreux comme les cheveux de la tête. La joie est sur la frégate. Les mâts sont couverts de monde. C'est à qui montera le plus haut. Il ne reste plus personne sur le pont... L'escadre vient vent arrière... »
Mais nouveau tracas pendant plus de deux heures. Sur les deux flottes françaises, on se demande maintenant si l'autre escadre ne serait pas anglaise et on se prépare au combat. Non, on se reconnaît, on se parle ! C'est bien Bonaparte avec ses trois cents voiles, ses treize vaisseaux armés et ses trente-six mille hommes. Desaix fait venir une demi-galère; il y descend avec Monge vers cinq heures du soir et tous deux vont voir Bonaparte à bord de l'Orient. Juste le temps de s'embrasser et d'échanger quelques paroles ! Aussitôt une opération militaire sur Malte est ordonnée pour la nuit. Monge n'y prend pas part. Attentif et se rappelant la promesse faite à Mme Monge, Bonaparte installe le savant et le fait rester sur son propre navire : « Je couche, écrit Monge, dans la chambre de l'amiral. J'ai vu Berthollet qui m'a remis de tes lettres. Le général m'en a remis d'autres... Ce vaisseau est un monde... J'y ai trouvé Dufalga [Le général Caffarelli du Falga (1756-1799), que Monge appelle toujours Dufalga, avait eu la jambe gauche emportée par un boulet en 1795. Les soldats l'appelaient « jambe de bois » et prétendaient qu'il avait toujours « un pied en France ». Il mourut à Saint-Jean-d'Acre], Say, Léory l'ingénieur, le capitaine Casablanca et une foule de connaissances. Il me semblait, quand j'y ai mis le pied, que j'entrais en France. »
Alors, le matin du 10 juin, Bonaparte débarque d'un côté, Desaix de l'autre avec les troupes de Civita-Vecchia. La ville, sans défense, est rapidement cernée et prise, mais non la citadelle. « Nous n'avons pas eu un blessé, raconte Monge. Il n'y a que le général Dufalga qui, en marchant à pied dans les chemins raboteux de l'île, a cassé deux fois sa jambe de bois. Quant à nous autres, gens de l'Institut, nous sommes restés à bord, suivant avec notre lunette tous les mouvements de notre monde et tremblant à chaque décharge que nous voyions faire sur les républicains... Nous voilà donc accrochés devant Malte. Dieu sait quand nous en sortirons. Si les chevaliers avaient le peuple pour eux, et s'ils avaient le courage qu'a si bien peint l'abbé de Vertot, je ne sais pas quand nous en serions quittes. »
On voit que, dans l'entourage de Bonaparte, on ne comptait pas alors sur la facilité extrême avec laquelle fut enlevée cette place, « la plus forte du monde », et que nos officiers, après avoir pu l'examiner de près, déclaraient d'abord imprenable. Mais la révolte des habitants révolutionnaires, l'imprévu de l'attaque, les dissensions politiques entre les chevaliers, des faiblesses probablement préparées [Pendant que Bonaparte était à Passariano, il envoyait des agents à Malte (Poussielgue) et faisait saisir les propriétés des Chevaliers en Italie. Quelques mots sont significatifs, surtout celui cité par Bourrienne : « Malte est à vendre », ou encore celui de Caffarelli à Malte: « Nous sommes bien heureux qu'il y ait eu dans la ville quelqu'un pour nous en ouvrir les portes. » Les Anglais ont insisté sur l'accusation de vénalité contre le Grand Maître Hompesch. Ils sont experts en cette matière, ayant l'habitude très judicieuse de faire donner la « Cavalerie de Saint-Georges »], amenèrent la capitulation qui eut lieu dans la nuit du 11 au 12 juin. J'ai raconté ailleurs quel avait été en cette affaire le rôle de Dolomieu [Revue des Deux-Mondes, 1er aout 1925, p. 582], ancien chevalier de Malte, chargé par Bonaparte de négocier la capitulation avec le grand maître Hompesch : ce qui devait lui valoir, au retour d'Egypte, un an de dure captivité à Naples.
Quand Malte eut été rendu, l'enthousiasme fut général [Voir la lettre du Directoire exécutif au Conseil des Cinq-Cents et au Conseil des Anciens, insistant sur les griefs de la France contre l'ordre de Malte, dont le principal était d'avoir donné asile à des émigrés. (Arch. nat., AFIII, 3481-90)]. Il semblait désormais que la conquête de l'Egypte ne dût plus rencontrer de difficultés. Bonaparte avait distribué de l'avancement à tous ses officiers. Chacun faisait des rêves, dont une plaisanterie adressée par Monge à sa femme montrera les proportions : « Dieu sait si, après avoir enlevé la Madone de Lorette, je ne serai pas aussi chargé d'enlever le tombeau de Mahomet à La Mecque. » Quant aux soldats, ils avaient trouvé du vin à foison et s'étaient, pour la plupart, si bien grisés que les habitants, après leur avoir chaleureusement livré la ville, n'osaient plus sortir de leurs maisons.
Bonaparte, aussitôt établi dans le palais du Grand Maître, y donna un dîner, tandis que tout Malte était illuminé de lanternes vénitiennes. Puis, avec sa netteté de décision habituelle, il s'occupa rapidement d'organiser l'administration de l'île. Monge et Berthollet eurent à recueillir, dans le trésor de l'église Saint-Jean et l'Hôpital, tout ce qu'il pouvait y avoir d'argenterie. On en chargea sur la Courageuse pour environ 800000 livres.
Et, le 18 juin, toute cette extraordinaire ville flottante se remit en route vers le pays des Mille et une Nuits, dominée par l'Orient comme par une cathédrale. Le temps était beau, la mer favorable. Sur l'Orient, que Monge habitait maintenant, la vie s'était organisée comme dans une ville d'eaux de deux mille âmes, réglementée et dirigée par la ferme volonté de Bonaparte.
Après le premier succès si simple de Malte, personne ne doutait plus de rien et seul peut-être l'amiral Brueys, sentant sa responsabilité, pensait à la flotte de Nelson qui pouvait attaquer le convoi et qui l'aurait trouvé incapable de se défendre. Bonaparte, souvent tourmenté par le mal de mer, restait volontiers dans sa chambre à écouter les lectures de Bourrienne ; ou bien, se promenant sur la galerie, il causait et faisait causer. Les conversations de Passariano avaient repris avec les loisirs d'une longue inaction. Le général, cherchant toujours à s'instruire, mettait chacun sur sa spécialité : Brueys sur les manœuvres maritimes, Monge et Berthollet sur la science, Arnault sur la poésie. Ou lui-même se laissait entraîner à des réminiscences historiques sur l'Egypte, la Crète, la Sicile. De même, le soir, avec les convives de choix qu'il retenait à sa table.
Amoureux qu'il était de l'ordre et de la méthode, il avait décidé que, pour ne pas laisser la conversation s'égarer, on devrait, dans ces causeries du soir, se restreindre à un sujet indiqué par lui le matin ainsi qu'un mot d'ordre. C'est un goût qu'il garda plus tard à Saint-Cloud et aux Tuileries. Dans son salon, la conversation était dirigée comme chez une bas bleu parisienne de la troisième République. On discutait, par exemple : « Les planètes sont-elles habitées ? Quel est l'âge du monde ? Est-il probable que le monde éprouvera quelque nouvelle catastrophe par l'eau ou par le feu? » Et c'était alors à Monge de parler. Ou encore : « Qu'y a-t-il de vrai dans l'interprétation des rêves? », etc. Bourrienne et Arnault, deux compagnons de voyage, ont remarqué à ce propos que Bonaparte témoignait une préférence très vive pour Monge, à qui les militaires, généralement hostiles aux savants, épargnaient un peu leurs mauvais procédés.
Parmi les qualités auxquelles ils attribuent cette sympathie, Bourrienne en cite une qui ne laisse pas de nous surprendre un peu, après avoir été initiés à la violente passion anticléricale de notre jacobin : c'est sa religiosité. « Monge, dit-il, doué d'une imagination ardente, sans avoir précisément des principes religieux, avait une espèce de propension vers les idées religieuses qui s'harmonisait avec les idées de Bonaparte. A ce sujet, ajoute-t-il, Berthollet, l'inséparable de Monge, se moquait quelquefois de lui ; et d'ailleurs, l'imagination froide de Berthollet, son esprit constamment tourné à l'analyse et aux abstractions, penchaient vers un matérialisme qui a souverainement déplu au général... Bonaparte, complète-t-il ailleurs, aimait beaucoup à parler de religion. Je me rappelle qu'un soir, étant sur le pont de l'Orient, par un temps magnifique, entouré de quelques personnes qui discutaient..., Bonaparte, élevant sa main vers le ciel et montrant les astres, leur dit: « Vous avez beau dire, Messieurs, qui a fait tout cela? »
Ces deux hommes si constamment associés, Monge et Berthollet, offraient, en effet, une différence marquée qui se décèle aussitôt sur leurs portraits conservés et mis en pendant par les descendants de Monge. Monge, au repos, apparaît un peu rude, un peu négligé, un peu plébéien, mais avec cette bonté foncière que commencent par signaler chez lui tous les contemporains, même les plus hostiles, et avec cet idéalisme dont sa foi républicaine était la première incarnation. Berthollet, pincé dans son habit de velours blanc à revers rouges, les lèvres sensuelles, les petits yeux clignotants, regarde gravement, d'un air plus sceptique, et on le sent beaucoup plus disposé à d'avantageux réalismes. Dès lors, — la réflexion de Bourrienne le montre, — Bonaparte, qui démêlait avec une grande finesse les hommes en qui il pouvait se fier (sauf à épargner les autres par fatalisme ou par indulgence), semblait pressentir que Berthollet, fait par lui comte et sénateur, le trahirait à la Restauration, et c'est pourquoi sa faveur pour Berthollet, quoiqu'il en ait donné d'abondants témoignages, resta toujours moins spontanée qu'entraînée comme un reflet de son amitié beaucoup plus confiante pour Monge.
Tandis que les grands personnages en uniformes ou habits à haut collet et cheveux noués à la vieille mode causaient ainsi gravement astronomie, philosophie ou conquêtes d'Alexandre, tous les subordonnés imaginaient d'une façon plus matérielle le pays des merveilles, au sujet duquel ils se faisaient les illusions les plus singulières. Tous croyaient trouver en Egypte les trésors et les délices poursuivis au Mexique et au Pérou par les compagnons de Cortez et de Pizarre. Monge se fait l'écho des conversations courantes, quand il écrit en plaisantant à sa femme : « Dans le pays où nous allons, nous aurons quelques harems à notre disposition. Si tu entendais tous les projets de notre jeunesse affamée, cela te ferait passer quelques quarts d'heure gaiement. » [Lettre du 5 juin 1798]
Néanmoins, les heures paraissaient parfois longues et le roulis provoquait des mauvaises humeurs. Alors, cette existence de ville d'eau où tant d'hommes se trouvaient en contact forcé et constant les uns avec les autres, amenait ou accentuait les habituels dissentiments. En particulier, il existait, je l'ai déjà remarqué, un désaccord qui ne fit que s'accroître jusqu'au bout entre les militaires et les civils. Bonaparte était parti en Egypte avec l'idée d'y laisser une conquête durable et d'y appliquer les dons d'organisateur qui devaient
plus tard trouver un champ plus vaste. Il considérait que la science devait être le fondement solide d'un État moderne. Aussi avait-il emmené avec lui tout ce futur Institut d'Egypte dont l'œuvre devait seule survivre à la conquête. Il aimait la conversation des savants, parce qu'elle l'instruisait. Il évitait la familiarité des officiers qui pouvaient se croire ses pairs. Aussi réservait-il ses faveurs à ses confrères de l'Institut. Les souvenirs d'Arnault montrent, par leurs anecdotes plaisantes, qu'il en résulta dès le début une hostilité, accrue plus tard par les déceptions de la terre africaine. C'est, le soir du départ, cet officier qui occupe de force la chambre réservée pour Berthollet et que Bonaparte en punit par des arrêts forcés ; et c'est la scène où Junot, ennuyé de devoir assister par ordre à une conférence scientifique, fait mine de ronfler, pour se réveiller en maugréant contre ce « sacré Institut », dans lequel, grogne-t-il, Lannes devrait être reçu sur la seule foi de son nom.
[En Egypte, les soldats, attribuant aux savants l'idée d'une campagne qui leur avait vite déplu et à leurs erreurs les désillusions subies, partageaient contre eux l'antipathie de leurs chefs. Une plaisanterie courante en Egypte était : « Formez le carré ! Les savants et les ânes au centre! » On appelait encore les ânes les « demi-savants ».]
De Malte à Alexandrie, cette existence dura douze jours. Parfois, on envoyait des coups de canon aux navires marchands rencontrés en route pour les forcer à s'arrêter, à causer et à prendre l'engagement de ne pas renseigner les Anglais. Une nuit, l'escadre de Nelson et celle de Bonaparte naviguèrent sans le savoir à six lieues l'une de l'autre. Enfin, par un hasard prodigieux, l'escadre française parvint sans encombre à Aboukir. Nelson, ayant piqué droit sur l'Egypte tandis que Bonaparte contournait la Crète, était arrivé trois jours plus tôt, s'était étonné de ne voir personne et était reparti à la recherche des Français vers Chypre, laissant derrière lui le champ libre.
Le 1er juillet, on se hâta donc de débarquer par une mer affreuse et les soldats virent pour la première fois ce désert de sable qui représentait l'Egypte rêvée. Ce fut le commencement d'une déception bientôt croissante. Étonnés, ils plaisantent entre eux : « Tiens, voilà les six arpents de terre promis!... Eh bien! quoi qu'on fasse ici, il y fera chaud! » Bonaparte— qui, il ne faut jamais l'oublier, était un jeune homme de vingt-neuf ans — se jette dans un canot, saute sur la plage et, roulé dans son manteau, s'y endort.
Monge, pendant ce temps, restait à bord pour surveiller l'impression des proclamations arabes avec les caractères qu'il avait apportés de la Propagande.
Le 4 juillet seulement, il mit pied à terre et se rendit à Alexandrie, déjà occupée par nos troupes, où la Commission des Sciences et Arts qu'il présidait prit aussitôt quelques dispositions pour organiser un service sanitaire avec défense contre la peste [Les lettres de Monge à sa femme manquent du 17 juin au 21 octobre]. Dès ce même jour du 4 juillet, l'armée, sans perdre un instant, partait par détachements pour rejoindre à Ramanieh la rive gauche du Nil, maugréant contre le Directoire, contre ces ânes de savants, mourant de soif et d'abord tellement désorientée par l'aspect imprévu des choses que, la première nuit, il se produisit une alerte où l'on se tira les uns sur les autres. Bonaparte rejoignit son armée le 7. Monge et Berthollet l'avaient accompagné jusqu'à Ramanieh, où, pour les ménager, il se sépara d'eux en leur faisant prendre la voie fluviale qui faillit bien leur être fatale.
Cet incident se produisit huit jours plus tard. Le 11 juillet était partie de Rosette la flottille du chef de division Pérée qui recueillit à Ramanieh Monge et Berthollet. Elle était composée de vingt-cinq djermes, ou bâtiments du pays, portant chacune une centaine d'hommes, avec des canonnières, une demi-galère et un chebek. La route jusqu'à Gizeh semblait devoir être facile. Mais, les eaux du Nil étant basses, le 14 juillet plusieurs bateaux s'échouèrent près de Chebrérys [Exp. d'Egypte, III, 179 et pl. 299 montrant la fin du combat entre les deux flottilles, avec intervention des troupes de terre]. La flottille fut alors attaquée par des canonnières turques à pièces de gros calibre et par des troupes de mameluks et d'Arabes massées sur les bords du fleuve, qui assaillaient en même temps le gros de l'armée chevauchant par terre. De neuf heures du matin à midi et demi, les Français de la flottille résistèrent avec peine et Monge et Berthollet montrèrent un courage tranquille dont fit mention le récit officiel de Bonaparte et du général Berthier [Pièces diverses et correspondances relatives aux opérations de l'armée d'Orient en Egypte, imprimées en exécution de l'arrêté du Tribunal, 1797. — Cf. Mémoires de Bourrienne, p. 106. Souvenirs d'Arnault, p. 98. Commandant Guitry, p. 104.]. Cinq djermes furent coulées bas et le commandant Pérée atteint d'un boulet. Monge, toujours optimiste et ardent, fit le métier de canonnier servant et de pointeur, tandis que Berthollet, plus pessimiste mais aussi calme, remplissait ses poches de cailloux pour couler plus vite à fond avant d'être mutilé par les barbares. Enfin, à midi et demi, Bonaparte, dont le corps formait l'aile droite, accourut avec de l'artillerie et les ennemis s'enfuirent précipitamment. Finalement, on avait tiré ce jour-là, de part et d'autre, plus de mille cinq cents coups de canon pour tuer quelques hommes.
De Chebrérys à Gizeh, on poursuivit alors pendant onze jours une navigation pénible, où l'on était réduit à vivre de pastèques et d'eau en recevant la fusillade (d'ailleurs peu meurtrière) des Arabes et des fellahs. Pendant ce temps, l'armée de terre se heurtait, le 21 juillet, aux mameluks massés en avant des Pyramides. La flottille n'arriva à Gizeh que le soir du 23, après avoir vu le Nil couvert de cadavres et entendu le bruit du canon. Bonaparte l'accueillit en disant à Bourrienne avec une nuance de reproche plaisant : « Vous voilà donc ! C'est pour vous sauver, vous, Monge, Berthollet et d'autres, que j'ai manqué mon combat de Chebrérys où aucun mameluk ne se serait échappé. »
Le 24 juillet, Bonaparte entra au Caire, où il allait en trois fois séjourner finalement huit mois, et s'occupa aussitôt de coloniser l'Egypte. A ce moment, il avait encore sa flotte et il annonçait à son frère Joseph son retour possible en France dans deux mois. Il demandait des renforts et, comme il n'oubliait rien : « Une troupe de comédiens, une troupe de ballerines, une centaine de femmes françaises, des fondeurs, des liquoristes, des distillateurs, des jardiniers. » Ses projets étaient vastes. Il comptait, d'après Bourrienne, surprendre l'Angleterre par l'arrivée imprévue de sa flotte dans la Manche, tandis que Nelson s'immobiliserait dans la Méditerranée, et peut-être entrer à Londres quelques mois après avoir conquis le Caire. Mais, le 1er août, la défaite d'Aboukir, trop facile à prévoir sinon impossible à éviter, devait renverser ce château de cartes et anéantir les dernières illusions de l'armée. En un instant, tous les grands projets à la Pyrrhus s'écroulaient et Bonaparte lui-même eut un moment de découragement dont son ami Monge dut recevoir l'écho comme Bourrienne. Dans l'armée, des généraux aux soldats, ce n'était que lamentations.
Néanmoins, la qualité maîtresse de Bonaparte était de savoir prendre, en face d'une situation imprévue, la décision prompte qu'elle exigeait et, quand la fortune lui résistait, de la renverser en la violentant. Isolé désormais en Egypte comme dans une place assiégée sans secours possible, il se mit à compléter et à organiser sa conquête comme si elle eût dû être perpétuelle, la prenant plus que jamais par nécessité pour base de ses opérations futures. La tâche des soldats était d'occuper la haute Egypte et d'assurer la route de Syrie. Les ingénieurs, pour la plupart polytechniciens et élèves de Monge, avaient à établir des canaux, des barrages, des écluses, des routes, etc. On demandait aux membres de la Commission des Sciences les moyens de fabriquer du pain, mais aussi de la poudre, des boulets et des fusils, comme Monge l'avait fait en 1793.
Dans ce programme, l'Institut d'Egypte était appelé à remplir un rôle capital. Tout en ressuscitant l'histoire du passé, il devait préparer l'avenir. Bonaparte le constitua dès le 20 août et, à la stupéfaction des Arabes, en laissa la présidence à Monge, ne voulant être que le vice-président de cette société savante, parce que, disait-il, « cela paraîtrait en Europe beaucoup plus raisonnable ».
Cet Institut était divisé en sections : mathématiques, physique, économie politique, littérature et arts (Bonaparte avec Monge, Malus, Fourier, etc. dans les mathématiques), et tenait deux séances par décade. Dès la première séance du 23 août, un certain nombre de questions lui furent posées par Bonaparte, montrant l'application pratique que l'on attendait de ses travaux et qui, à cette époque, nous avons eu l'occasion de le voir, s'affirmait aussi à l'Institut de France : 1° Quels sont les moyens d'économiser le combustible? 2° Quels sont les moyens de rafraîchir et de clarifier les eaux du Nil? 3° L'Egypte renferme-t-elle des ressources pour la fabrication de la poudre? etc. C'est ainsi qu'Andréassy et Berthollet montrèrent la possibilité de fabriquer de la poudre (qui était, du reste, abondante au Caire) et que le minéralogiste Dolomieu s'occupa à améliorer la fabrication du pain. Mais on mettait quelque coquetterie à traiter aussi des questions théoriques et, dès la troisième séance, Fourier lut un mémoire sur la résolution des équations algébriques, tandis que Monge, dans les deux premières, traitait du mirage ou des pierres à nummulites qui ont servi à bâtir le château du Caire. Bonaparte lui-même, piqué d'émulation, voulut un jour faire une communication comme le premier membre venu. Monge fut obligé de l'arrêter en lui objectant que, dans sa situation, s'il parlait, ce ne pouvait être que pour annoncer quelque chose d'extraordinaire.
En même temps, on utilisait les savants de toutes manières et, le 1er septembre, Monge était nommé, avec Berthollet, inspecteur général de la Monnaie ; le 3 octobre, commissaire français près du Divan général. Les jeunes polytechniciens étaient mis partout à contribution : cartes d'Egypte, réparation des digues et des canaux, etc. Cette activité scientifique allait durer sans interruption cinq mois, jusqu'à la fin de décembre. Chacun avait organisé sa vie au Caire. L'Institut, où logeait Monge, occupait deux magnifiques palais qui devaient voir, un demi-siècle plus tard, un autre Français réaliser le canal des deux mers, rêvé et cherché par Napoléon [C'est, prétend-on, dans la pièce même jadis occupée par Monge que de Lesseps, en 1854, aurait fait les premiers projets du canal de Suez. Une lettre de Bonaparte du 2 août (Corresp., IV, 302) charge Berthollet, Monge et Caffarelli de choisir ce palais. Voir Geoffroy Saint-Hilaire. Corresp. (Introd. VII)]. Un jardin immense, où l'on se promenait le soir en causant, formait Jardin des Plantes, avec ménagerie et volière [Voir une vue dans l'Expédition d'Egypte, pi. 86]. Là furent émises bien des idées originales, exprimées bien des illusions et formés bien des plans. Tandis que beaucoup gémissaient sur l'impossibilité de rentrer en France, Bonaparte et Monge, optimistes par tempérament, se plaisaient à imaginer d'avance la florissante Egypte future, telle qu'elle nous apparaît aujourd'hui, et s'attachaient par tous les moyens à la réaliser: l'un apportant son esprit d'organisation, l'autre sa science. Bonaparte surtout éprouvait, dans l'isolement de l'Egypte, cette griserie que connaissent bien les coloniaux, en voyant tomber toutes les chaînes qui compriment un civilisé en Europe. Il était le maître absolu, le prophète, il faisait son apprentissage d'empereur. A vingt-neuf ans, il régnait sur l'Egypte conquise en trois semaines. Demain, puisqu'on lui fermait la mer, il occuperait la Syrie, l'Asie Mineure et, rassemblant autour de lui tous les mécontents de la Turquie, il marcherait sur Constantinople avec une armée toujours grossissante, il prendrait les Autrichiens à revers et reviendrait à Paris à travers l'Europe stupéfaite. Jamais il ne fut aussi heureux qu'en Egypte et d'aussi bonne humeur avec ses compagnons.
Pourtant, il ne réussissait pas toujours à étonner les Arabes comme il l'aurait voulu. En particulier, il échoua devant eux avec les prodiges de la science, réactions chimiques, électricité, aérostat construit par Conté sur la proposition de Monge, etc. Les musulmans étaient trop habitués à la sorcellerie de leurs contes de fées, ils la considéraient comme trop naturelle pour éprouver une émotion que, d'ailleurs, ils se seraient gardés de laisser voir. Les savants éprouvèrent avec eux une déception qui s'est renouvelée longtemps après, à nos expositions universelles, quand on a essayé d'y émerveiller des Touareg.
Le 24 septembre eut lieu une excursion aux Pyramides, où Monge se distingua. On avait convoqué les membres de la Commission des Sciences et les chefs militaires à prendre place dans des barques qui traversèrent les eaux du Nil débordé. Bonaparte avait rassemblé dans la sienne ses compagnons habituels : Monge, Berthollet, Denon, Fourier, Geoffroy Saint-Hilaire, Berthier, Dufalga, etc., et, selon son habitude, pour occuper le temps, il leur avait proposé un sujet de discussion, certaine proposition sociale du général Dufalga Caffarelli, l'homme à la jambe de bois, d'après laquelle le fermier d'une terre aurait été déclaré copropriétaire des améliorations réalisées par lui sur le fonds. On se serait cru d'avance à une de ces séances où Napoléon participa à la confection du Code civil. Puis, on quitta les barques pour marcher dans le sable vers ces fameuses pyramides que l'on s'était borné précédemment à apercevoir de loin, quand les quarante siècles contemplaient du haut de leur cime les soldats français aux prises avec les mameluks.
Dans cette vie en commun prolongée depuis des semaines, il s'était créé, comme dans toute société fermée, un cercle de plaisanteries à répétition, où Bonaparte prenait volontiers le rôle de railleur, sans admettre la réciproque. Arrivé au pied des Pyramides, le général, comme un maître d'école encourageant ses écoliers au jeu, cria : « Allons, qui arrivera en haut le premier? » On vit alors, malgré son âge, Monge prendre la tête pour complaire à son héros et, bientôt après, il atteignait le sommet, cherchant des yeux l'applaudissement du grand homme. Pendant ce temps, d'autres étaient moins ardents. Geoffroy Saint-Hilaire raconte comment Berthier, arrivé à mi-chemin, lui dit: « Qu'en pensez-vous, voisin, si nous descendions? » Mais Bonaparte, qui le guettait, se mit à le plaisanter d'en bas avec sa taquinerie habituelle: « Eh ! Elle n'est donc pas en haut, mon pauvre Berthier?... » Elle, c'était Mme Visconti dont Berthier était follement amoureux et à laquelle il pensait sans cesse en Egypte, au grand amusement des autres officiers. « Allons, dit Berthier avec résignation, il va m'accabler de plaisanteries. Plus de poltronnerie, voisin ! » Et, péniblement, il reprit l'escalade jusqu'à la cime, où Monge, qui avait aperçu la scène, le réconforta avec une gourde d'eau-de-vie pendue à sa boutonnière. Mais ce bon Berthier n'échappa pas pour cela aux railleries, toujours un peu lourdes, de Bonaparte qui l'accusait d'avoir quitté le boudoir de Mme Visconti pour aller faire une scène de cabaret au sommet des Pyramides.
Au mois de septembre, quand il avait été question de réunir cette fiction de parlement égyptien nommée le Divan général, Monge avait été chargé de rédiger une adresse au peuple d'Egypte. Cette adresse, que nous possédons, ne satisfit pas complètement Bonaparte et fut remplacée par une autre que l'on fit voter le 18 octobre. L'adresse de Monge, après un rappel de l'ancienne grandeur égyptienne, opposée à sa décadence actuelle, indiquait le programme des Français : en rétablissant les canaux de Suez à Alexandrie, rendre au Caire les anciennes destinées de Memphis et profiter du complément apporté par l'Amérique à la consommation et aux productions de l'ancien monde, multiplier les irrigations, faire reculer le désert : « L'heureuse Egypte qui, par sa position, est le point de communication unique de l'ancien et du nouveau monde, va ressaisir le sceptre du commerce, devenir la patrie de tous les peuples et se trouver encore une fois la bienfaitrice du monde... ». « Souvenez-vous, concluait-il, que si, d'une main, le général Bonaparte vous présente l'olivier de la paix, de l'autre il porte le glaive terrible qui détruit toutes les résistances. »
Deux jours après qu'eut été votée une adresse analogue, éclatait, le 21 octobre, une de ces insurrections qui couvent toujours à l'insu des Européens dans ces pays d'Orient si fermés et, sous un calme apparent, si profondément hostiles. Pour flatter les indigènes, suivant l'usage français, et montrer le respect de leurs croyances, on avait commis l'imprudence de laisser les muezzins lancer du haut des minarets de soi-disant prières, incomprises de nous, qui étaient en réalité des appels à la révolte. Lorsque cette révolte commença soudain à cinq heures du matin, le général Dupuy, commandant la ville, fut tué, et, de tous les côtés, les Français se virent assiégés ou assaillis. Monge, dans un récit de l'insurrection adressé à sa femme, s'attache à diminuer le danger couru et passe à peu près sous silence son rôle personnel pour raconter ainsi les événements :
« Cette insurrection aurait pu avoir des suites très graves, si ces gens avaient autant de prudence et de sagesse que de fanatisme. Il a fallu deux jours pour les réduire, parce que le peu de largeur des rues ne permettait pas de porter l'artillerie partout où elle était nécessaire. Les premières hostilités se sont faites contre la maison du général Dufalga: peut-être parce qu'étant remarquable et connu par sa jambe de bois et passant, je ne sais pourquoi, pour un des promoteurs de l'expédition d'Egypte, on voulut exercer quelque vengeance ; peut-être aussi parce qu'ayant reçu depuis deux jours un grand convoi d'objets d'imprimerie, de caisses de livres et d'instruments de physique et de mathématiques (que les gens du pays auront pensé être un trésor), on aura eu l'espoir de faire une bonne capture par le pillage. Il n'était pas chez lui. La maison a été défendue par le petit nombre de personnes qui y étaient; mais elle a été forcée et pillée avant qu'on ait pu y porter du secours. L'insurrection s'est ensuite manifestée dans les principaux quartiers de la ville. L'Institut où nous demeurons n'a été menacé que le lendemain. Nous avons pris les mesures nécessaires pour faire une vigoureuse résistance ; nous étions assez bien armés ; mais une forte patrouille, commandée par le général Lannes, étant arrivée précisément au moment où deux colonnes se portaient sur nous de deux côtés opposés, elle les a dispersées et notre bonne contenance n'a pas été mise à l'épreuve... Nous avons perdu quatre membres de la Commission des Sciences et Arts: les uns tués en sortant de la maison du général Dufalga, les autres surpris et tués dans les rues. Du reste, notre perte n'a pas été trop grande. Nous n'avons que trente-cinq blessés dans les hôpitaux... Nous avons bien à nous louer des soins qu'a pris de nous le général en chef. A tous moments, il nous expédiait des ordonnances pour être informé de notre situation et, si nous avions été attaqués, nous n'aurions pas été longtemps sans être secourus. » [Lettre du 25 octobre 1798 apportée en France par Louis Bonaparte. — Cf. Jomard, loc. cit., p. 41 ; Arnault, Souvenirs, p. 107 ; Guitry, l'Armée de Bonaparte en Egypte,. p. 166, 171 ; Geoffroy Saint-Hilaire, Corresp., p. 103.]
La vérité est que, pendant deux jours, l'angoisse fut grande dans l'Institut d'Egypte, menacé à diverses reprises par une foule furieuse. Monge avait organisé la défense avec Berthollet, Fourier et Costaz, tandis que Conté se barricadait de même dans une maison voisine où il avait ses ateliers de mécanique. En attendant de recevoir assez de fusils et de cartouches, on avait fabriqué des lances avec des couteaux attachés sur des bâtons et consolidé les murs. Deux ingénieurs, Favier et La Roche, remplirent la tâche dangereuse d'assurer à pied la liaison avec le quartier général. La situation apparut tout à fait critique quand, le troisième jour, on vit accourir les insurgés, refoulés par les troupes françaises. On entendait leurs vociférations. Les secours n'arrivaient pas. On parlait d'au moins trois cents Français tués dans la ville. Beaucoup proposèrent alors de se réfugier au quartier général pendant que la voie était encore ouverte et l'on commençait, en effet, à sortir, quand Monge, indigné, se mit en travers de la porte, déclarant qu'on ne pouvait ainsi abandonner tous les instruments précieux qui seraient aussitôt saccagés. Au contraire, il distribua les postes en vue d'un assaut, prit pour lui le plus dangereux et, quand tout fut prêt, s'écria avec cette grosse gaieté qui animait parfois sa bonhomie : « Maintenant, qui veut venir causer pour se désennuyer? »
Pendant ce temps, Bonaparte avait placé sur le Mokattam des mortiers dont les projectiles bombardaient la ville. On entendait le canon et la fusillade mêlés aux cris de mort. Enfin, une forte patrouille commandée par le général Lannes arriva, l'Institut fut débloqué et la révolte apaisée. Mais, outre la perte en hommes, on avait à déplorer la destruction des principaux instruments, saccagés dans la maison du général Dufalga. « Qu'allons-nous faire sans outils ? dit Bonaparte à Conté. — Eh bien ! dit Conté tranquillement, nous commencerons par faire des outils. » [Conté (1755-1805), chimiste, fut un des fondateurs du Conservatoire des Arts et Métiers, inventeur des crayons qui portent son nom. Monge disait de lui : « Il a toutes les sciences dans la tête et tous les arts dans la main. » ]
Quelques jours après, Monge écrivait une lettre empreinte de ce robuste optimisme qui le faisait toujours chercher une interprétation favorable aux événements les plus fâcheux [Lettre du 14 novembre 1798, qui mit huit mois à parvenir] : « L'insurrection dont je te parlais a été heureuse sous un point de vue et, si elle n'avait pas été aussi chère, elle aurait été désirable. On avait traité les Égyptiens avec une douceur et des ménagements exemplaires et peut-être attribuaient-ils à quelque sentiment de faiblesse les égards que jusqu'au tambour de l'armée leur montrait. Mais, actuellement, ils ont éprouvé notre force... Depuis que nous sommes en Egypte, le ciel est toujours beau, le soleil est toujours brillant et, si jamais nous y voyons quelques gouttes de pluie, ce sera pour nous un phénomène... Lorsque ce pays-ci aura été habité, bâti, planté, percé pendant cinquante ans, ce sera un paradis terrestre ; les propriétaires viendront passer l'hiver ici pour améliorer leurs possessions et courront au printemps manger leurs revenus à Paris... Je viens de suspendre ma lettre pour assister à la lecture de papiers d'Europe qui viennent de nous arriver et que le commandant de l'escadre anglaise a envoyés au général en chef. Nous voyons que vous ne saviez pas encore à cette époque notre débarquement à Alexandrie et encore bien moins la défaite presque entière de notre pauvre escadre. Si l'amiral Brueys, qui a eu un mois entier pour cela, avait eu l'esprit d'entrer dans le port d'Alexandrie ou de se retirer, soit à Malte soit à Corfou, au risque d'y être bloqué, notre expédition serait la plus brillante possible... J'ai vu dans les papiers une lettre que je t'ai écrite. Je ne suis pas, comme Lalande, fort curieux que mon nom soit sur les gazettes... »
On remarquera dans cette lettre que, tout en ne recevant aucune lettre de France, Bonaparte était, dès cette époque, mis au courant par l'amiral anglais des mauvaises nouvelles. Pour la défaite d'Aboukir, Monge adopte naturellement la thèse de Bonaparte, reportant toute la faute sur Brueys, et il y revient avec insistance dans une autre lettre : « Si l'amiral Brueys avait suivi les ordres du général en chef ; si, après avoir opéré le débarquement de tout le matériel, il eût fait entrer sa flotte dans le port d'Alexandrie, ce qui a ensuite été reconnu possible, ou même mieux encore, si (les Anglais étant, à sa connaissance, dans l'est), il eût tout simplement mis à la voile pour Toulon où il serait arrivé sans difficulté, l'expédition aurait quelque chose de miraculeux. Il a fallu que notre flotte fût détruite pour lui donner une couleur humaine... »
Il remarque cependant que les finances sont dans un état piteux et ne permettent pas de travailler comme on le voudrait. Mais, ajoute-t-il, et nous reconnaissons là le caractère facilement satisfait de notre Monge, « ces retards mêmes ne sont peut-être pas si fâcheux; on reconnaît tous les jours le pays et, quand les circonstances le permettront, on fera les opérations les plus utiles et de la manière la plus profitable. Déjà l'on a reconnu les anciens canaux qui communiquaient de la mer Rouge au Caire et l'on en a suivi un jusqu'à une lieue du Caire. Ce que les Romains firent, ce qu'ont fait depuis les Califes, nous pouvons le faire et nous ouvrirons par l'Egypte une route au commerce de l'Inde... Ce beau pays, devenu le point de communication entre les deux parties du monde les plus peuplées et les plus industrieuses, sera peuplé et actif comme le Pont-Neuf, par lequel communiquent entre elles les deux moitiés de Paris ».
Et pour compléter ce tableau idyllique, Monge ajoute que « le jeune général jouit de la confiance entière de l'armée » et que l'armée, après avoir eu beaucoup d'humeur, « commence à s'accoutumer au pays et même à le trouver agréable ».
On voit également dans cette correspondance qu'il était arrivé au Caire cinq cents chameaux du Sinaï chargés de charbon, de gomme arabique et de fruits (poires, pommes, raisins frais), et que cette caravane célébrait Bonaparte comme ayant « le bras de fer et la bouche de miel ». A la date du 23 décembre, il y est dit aussi qu'on amène des avant-postes un Indien porteur d'une lettre de Tippo-Saëb. C'est en réponse à ce message que Bonaparte devait écrire le 25 janvier au chef hindou une lettre connue. D'autres récits moins enthousiastes montrent toutefois qu'en cette fin de 1798, quand Bonaparte renvoya en France un bâtiment chargé de blessés et de malades, « tout le monde enviait leur sort ».
Mais cet hiver amena des fêtes, des bals, et la galanterie même ne fut pas oubliée, mêlant des scènes de comédie à l'épopée. On vit, à partir du mois de décembre [après la fête du 1er décembre qui se termina par un bal; l'envoi du mari en mission figure dans la correspondance officielle à la date du 7 décembre (t. V, 216)], la jolie Mme Fourès galoper, déguisée en hussard, au côté de Bonaparte; le mari chargé d'une mission en France et malicieusement réexpédié au Caire par les Anglais qui l'avaient capturé; enfin, la rivalité du grand chef avec le trop beau minéralogiste Cordier, qui, lui aussi, fut renvoyé en France à la première occasion.
Du 24 décembre au 7 janvier 1799, Bonaparte fit à Suez une excursion qui avait pour but, à la fois, d'étudier la restauration du canal creusé jadis entre la mer Rouge et le Nil et de prémunir par quelques fortifications la route de Syrie. Il emmenait ses compagnons ordinaires, Monge, Berthollet, Bourrienne, Dufalga, et une nombreuse escorte dont profitèrent plusieurs négociants. On suivit la route des pèlerins de La Mecque qui, pour la première fois, voyait rouler une berline. Le premier jour, on campa au lac des Pèlerins. Le second jour, on traversa le désert sous une chaleur intense. La piste était semée d'ossements et de débris momifiés, restes des caravanes antérieures, et Monge avait recueilli quelques têtes extraordinaires qu'il avait placées dans la berline où l'on allait seulement de temps en temps se reposer. Le 25 au soir, on campa un peu avant Adjeroud, petite forteresse au nord de Suez. Cette nuit-là, le froid devint si rude que, faute de bois, on alluma un bûcher formé de ces débris d'animaux, bûcher auquel Monge sacrifia les ossements recueillis par lui comme pièces d'anatomie. Mais il en résulta une odeur si infecte qu'il fallut lever le camp. [Guitry, loc. cit., p. 191]
Le 28, Bonaparte, avec Bourrienne et Dufalga, traversa à pied la pointe extrême de la mer Rouge pour aller voir, sur la rive orientale, la fontaine miraculeuse de Moïse, où le rejoignirent les savants qui avaient passé le golfe sur des canonnières. Quand on repartit tous ensemble, le soir, pour Suez, la nuit était profonde et la mer montait rapidement comme dans une baie du Mont Saint-Michel. Les guides arabes, que les soldats s'étaient amusés à griser avec de l'eau-de-vie, ne reconnaissaient plus rien. Les cavaliers d'avant-garde, prenant pour un feu de Suez le fanal de la chaloupe canonnière, égarèrent la colonne, qui commença bientôt à enfoncer dans l'eau. La situation devenait critique [Bourrienne, Mém., p. 196]. Napoléon la résumait à Sainte-Hélène, en disant : « Je faillis périr comme Pharaon, ce qui n'eût pas manqué de fournir à tous les prédicateurs de la chrétienté un texte magnifique contre nous. » Mais il fit grouper autour de lui sa caravane, ordonna une halte, et détacha une douzaine de guides dans des directions rayonnantes, pour vérifier la profondeur de l'eau. Par ce moyen, on put retrouver le gué et atteindre le rivage.
Le surlendemain, avant de retourner au Caire, le général voulut encore reconnaître le fameux canal dont tout le monde parlait, mais dont le tracé exact était oublié. Il partit vers le nord avec Monge et, à une lieue de Suez, aperçut des restes de maçonnerie qui ne laissaient aucun doute. « Monge, Monge, s'écria-t-il, nous sommes en plein canal ! » On remonta alors le canal pendant quatre lieues jusqu'aux lacs Amers.
[Il est aujourd'hui curieux de lire dans la publication anglaise, Correspondance de l'armée française en Egypte interceptée par l'escadre de Nelson, avec quelles railleries les Anglais de 1799 accueillaient la folle chimère du canal de Suez (page XXIX). En Angleterre, on déclarait également que le désert entre le Caire et Suez était infranchissable pour une armée (Observ. sur l'exp. du gén. Bonaparte en Egypte, p. 73).]
En revenant de cette course, Bonaparte se trouva séparé du reste de la bande et un moment égaré dans le désert avec deux hommes d'escorte. Il regagna cependant Adjeroud, et, pour diriger les retardataires, commanda de tirer le canon tous les quarts d'heure et d'allumer des fanaux sur la route. Monge put ainsi le rejoindre à onze heures du soir [Voir Mémoires de Sainte-Hélène : Bourrienne, loc. cit., p. 215; Guitry, loc. cit., p. 157]. Le 3 janvier, Bonaparte se remit en route, accompagné de Monge et de Berthollet, avec deux cents dromadaires et chevaux, pour explorer la branche du canal dérivée du Nil qui réunissait Belbeys à Ismaïlia par l'Ouadi Toulilat. Enfin, le 7 janvier, on rentra au Caire, après deux semaines d'absence, mais pour n'y rester guère plus d'un mois. Il fallait, en effet, éviter l'arrivée d'une armée turque par la Syrie en se portant au-devant d'elle. L'armée allait se mettre en marche quand, le 29 janvier, un brasseur d'affaires nommé Hamelin apporta de France les premières nouvelles récentes reçues depuis bien longtemps : nouvelles peu encourageantes, mais qui ne firent que confirmer Bonaparte dans son idée aventureuse de se créer une voie de retour par l'Asie Mineure.
L'expédition de Syrie commença le 10 février et dura quatre mois (exactement cent vingt jours). Monge y prit part. Ce fut un échec, et les rêves orientaux de Bonaparte furent anéantis devant Saint-Jean-d'Acre, mais un échec que quelques succès sans conséquence permirent de dissimuler. Les mémoires dictés par Napoléon précisent les vastes plans qu'il formait au départ en comptant sur le soulèvement des Druses et des Maronites et sur « dix mille noirs encadrés » que lui amènerait Desaix : prise de Damas et d'Alep en juin; arrivée sur l'Indus en mars 1800 avec une armée grossie jusqu'à quarante mille hommes, etc. La réalité fut plus modeste!
On partit du Caire, le 9 à midi, pour Belbeys, d'où l'on gagna Salahieh, l'extrémité du lac Menzaleh et l'on atteignit la côte à Kattieh (est de Péluse et de Port-Saïd) le 14 [Voir un plan de Kattieh dans l'Expédition d'Egypte, pl. 181, et un plan d'El Arych, pl. 133. Les cartes d'Egypte et de Syrie se trouvent à la fin du second volume d'atlas]. Après quoi, par des terrains de sable souvent mouvants, on gagna El Arych, où les divisions des généraux Bon et Lannes se réunirent avec le quartier général (17 février). Dans cette marche, souvent difficile et pénible, où l'eau manquait, l'hostilité des soldats contre les savants et contre le mystérieux être bicéphale qu'ils appelaient d'un seul nom Monge-Berthollet se manifesta à diverses reprises. D'après Bourrienne, ce fut dans cette marche avant El Arych que Bonaparte aurait été informé par Junot de tous les bruits qui couraient sur Joséphine et qui devaient aboutir à la scène bien connue du retour.
Le fort d'El Arych fut enlevé sans peine. Le 28 février, on arriva à Gaza, où les troupes, en retrouvant de la verdure et de la pluie, eurent, comme les Hébreux de Moïse, l'impression d'entrer dans la Terre Promise. A ce moment, on était près de Jérusalem et, malgré l'esprit antichrétien dont toute cette armée était animée, beaucoup se montraient curieux de voir cette ville si renommée. Quelques vieux soldats élevés dans les séminaires chantaient des cantiques. Mais Bonaparte n'avait rien à faire en Palestine et continua sa route sur Jaffa, où l'on arriva le 3 mars.
Jaffa fut encore enlevée en trois jours. Une lettre de Monge à Fourier du 10 mars [Archives nationales, ++AE11 1476 Musée. Monge y décrit un monument égyptien relevé à El Arych] montre combien, dès ce moment, les munitions manquaient et comment on n'y suppléait que par les prises sur l'ennemi. Puis, l'on repartit au nord, vers Saint-Jean-d'Acre, où l'armée devait être immobilisée jusqu'au 20 mai et finalement repoussée. Nous ne possédons aucune lettre de Monge à sa femme pendant toute cette expédition et, par conséquent, aucun détail précis sur son rôle personnel dans cette circonstance, en dehors des souvenirs assez brefs fournis par Jomard ou par Arago.
Devant Saint-Jean-d'Acre, Monge semble avoir été très rapidement immobilisé par une sorte de fièvre typhoïde ou de dysenterie. Il resta au lit pendant trois ou quatre semaines, fidèlement soigné par son ami Berthollet, qui avait fait quelques études de médecine, et par le médecin en chef Desgenettes. Bonaparte venait souvent le voir et le consoler, le veiller et lui présenter son breuvage [JOMARD, loc. cit., p. 50]. Deux fois, Monge faillit succomber; mais sa forte constitution triompha. Pendant sa maladie, il s'inquiétait passionnément des opérations militaires qu'il interprétait avec son expérience de professeur à l'École de génie, mais pourtant avec la confiance inhérente à sa nature, accentuée ici par sa foi dans l'étoile de Bonaparte. Au début de mai, il dut abandonner toute illusion en apprenant qu'une nouvelle armée turque se concentrait à Rhodes et que les munitions, difficiles à remplacer, se faisaient de plus en plus rares [Elles ne manquaient pourtant pas aussi complètement qu'on l'a dit, puisqu'on put tirer des salves pour dissimuler la levée du siège].
A ce moment, Monge était hors de danger, mais encore incapable de se lever. C'est sur son lit qu'il écoutait avec enthousiasme les récits qu'on lui apportait de quelques hauts faits, comme celui du capitaine Tareyre remontant sur la brèche chercher un drapeau français qu'il y avait planté et qui s'était trouvé oublié dans la retraite. « Cette action, disait Monge, en racontant l'histoire plus tard, produisit dans ma santé la plus heureuse révolution. Je jouissais d'avance du plaisir que je trouverais à la retracer devant tous ceux qui me parleraient de la levée du siège. » L'incident dut ce produire pendant l'assaut du 8 mai où deux cents hommes pénétrèrent un moment dans la ville. Le 20 mai, il fallut battre en retraite sur le Caire, après avoir perdu plus de trois mille hommes. « Si Saint-Jean-d'Acre fût tombé, disait plus tard Napoléon à Sainte-Hélène, je changeais la face du monde. » Son camarade de l'École militaire, l'émigré Phélippeaux, avait-il donc empêché que la face du monde fût changée ?
Quand on commença la pénible retraite, Monge était assez remis pour pouvoir suivre l'armée moyennant quelques précautions. Bonaparte, partant lui-même à cheval, le fit monter dans sa voiture de voyage avec Berthollet et Costaz qui continuaient à lui donner des soins. Il eut alors l'occasion d'accueillir, derrière sa voiture, deux pestiférés et une Alsacienne, épouse d'un guide, qui allaitait son enfant et qui fit une grande partie du voyage entre les deux malades sans qu'il en résultât pour elle rien de fâcheux.
Du 24 au 28 mai, on prit un peu de repos à Jaffa, où se placent les épisodes, développés par la légende, de la visite aux pestiférés et de la discussion sur le projet de les endormir [Expédition d'Egypte, p. 20].
Le 3 juin, on retrouva El Arych et ses déserts de sable qu'il fallut traverser par une chaleur accablante. C'est à ce moment que l'on place l'anecdote pittoresque, sinon vraisemblable, des deux soldats se battant en duel, parce qu'ils se disputaient sur le physique de Monge-Berthollet : l'un, qui avait vu Monge, soutenant qu'il était de teint très brun avec une longue queue ; l'autre, qui connaissait Berthollet, qu'il avait des cheveux blonds et flottants.
Monge, remis, avait pu abandonner son véhicule et causait volontiers avec les soldats. Un jour, comme ceux-ci lui demandaient si ce pays avait toujours été aussi aride, il commençait à leur expliquer le cheminement des sables sous l'action du vent, quand Bonaparte survint : « Monge, s'écria-t-il, que dites-vous donc à ces braves gens, pour qu'ils vous écoutent avec tant d'attention ? — Je leur expliquais, Général, répondit Monge en plaisantant, que le globe éprouvera encore bien des révolutions avant que l'on voie ici des voitures comme à la porte de l'Opéra. » Les soldats éclatèrent de rire, entraînant l'hilarité de Bonaparte qui, d'habitude, ne riait guère.
Le 4 juin, quand on eut atteint Kattieh, Monge fit, avec Bonaparte et Berthollet, une pointe pour aller explorer à dos de dromadaire [Voir dans l'Expédition d'Egypte, pl. 309, l'aspect pittoresque que présentaient les soldats français montés sur des dromadaires, reproduit sur notre pl. 8] l'antique Péluse, à environ 40 kilomètres est de l'actuel Port-Saïd, au débouché sur la mer du lac Menzaleh, et de ce que les anciens appelaient la branche Tanitique ou Pélusiaque du Nil. Bonaparte devait se souvenir plus tard de cette excursion pour nommer Monge comte de Péluse.
Enfin, le 14 juin, après vingt-cinq jours de marche, l'armée rentra au Caire, musique en tête, les soldats portant des palmes comme une armée victorieuse.
Alors, il y eut une halte de deux mois, pendant laquelle on reprit la vie tranquille avec occupations scientifiques. Dans une des séances de l'Institut, eut lieu une scène très vive, qui peint bien le caractère réel de Bonaparte. Il avait lancé une de ses railleries ordinaires sur les médecins comparés à des assassins. Desgenettes, l'héroïque médecin de Saint-Jean-d'Acre, prit la mouche et, dans sa colère, osa une allusion directe à la proposition faite par le général d'empoisonner les pestiférés de Jaffa pour les empêcher de souffrir. Après quoi, il s'excusa en déplorant que Bonaparte voulût rester le commandant en chef quand il prenait part comme Monge aux discussions de l'Institut. En cette circonstance comme en beaucoup d'autres, Bonaparte montra que, s'il ne pardonnait pas quand on avait refusé de lui obéir, il savait admettre la contradiction, même la plus violente, quand elle lui était opposée par un homme de cœur.
Dans une séance ultérieure, le 19 juillet, Monge lut un mémoire de mathématiques sur les propriétés d'une certaine surface courbe, accusant ainsi, parmi des occupations si différentes, la persistance de son vieux goût pour la géométrie. Il se passionnait pour les descriptions de la haute Egypte que lui faisait un des compagnons de Desaix, l'artiste Denon, et rêvait, lui aussi, de remonter le Nil. Il examinait ses dessins de Denderah et de Philse, ces vieux papyrus qui lui rappelaient ceux d'Herculanum, vus sur place deux ans auparavant. Il interrogeait les voyageurs sur les colosses de Thèbes et sur les carrières d'où l'on a extrait leur granit, et s'efforçait d'expliquer par quels procédés les Anciens avaient pu réaliser ces merveilles. [Monge était très curieux d'archéologie, mais ne pouvait être bien compétent. La correspondance interceptée raille (p. XXVII) la naïveté avec laquelle il croit s'être assis sur les ruines du palais d'Ulysse].
Le 25 juillet, la victoire d'Aboukir vint réhabiliter un nom tristement célèbre par notre défaite navale. Bonaparte, ayant appris aux Pyramides le débarquement des Turcs, fondit sur eux et les dispersa. Mais quelques journaux que l'amiral anglais lui transmit à cette occasion lui apprirent la situation lamentable où se trouvait la France et l'amenèrent à décider son brusque départ. Aussitôt, il donna l'ordre d'armer les deux frégates, la Muiron et la Carrère, avec des vivres pour quatre à cinq cents hommes pendant deux mois, et le 7 août, il rentra au Caire, où son ami Monge, qui, naturellement, devait l'accompagner, fut vite mis dans la confidence. Le secret le plus absolu avait été recommandé à tous et, pour masquer les préparatifs impossibles à dissimuler, on s'attachait à mettre en circulation les bruits les plus contradictoires, tels que l'idée d'un voyage à Damiette. Les récits de deux témoins, Jomard et Geoffroy Saint-Hilaire [L'Amateur d'autographe Charavay, août 1913], montrent sous un jour bien caractéristique l'attitude de Monge, de Bonaparte et des assistants pendant ces dernières heures.
Le jour où le savant apprit la décision, malgré toutes les mauvaises nouvelles politiques qu'il recevait en même temps, son premier sentiment fut une joie débordante qui ne lui permettait pas de rester en place. Entrant alors dans le salon de l'Institut, il s'écria : « Qui vient se promener avec moi ? Je vais à l'île de Rhoda (dans le vieux Caire). » Geoffroy Saint-Hilaire et l'astronome Nouet acceptèrent. Monge leur dissimulait mal son agitation et, tout en s'efforçant de ne rien dire, il laissa si bien percer son secret que Geoffroy Saint-Hilaire, en rentrant, rédigea aussitôt une longue lettre à Daubenton, pour la confier aux heureux voyageurs destinés à revoir leur pays.
Le 15 août, la grande nouvelle commença à se répandre dans l'Institut, produisant une émotion extraordinaire. La plupart refusaient d'y croire ; quelques-uns, dont Geoffroy Saint-Hilaire, affirmaient l'exactitude du fait. Peu à peu, on groupa une série de détails significatifs. C'était l'ordre donné à Alexandrie d'armer deux frégates ; le travail auquel on se livrait pour emballer les trophées de Syrie et d'Aboukir ; le fait que Monge avait donné tous ses livres et manuscrits à l'Institut et sa provision de vin à Conté ; l'attitude du poète Parseval-Grandmaison qui, après avoir vivement désiré partir en haute Egypte et avoir obtenu son inscription sur la liste, y renonçait soudain ; plus encore peut-être l'insistance de Bonaparte réclamant à Conté, trois fois dans la même journée, le portrait de Mme Fourès.
Comme la discussion s'animait, Monge et Berthollet, sortant d'un dîner chez Bonaparte, arrivèrent dans la salle des séances. On leur trouva l'air préoccupé et embarrassé. On les interrogea, ils ne voulurent rien dire ; mais Monge, peu diplomate, laissait échapper des exclamations comme celle-ci : « Pauvre France ! » ou encore : « Que vous êtes heureux, vous allez voir Thèbes!... »
Deux jours après, les choses se précisèrent. Le 17 août, à six heures du soir, Bonaparte recevait de l'amiral Ganteaume l'avis que les croisières anglaises s'éloignaient vers Chypre. A neuf heures, l'ordre était expédié à tous ceux qui devaient partir de se tenir prêts à minuit. Officiellement, il n'était toujours question que d'un court voyage vers la branche de Damiette et Mansourah. Mais, pour les témoins, la nervosité des voyageurs ne correspondait certainement pas à une simple excursion.
Geoffroy Saint-Hilaire raconte que, deux heures avant le départ, on était réuni dans le jardin du général en chef. Il y avait là Bonaparte, Monge, Berthollet, et aussi l'aimable Mme Fourès, habillée en hussard. Comme les préparatifs s'allongeaient, Bonaparte engagea une conversation philosophique avec ses amis et se mit à leur parler de son passé [Correspondance -publiée par le docteur Hamy. — L'Amateur d'autographes Charavay, avril 1913] : « Je ne suis, dit-il, devenu militaire qu'à mon corps défendant. J'avais une autre ambition dans ma jeunesse et j'ai cru à mon étoile pour devenir, par mes inventions, un Newton... Depuis que j'ai rang dans l'armée, ce rêve de ma jeunesse me revient sans cesse à l'esprit et c'est là l'instinct qui me pousse dans mes loisirs aux leçons de Berthollet, non plus pour réaliser ma chimère, mais pour en juger le caractère. » Monge lui répondit qu'il avait assez de gloire sans cela et ajouta qu'en science on ne pouvait espérer recommencer Newton, parce que, selon un mot de Lagrange, il n'y avait qu'un monde à découvrir: « Que dites-vous là? répondit Bonaparte avec vivacité. Il en est un autre et qui peut donner aussi une gloire colossale. Newton a découvert le problème des grandes masses de l'univers placées à distance ; mais cet autre monde, c'est celui des molécules-principes sans distance appréciable et de leurs affinités. Ma jeunesse visait là. L'utilité des découvertes de Newton n'était qu'une spéculation philosophique. Je voyais une application pratique pour l'humanité à connaître la vie intime de l'univers. »
Pendant cette conversation où le génie de Bonaparte semblait d'avance entrevoir les édifices atomiques de la physique moderne, Monge faisait des objections assaisonnées de flatteries pour son demi-dieu. Berthollet, sobre de paroles à son ordinaire, prenait une attitude de Jupiter. « Visiblement, dit Geoffroy Saint-Hilaire, l'auditoire ne comprenait pas la pensée de Bonaparte et lui déniait son point de départ. Cela dura une heure et demie, avec des intermèdes, pendant lesquels le petit hussard, jouant des yeux pour interrompre une discussion trop ardente, attirait un instant son amant. Chaque fois, Bonaparte, ayant lancé son couplet pour provoquer une réponse de Monge, s'esquivait en disant : « Monge, continuez ! » Et il allait alors vers la jeune femme, lui donnait de petits soufflets d'amitié en plaisantant: « Voilà, ce me semble, un petit hussard qui m'espionne ! » Après quoi, il reparaissait dans le groupe, et reprenait: « Vous disiez donc, Monge? » Et Monge était enchanté d'avoir à répéter ce que le principal interlocuteur n'avait pas écouté. D'autres fois, des officiers d'ordonnance venaient dire au général où en étaient les préparatifs. Il leur donnait des ordres, puis retournait encore à sa conversation philosophique.
Au dernier moment, Monge et Berthollet étaient rentrés au réfectoire, quand on vint leur dire que la voiture du général en chef les attendait. Ils remontèrent vite dans leurs chambres pour faire descendre leurs bagages et revinrent dire leurs derniers adieux : Berthollet morne et contrit, Monge animé et embarrassé. Comme Monge se taisait, Costaz lui dit : « Eh bien ! citoyen Monge, tiendrons-nous séance sur les ruines de Thèbes?... — Oui, répondit Monge en balbutiant, à Dendera, sous... sur... Dendera...— Passez-vous par Damiette ? demande Parseval. — Je ne sais rien, je crois que nous allons dans la basse Egypte... Le général va trop vite dans ses expéditions... » Alors, il brusque les adieux et s'esquive. Mais Costaz et Fourier le rejoignent dans la cour pour lui demander d'expliquer ce mystère. Monge repousse l'idée du départ en France, mais parle maintenant de trois ou quatre mois d'absence : « Je crois, dit-il, que le général a dessein d'aller par Mendouf aux lacs Natroun, puis au Fayoum, et d'étudier la partie ouest du désert comme il a exploré l'est. » Monge et Berthollet gagnent la rue, et la voiture s'éloigne au milieu de son escorte...
Les voyageurs vont alors s'embarquer à Boulaq sur une djerme que Bonaparte employait pour naviguer sur le Nil et, suivant la branche de Rosette, ils passent par Menouf et Ramanieh. Là, montant à cheval, ils gagnent une plage située à une lieue d'Alexandrie où des chaloupes viennent les prendre pour les conduire à bord du Muiron comme des fugitifs qui s'évadent, tandis que leurs chevaux tout harnachés regagnent seuls Alexandrie et y sèment l'inquiétude. Le lendemain matin, 23 août, on met à la voile.
[Le Muiron était commandé parle capitaine de La Rue de la Gréardière, qui réussit cette périlleuse traversée et en fut remercié par une lettre de Bonaparte. Voir le récit officiel dans la Correspondance de Napoléon, tome V, p. 579.]
Au dernier moment, on avait vu apparaître le poète Parseval-Grandmaison, qui n'était pas commandé pour le retour et que Bonaparte refusait d'admettre. Monge et Berthollet intervinrent en sa faveur. Mais, suivant Arago, le suppliant aurait dû surtout son succès à une mauvaise plaisanterie qui vint à l'esprit de Bonaparte et qui changea son humeur. « Songez, était en train de lui dire Monge pour plaider sa cause, qu'il travaille à un poème sur Philippe-Auguste, qui compte déjà douze mille vers ! — Oui, mais il faudrait douze mille hommes pour les lire. » On rit et Parseval put rentrer en France pour y occuper glorieusement un fauteuil à l'Académie. [L'anecdote est reproduite par Pongerville. Gaspard Monge et l'expédition d'Egypte. {Revue américaine et orientale, Challamel, 1860, in-8°.)]
Pendant ce temps, au Caire, les paris s'engageaient pour et contre le retour en France. La Commission Costaz se mit en route, malgré tout, le 10 août, pour remonter le Nil, et la Commission Fourier la suivit huit jours après. Le général Dugua écrivait à Kléber des lettres éplorées sur l'embarras où le laissait cette fuite. Kléber, que Bonaparte avait mandé à Rosette de manière à ne pas l'y rencontrer, arrivait pour trouver, suivant son expression, l'oiseau déniché et s'étonnait tout au moins de ce manque de forme.
Ce retour, qui dura quarante-cinq jours, du 24 août au 8 octobre, ne ressembla guère à l'aller. Ce n'était plus l'embarquement pour Cythère, mais la retraite désabusée. Au lieu des quatre cents voiles entourant le haut navire qui voguait gaiement au son de la musique vers le pays des chimères, une petite troupe de fugitifs essayait de se glisser à travers les mailles du blocus anglais pour aller retrouver là-bas un pays défait, un gouvernement en dissolution et on ne sait quel accueil. Bonaparte lui-même, malgré sa foi inébranlable dans la protection de la fatalité, ne pouvait s'empêcher d'exprimer quelques inquiétudes : « Supposez, disait-il, que je sois pris par les Anglais, je serai enfermé dans un ponton et je deviendrai pour la France un déserteur vulgaire, un général ayant quitté son armée sans autorisation. Cela jamais ! Au moment où les matelots ennemis monteront à l'abordage, il faudra faire sauter la frégate. » [ ARNAULT. Souvenirs, p. 125]. Le jour où il parla ainsi, Monge aquiesça. « C'est bien, dit Bonaparte : Monge, je compte sur vous pour l'exécution. » Longtemps après, un navire à apparence hostile s'étant approché, on trouva Monge, qui n'avait rien oublié, à côté de la poudrière, une lanterne allumée à la main, prêt à agir comme son héros l'avait dit.
La traversée commença mal. Le vent était obstinément contraire et, pendant vingt et un jours, on resta en panne, rejeté sans cesse vers la Syrie [BOURRIENNE. Mémoires, t. IV, p. 5]. On proposait de rentrer à Alexandrie pour attendre. Bonaparte, lui, n'était pas homme à reculer. Il s'obstina et, finalement, le vent, redevenu favorable, l'emporta dans la direction de l'ouest sans que les Anglais l'eussent aperçu. Pour échapper à leur surveillance et, au besoin, s'échouer sur les sables, il avait ordonné de dévier la route vers le sud en suivant la côte d'Afrique jusqu'au sud de la Sardaigne. Ce fut ainsi qu'il réussit miraculeusement à s'échapper.
Pendant ces longues journées de mer, tantôt il se promenait sur le pont en surveillant l'horizon, tantôt il lisait quelque livre d'histoire ou de philosophie, la Bible ou le Coran [Expédition d'Egypte, p. 307], tantôt il jouait à un jeu de hasard, impatient là comme partout de maîtriser la fortune, mais, quand la chance l'avait favorisé ou quand il l'avait un peu aidée, dédaignant un gain matériel qu'il partageait entre les assistants. Quelquefois aussi, et surtout le soir, quand le navire était dans l'obscurité complète pour ne pas attirer l'attention des croisières ennemies, la conversation devenait plus intime. Bonaparte n'était pas toujours l'homme impénétrable et distant que l'on est tenté d'imaginer. Il avait ses heures de sensibilité passionnée. A ce moment surtout, une angoisse douloureuse le tourmentait au sujet des trahisons de Joséphine. Ce qu'il avait dit un jour dans une explosion de colère à Junot sur la route de Syrie, ce qu'il avait répété dans des entretiens plus délicats à son beau-fils Eugène de Beauharnais, il le redit ou le laissa entendre à son ami Monge. Celui-ci se souvenait aussi d'une nuit où l'entretien porta sur un sujet bien singulier.
Bonaparte se montra ce soir-là préoccupé d'atavisme, autant que pourrait l'être, un siècle plus tard, un de nos contemporains, et, comme se parlant à lui-même dans le bruissement des vagues sous le ciel étoile, il aborda la question scabreuse de sa naissance [Biographie inédite Eschassériaux]. Faisant allusion à la liaison connue de sa mère avec M. de Marbœuf, gouverneur de la Corse, et à la protection de celui-ci sur ses enfants, dans cette époque de démoralisation où toutes les suppositions étaient possibles, il expliqua combien il aurait désiré connaître avec certitude son vrai père. La raison qu'il donnait était la curiosité de savoir qui lui avait légué son aptitude militaire; mais, probablement aussi, il songeait déjà, sans le dire, au cancer héréditaire dont la préoccupation le suivit toujours et auquel une erreur de Mme Laetizia l'aurait fait échapper. Traitant le problème comme une question scientifique, il fit des rapprochements de temps sur le départ du gouverneur et sur sa naissance et arriva à conclure qu'il était bien le fils de Charles Bonaparte ; ce que, vingt ans plus tard, le développement du mal fatal devait sembler confirmer. Mais alors il ne comprenait plus d'où lui venait son talent pour conduire une armée !...
Après avoir longé la côte ouest de la Sardaigne, on fut obligé, le 1er octobre, d'entrer dans le port d'Ajaccio et de s'y immobiliser toute une semaine [Le 30 septembre, on était déjà entré dans le golfe, mais non dans le port, ignorant si la Corse était restée française]. Bonaparte était satisfait de promener ses amis parmi ses souvenirs d'enfance et de leur montrer les petits domaines de sa famille; mais il se découvrait trop de parents attirés par sa fortune et surtout il était impatient d'arriver en France, de savoir par lui-même ce qui s'y passait, inquiet de la quarantaine qu'il devrait subir à Toulon et de l'accueil qu'il recevrait. Lorsqu'on eut enfin repris la mer, on passa par des heures pénibles en apercevant une escadre anglaise de quatorze voiles. Bonaparte était déjà résolu à se jeter dans une chaloupe si l'ennemi approchait. L'amiral Ganteaume voulait retourner en Corse. Bonaparte commanda d'aller droit au nord-ouest. Les Anglais, reconnaissant deux navires de construction vénitienne et trompés par leur marche, les prirent pour un convoi de ravitaillement se dirigeant sur Gênes et disparurent au loin. Enfin, le matin du 9 octobre, on atteignit Saint-Raphaël [Correspondance de Napoléon, p. 582].
Là, par un contraste inouï avec les angoisses de la veille, commença brusquement et aussitôt ce rêve prodigieux que fut la marche de Fréjus à Paris dans un crescendo triomphal conduisant au 18 Brumaire. Les batteries de la côte, après avoir tiré quelques coups de canon sur ces inconnus, s'étaient tues. Les deux frégates étaient dans le port. Soudain, comme une traînée de poudre, le bruit se répand dans la ville que Bonaparte est à bord. La mer se couvre d'embarcations. Hommes, femmes, tous veulent voir le héros, le messie. On l'entoure, on l'entraîne, lui et ses amis, sans souci de la peste. Qui songerait à une quarantaine dans ce délire de joie universel?
Le déjeuner pris, sans un instant de repos, il repart en voiture avec Berthier, Monge et Berthollet [BOURRIENNE. Mémoires, p. 24]. Plus il avance, plus le triomphe grandit. Toute la France, soulevée par un même sentiment, acclame en lui celui qui va expulser les ignobles politiciens et, ce qu'il ne faut pas oublier quand on parle de cette époque, celui qui va ressusciter la République et assurer la paix. A Paris, quand la nouvelle se répandra, ce sera une ivresse dont Baudin des Ardennes, mourant de joie en apprenant la nouvelle, est resté le représentant symbolique.
Cependant, sur les deux routes de Paris à Lyon, des calèches roulent en sens contraire. Sur la route de Bourgogne, les frères et la femme du triomphateur se précipitent, les uns pour accuser, l'autre pour se défendre. Sur la route du Bourbonnais, sans les rencontrer, le général avance à toute vitesse avec ses deux savants, agité de sentiments contradictoires, où les préoccupations personnelles et la jalousie douloureuse se mêlent aux projets les plus ambitieux. Enfin, le 15 octobre au matin, les voyageurs fatigués arrivent à Paris : « Le général, disent les journaux, est descendu chez lui, rue de la Victoire, où il a trouvé sa mère... »
| Chapitre précédent | Table des matières | Chapitre suivant |