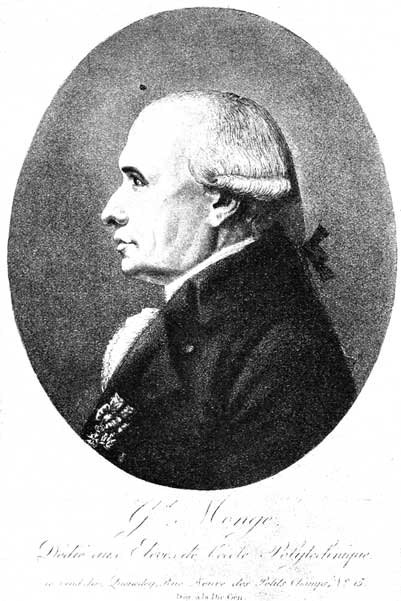
| Table des matières | Chapitre suivant |
Publié par EDITIONS PIERRE ROGER, Paris
Le nom de Monge évoque aussitôt deux grands souvenirs : la création de la géométrie descriptive et la fondation de l'École polytechnique. C'est à ce double titre qu'il a été maintes fois célébré et nous aurons à insister, nous aussi, sur ces côtés essentiels de son œuvre. Mais nous voudrions pousser plus loin et, profitant de très nombreux documents inédits empruntés à des archives publiques et privées, nous désirons mettre du même coup en lumière d'autres aspects intéressants de cette vie qui ont été généralement négligés, passés sous silence ou ignorés. Monge n'a pas été seulement un théoricien de la géométrie et de l'algèbre; il a été plus encore un homme pratique et un réalisateur. Ce caractère, qui apparaît déjà dans ses deux titres de gloire fondamentaux, se manifeste avec une évidence plus criante quand on envisage, comme nous allons le faire, l'ensemble d'une longue carrière aux activités singulièrement diverses, où la politique et l'administration ont tenu, à mesure que les années s'écoulaient, de plus en plus de place. Nous n'entendons pas écrire simplement une étude sur les travaux qui ont fait de Monge un membre illustre de l'Académie des Sciences, mais un récit aussi complet que possible de toute son existence si bien remplie.
Complet ! Je ne me dissimule pas qu'il va en résulter, par moments, quand j'aurai à énumérer de nombreux travaux épars, un certain émiettement fatigant pour le lecteur ; mais, écrivant la vie d'un grand savant, on doit, ce me semble, s'attacher d'abord à faire connaître, au moins sommairement, ses principaux ouvrages. D'autre part, à vouloir tout dire d'un homme qui a été aussi mêlé à des troubles politiques, on rencontre un danger plus grave, même quand il ne saurait en résulter aucune révélation fâcheuse. Ne risque-t-on pas de le faire apparaître moins sculptural et moins uniquement sympathique ? Cette façon de procéder soulève, je le sais, des objections et des scrupules. Elle s'oppose, en effet, à une doctrine classique qui a de nombreux partisans : doctrine d'après laquelle, même chez un écrivain, un philosophe ou un artiste, mais à plus forte raison chez un savant, on devrait faire entièrement abstraction de l'ouvrier pour ne considérer que l'œuvre. On n'aurait alors à examiner que les manifestations officielles de la pensée, que les ouvrages publiés, les seuls pesés, mûris et authentifiés, à l'exclusion de tout épanchement, de toute confidence, de toute intimité ou même de toute activité étrangère à la tâche regardée comme principale. Nous préférons à cette théorie trop abstraite, qui est celle d'un Taine, celle d'un Sainte-Beuve. Nous irons plus loin et nous ne craindrons pas d'avouer que, dans un homme célèbre, quel qu'il soit, nous cherchons d'abord un échantillon supérieur de l'humanité, particulièrement facile à connaître parce qu'il a été très observé et que sa supériorité même rend plus représentatif.
C'est l'homme avant tout, c'est son individualité ; c'est, si l'on veut, sa psychologie qui nous attirent. L'œuvre même du savant, toujours vite recouverte et masquée par les alluvions continues des travaux ultérieurs, n'est bientôt plus qu'un chapitre d'histoire ou le paragraphe à peu près anonyme d'un programme d'enseignement. Son mérite n'apparaît plus que par un effort d'esprit en le reportant à sa date. Isolé de son siècle, le génie le plus justement vanté pourrait nous sembler, en regard de ce que sait désormais tout écolier, très ignorant. Ses découvertes, s'il ne fût pas né, un autre les aurait faites un peu plus tard. On ne sait quel inconnu se serait attribué la gloire de Newton ou de Lavoisier. Mais il a été grand dans son temps, dans son pays, dans son milieu. Il l'a été d'une certaine manière qui ne concorde pas avec celle de ses émules. Il a eu des tendances, des intuitions, il a subi des réactions et des influences qui ne se traduisent sans doute pas directement dans ses théorèmes ou ses expériences, mais qui ont pu contribuer à les engendrer et qui font, en tout cas, qu'il a été lui et non un autre. Pour qu'il nous instruise, il faut le considérer, non dans l'abstrait, mais dans le concret; non perpétuellement en habit de cérémonie et figé dans l'attitude principale que lui attribue, pour simplifier, la postérité, mais aussi dans la familiarité de son geste, dans la multiplicité de ses actes et de ses mouvements. Lui-même, quoi qu'on en puisse dire, l'a voulu ainsi quand il a laissé diverger sa vie sous la pression des circonstances et des hommes.
Gaspard Monge n'a pas entendu se borner à étudier brillamment les lignes de courbure ou les équations aux différentielles partielles : il a accepté ou choisi d'être également métallurgiste, ministre de la Marine, attaché au Comité de Salut public, commissaire chargé de choisir des manuscrits, d'expertiser des diamants ou de créer des républiques, ambassadeur, sénateur, ami de Bonaparte, que sais-je encore. Nous avons à le regarder tel qu'il fut et non tel qu'il aura pu être représenté par quelque biographe académique. Pour obtenir la ressemblance d'un personnage, il ne faut pas recourir à ces photographies retouchées de professionnels, où l'on a effacé tous les traits saillants, les rides, les verrues. On nous fait mal connaître un Gambetta en le figurant de profil pour dissimuler qu'il était borgne ou un Monge en atténuant son anticléricalisme. Un homme réel n'est pas une statue de bronze isolée sur une place publique. Il a eu ses passions, ses préjugés, ses goûts, ses exagérations, ses travers, qui font corps avec tout son être. Son tempérament physique a influé sur son esprit. Il a participé à son ambiance. Il a pu, sans en être diminué, se tromper avec ses contemporains. Nous croyons être juste en le considérant dans son ensemble. Pour qui ne se paye pas de mots et de phrases sonores, il n'en gardera pas moins la place qui lui est due. Un Michel-Ange, un Pascal, un Napoléon ne sauraient perdre à ce qu'on leur restitue leur humanité.
Ces réflexions sont particulièrement nécessaires quand on aborde, comme ici, un temps de révolution qui se continue trop directement dans le nôtre pour être jamais regardé par nous avec une froide impartialité. En laissant même de côté le très grand savant et l'admirable organisateur, Monge, envisagé seulement comme homme, a été, nous le verrons assez, profondément bon, courageux et dévoué, un maître aimé pour lequel ses élèves n'ont cessé de proclamer leur enthousiasme, leur affection et leur reconnaissance. Il n'en a pas moins joué un rôle de premier plan à une époque tragique de notre histoire. Il a assisté comme ministre à l'exécution de Louis XVI et sa signature figure sur plus d'une décision qui nous afflige. Ce praticien a parfois prétendu réaliser des théories bien creuses et confinant à des chimères. Il a paru ainsi symboliser le défaut que l'on reproche si souvent aux algébristes lancés dans la vie réelle et, plus particulièrement, aux enfants de sa grande École. Nous devrons expliquer ces contradictions ; mais nous le ferons, je crois, aisément en montrant chez lui, dominant tout, écrasant tout, faisant tout disparaître, une foi mystique dans deux idées fondamentales et indélébiles qui, à cette époque, se confondaient : la République et la Patrie.
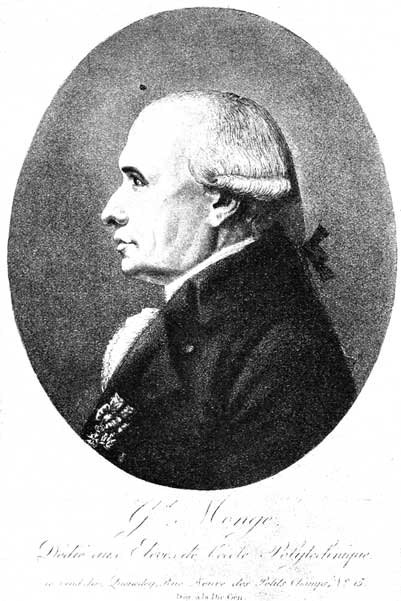
J'ai exploré, pour ce travail, les Archives nationales, les Archives de la Marine et de la Guerre, les manuscrits de la Bibliothèque nationale et de diverses bibliothèques ou archives qui seront cités en leur lieu. Mais je suis tout particulièrement reconnaissant aux descendants de Monge qui ont bien voulu me communiquer leurs documents de famille. Mme la baronne de Chaubry m'a fait connaître la correspondance de Monge avec sa femme et avec son ami du Marchais, de nombreux manuscrits inédits et un long travail particulièrement précieux de son père, le baron Eschassériaux, ancien député de la Charente, où celui-ci a retracé la vie de son arrière-grand-père Monge, année par année, avec le soin le plus minutieux [Toutes les lettres de Monge que je citerai sont, à moins de mention contraire, empruntées à cette source et inédites]. Je n'ai pas eu entre les mains toutes les pièces qui y sont citées et, comme cette biographie ne précise pas ses emprunts, je ne pourrai, dans ce cas, que renvoyer à elle. Mais, partout où j'ai eu l'occasion de la vérifier, j'ai constaté une exactitude scrupuleuse qui peut inspirer toute confiance. J'adresse également mes remerciements au colonel Sadi Carnot, qui a mis à ma disposition une collection de documents biographiques sur Monge, autrefois réunis par deux érudits de Beaune, MM. Louis Fournier et Louis Morand.
Je citerai le plus possible les documents originaux, au lieu de les interpréter en les enjolivant. Le lecteur qui préfère une histoire plus romancée, suivant la mode du jour, voudra bien m'excuser si je l'ai traité comme je désire être traité moi-même. J'aime peu les historiens d'une période discutée et complexe comme celle-là qui, pour rendre leur récit plus alerte, me demandent sans cesse de les croire sur parole. Je pense n'être pas le seul à préférer, quand il s'agit de documents inédits, qu'on me permette de vérifier et de juger par moi-même. Pour les sources imprimées auxquelles on ne peut se dispenser de recourir quand on veut étudier l'histoire de la Révolution, comme la série des publications officielles dirigées par M. Aulard où tous les documents se trouvent rangés dans un ordre chronologique qui rend les recherches faciles [Recueil des actes de Comité de Salut public, avec la correspondance officielle des représentants en mission et le registre du Conseil exécutif provisoire, publié par AULARD], il m'a paru inutile de multiplier les références.
La vie de Monge a déjà été racontée dans trois notices par
La géométrie descriptive. — Le voyage à Barèges. — Le mariage de Monge. — Monge académicien. — Ses démêlés avec l'administration de Mézières.
La famille de Monge était originaire des environs de Saint-Jeoire-en-Faucigny [L'acte de mariage des parents de Gaspard Monge orthographie Saint-Jouard], diocèse de Genève, près Bonneville (en Haute-Savoie), c'est-à-dire d'un pays qui, au dix-huitième siècle, n'était plus et n'était pas encore redevenu français. Le petit village d'Oignon, au-dessus de Saint-Jeoire en remontant la vallée, avait été presque entièrement peuplé par les Monge, constamment alliés à la même famille Boismont. Monge (Monche, Monacus), cela veut dire moine. Ces Monge s'appelaient ainsi comme tant d'autres Lemoine, Labbé, Leprêtre, Ledoyen, Lévêque ou Larchevêque, peut-être parce que leurs ancêtres, au moyen âge, avaient travaillé les terres d'un couvent. Le caractère de notre Monge rappelait un peu, si on le veut, ce solide atavisme de Savoyard, avec introduction maternelle d'optimisme bourguignon, auxquels il faut ajouter, pour le bien comprendre, les trente premières années passées dans les Ardennes, au voisinage d'une frontière souvent envahie.
Le grand-père de Gaspard Monge, Claude Monge, mari de Jacqueline Gay, Guet ou Guy, était laboureur et avait un frère curé de Saint-Jeoire. Il eut quatre enfants, de 1718 à 1740. Ses deux fils aînés, élevés et formés par leur oncle le curé, émigrèrent vers la Bourgogne. Dès 1737, nous trouvons le premier, Jacques Monge, le père du géomètre, établi à Beaune. Bientôt, le second, Claude-François, né en 1723, vient l'y rejoindre (avant 1744), et tous deux se font marchands. Ils se marient, le premier avec une jeune fille de Beaune, fille d'un voiturier, Jeanne Rousseau (en 1744), le second avec une jeune fille de Dijon, Pierrette André (en 1753), et font souche. Les relations avec le pays d'origine sont dès lors à peu près rompues. Quand Jacques Monge, l'aîné des deux, se marie [Acte de mariage du 19 mai 1744 à la paroisse Saint-Pierre-de-Beaune], le père envoie de loin son consentement. Mais l'évêque d'Autun doit accorder dispense des publications à Saint-Jeoire, « à cause des difficultés d'un voyage en Savoie, vu les troubles occasionnés par la guerre qui s'y fait actuellement ». On était, en effet, entré depuis trois ans dans la guerre de Succession d'Autriche.
A Beaune, Jacques Monge commence petitement. Une tradition locale, qui ne doit être qu'en partie exacte, voudrait qu'il eût été à ses débuts repasseur de couteaux. Un de ses biographes précise même qu'il se tenait ordinairement à l'entrée d'un petit passage (aujourd'hui muré) dans la rue Saint-Pierre, près la rue Couverte [Pierre JOIGNEAUX. Fragments hist. sur la ville de Beaune. Beaune, 1839]. Dans les actes officiels, son acte de mariage le qualifie, en 1744, de gagne-denier, et les amis qui lui servent alors de témoins sont un savetier, un perruquier et un cordonnier. En 1746, à la naissance de Gaspard, on l'appelle marchand forain; en 1748, manouvrier; en 1751, « adjudicataire de la Halle de Beaune ». Mais ce rude Savoyard est intelligent et travailleur. Il se débrouille. Il vend un peu de tout, comme font souvent les commerçants de petite ville, et peut-être repassait-il les couteaux qu'il avait fournis : d'où la légende. Un livre de ménage tenu par la soeur de l'échevin Bigarne porte encore, à la date du 8 juin 1770, cette mention: « Payé à M. Monge 7 livres 15 sols pour du lard [Ch. BlGARNE. Hist. de Charey et de ses Seigneurs. Beaune. 2 vol. in-8, 1875. Tome II, p. 394].» Cependant, dès 1755, ses titres sonnent mieux. On le dénomme: « Marchand dans la rue Couverte, membre de la Confrérie des Merciers établis dans l'église des Cordeliers et bâtonnier de cette confrérie. » Au même moment, son frère est quincaillier.
Dans l'espace de cinq ans, le gagne-denier Jacques Monge a eu successivement quatre fils, dont trois devinrent mathématiciens et le quatrième ne vécut pas :
Jean Monge [1751 à 1813] a été, de 1786 à 1789, professeur de mathématiques à l'École militaire de Rebais (Seine-et-Marne), consul de France à la Corogne de 1792 à 1795, professeur de navigation à l'École de Nantes en 1798, professeur d'hydrographie à Anvers de 1799 à 1810.
De 1755 à 1770, son frère cadet, à son tour, en a sept [enfants], dont un prêtre, une religieuse, un marchand et deux filles mariées, l'une à un juge de paix, l'autre à un employé des contributions qui devient directeur. Ainsi, l'évolutipn de cette famille se poursuit avant la Révolution, presque exactement comme elle s'opérerait aujourd'hui, suivant une loi commune à tant de familles bourgeoises : des générations de laboureurs qui, patiemment, amassent « des sous » ; puis une génération partant pour la ville et le commerce; à la génération suivante, des employés, des hommes de loi, de petits bourgeois, ou, si le terrain s'y prête, des écrivains, des artistes ou des savants. Chez les enfants de Jacques Monge, le terrain devait s'y prêter et il est à présumer que la direction donnée par le père fut solide, puisque Gaspard Monge ne présenta pas, dans cette race, un cas exceptionnel, mais se borna à suivre avec plus d'éclat la même carrière mathématique que ses frères. Ainsi, le bouleversement de 1789 devait le trouver déjà, si plébéien qu'il fût, membre de l'Académie des Sciences, examinateur de la Marine à Paris, inventeur et professeur de la géométrie descriptive. La Révolution s'est contentée de le faire, en outre, ministre de la Marine, président du Sénat conservateur et comte de Péluse ; ce qui ne l'a pas beaucoup grandi. Mais elle lui a fourni l'occasion de se révéler homme d'action en contribuant à organiser la défense nationale, surtout en fondant l'École polytechnique, et elle lui a procuré ainsi de beaux titres de gloire.
Sur la jeunesse de Gaspard Monge, nous ne sommes guère renseignés que par des souvenirs de famille empruntés à son gendre Marey-Monge et enregistrés par Arago dans un éloge historique souvent peu exact. Cependant, quelques documents conservés permettent de fixer des dates. Jacques Monge, le pauvre marchand forain, avait pu placer ses trois fils dans le collège de Beaune, dirigé par les Oratoriens, où l'on recueillait alors gratuitement, comme dans tant d'autres écoles de l'ancien régime, les enfants de quelque mérite. Gaspard Monge avait conservé précieusement des bulletins et diplômes où les braves Oratoriens lui témoignaient leur satisfaction et le qualifiaient de puer aureus. Le 21 juillet 1762, ayant fini ses classes de philosophie, physique et mathématiques, il reçut un certificat [Biographie Eschassériaux] où le P. Bouiller, de l'Oratoire, constatait en latin : « Gaspardum Monge Belneum lectiones philosophicas ex physica a me dictatas et explanatas a solemni scholarum instauratione ad solemnes usque scholarum inducias assidue scriptis et auribus excepisse, necnon theses ex mathesi omnium plausu propugnasse. »
Il avait, dès lors, des qualités qui le suivirent dans la vie : une douce ténacité, de l'enthousiasme, de l'amour-propre, de la méthode, une imagination plastique et une habileté manuelle qui lui permettait de réaliser ses idées. Tout enfant encore, il prit l'initiative de quelques œuvres comme il arrive d'en faire à des enfants bien doués qui ne seront pas Gaspard Monge : œuvres qui contribuèrent, avec ses succès scolaires, à attirer l'attention sur lui. Ainsi, à quatorze ans, il construisit, dit-on, une pompe ou une machine à moudre. Prévenus par leurs confrères de Beaune qu'il y avait là un sujet d'avenir, les Oratoriens de Lyon n'hésitèrent pas à l'appeler chez eux à la rentrée de 1762 pour lui donner un complément d'instruction à leur collège de la Trinité et l'attacher plus tard à leur ordre. Bientôt, ils lui confièrent, malgré sa jeunesse, une chaire de physique qu'il occupa jusqu'à l'été de 1764. C'est ainsi qu'une note manuscrite de Monge est consacrée à l'observation de l'éclipse de soleil du 1er avril 1764, au grand collège de Lyon. Ce tout jeune homme de dix-sept ans était sérieux et appliqué. Peut-être même tournait-il alors vers la religion chrétienne un peu de l'ardeur qu'il devait apporter plus tard à la religion révolutionnaire. On voulait faire de lui un Oratorien [Louis MONGE, frère de Gaspard, allait également, paraît-il, être ordonné prêtre au séminaire d'Autun, lorsqu'il abandonna l'état ecclésiastique pour les mathématiques]. Il allait, dit-on, entrer dans les ordres pour continuer à professer les sciences, lorsqu'il reçut de son père une lettre que cite Arago (peut-être en l'arrangeant un peu) :
Notice lue à l'Académie des Sciences, le 11 mai 1846 :
« Mon cher Gaspard, je n'ai pas le dessein de contrarier ta vocation si elle est bien arrêtée. Mais je te dois une réflexion paternelle. Tu la pèseras. Je suis persuadé qu'on commet une faute grave quand on entre dans une carrière quelconque autrement que par la bonne porte. On m'assure que tes études littéraires n'ont pas été assez complètes pour la carrière d'Oratorien. Maintenant, c'est à toi de prononcer ! » Cette lettre, telle qu'elle nous est donnée, prouve assurément une sagesse rare chez le père. Cependant, il paraît difficile qu'elle n'ait pas eu quelques dessous. La carrière offerte à Monge n'était pas littéraire, mais scientifique et, à cet égard, il venait de faire ses preuves. Pourquoi, au reçu de cette lettre, nous dit-on que Gaspard Monge quitta immédiatement Lyon pour se conformer au désir de son père ? Celui-ci, pour une raison quelconque, craignait-il de voir entrer son fils dans les ordres, quoiqu'il eût été élevé lui-même par un oncle curé et quoiqu'il eût confié l'éducation de ses enfants à des prêtres ? Espérait-il pour lui d'autres succès et une carrière moins assujettie ? Toujours est-il que Gaspard Monge revint à Beaune, et c'est alors qu'avec un de ses camarades, Fion, devenu plus tard ingénieur, il s'occupa à lever un plan détaillé de la ville pour l'offrir à la municipalité. Ce plan, qu'on peut encore voir à Beaune et qui a été gravé dans un ouvrage historique de l'abbé Gandelot, valut à son auteur une honnête rétribution et beaucoup de compliments. Les Beaunois, flattés d'avoir pour compatriote un petit prodige, célébraient ce travail qui fut admiré par un officier du génie, le colonel Du Vignau, commandant en second de l'École de Mézières. Celui-ci, constatant l'habileté graphique du jeune homme, offrit de lui faire obtenir un poste à Mézières, et la proposition fut acceptée. [Du Vignau était depuis dix ans à l'École et y commandait encore en second, sous M. de Ramsault de Baulcour, quand, en 1771, Lazare Carnot entra à Mézières.]
Cette arrivée de Monge à Mézières, non comme élève-officier, mais comme simple dessinateur ou cartographe, comme vulgaire employé, a fourni, dans certaines biographies, un thème facile à dissertation sur les préjugés de l'ancien régime. Un tel génie réduit, en raison de sa naissance roturière, à un emploi aussi infime! Monge lui-même semble bien avoir gardé quelque rancune à l'École de Mézières pour la déception qu'il eut le tort d'y éprouver dans les premiers temps. Mais jamais un officier au courant de l'École comme Du Vignau n'avait pu lui faire espérer occuper d'emblée, par pure bienveillance, une place d'officier à laquelle on n'accédait qu'à la suite d'un concours passé à Paris et l'on n'imagine même pas qu'un malentendu ait pu se produire à ce propos entre lui et la famille Monge. On croit seulement deviner que le jeune homme, jusqu'alors choyé et adulé par ses maîtres Oratoriens ou par les Beaunois, a dû se trouver d'abord très dépaysé à Mézières, dans un milieu où l'on ne voyait plus en lui qu'un homme habile à manier le crayon. Les jeunes officiers sont, toujours et partout, fort dédaigneux de ceux qui ne portent pas l'épée et Monge en souffrit pendant un temps qui dura, d'ailleurs, à peine une année. Le froissement d'amour-propre qu'il éprouva alors dut avoir son influence sur ses futures idées révolutionnaires. On peut imaginer, chez ce tout jeune homme, quelque chose d'analogue aux sentiments aigris d'un pion dans un lycée. Ceux qui s'élèvent très violemment contre les injustices générales ont souvent ainsi la rancune d'une injustice particulière.
Aussi ne sera-t-il pas inutile de préciser, en sortant de la légende pour examiner les faits précis, jusqu'à quel point cette rancune de Monge était ou non justifiée. Dans un temps où chacun trouvait naturel de rester à sa place, Monge, fils d'un petit marchand provincial, ne pouvait, en effet, être assimilé à des jeunes gens d'une autre éducation et d'un autre milieu social. On l'aurait admis par faveur à passer les examens de l'École militaire et il y aurait été reçu comme officier, qu'il s'y fût senti déplacé et en eût souffert. Mais la carrière de professeur lui restait ouverte. C'est probablement dans ce sens que le colonel Du Vignau l'avait encouragé et, quand on feuillette ses états de service aux archives de la Guerre [Arch. adm. de la Guerre, dossier de Monge. — Voir également sur l'École de Mézières, arch. hist. de la Guerre, série moderne, génie. École des officiers de 1756 à 1784, carton n° 97. Notre planche 2 représente l'état actuel de cette école], on s'aperçoit avec quelque amusement que, depuis au moins 1784, sans qu'il y fût probablement pour rien, mais simplement par un entraînement naturel, la particule commençait à enjoliver ce nom plébéien comme tant d'autres. Gaspard Monge devenait peu à peu M. de Monge [Lettre de M. Caux de Blacquetot de 1784; lettre du maréchal de Castries du 18 juillet 1784; lettre de M. de Blacquetot du 13 octobre 1784; lettre du maréchal de Castries du 12 décembre 1784; brevet imprimé du 24 décembre 1784, expédié le 9 février 1786, etc. Son frère s'appelle également Louis de Monge, sur un état de l'École de Mézières, en janvier 1782]. L'achat d'une terre ou d'un office aurait peut-être, sans qu'il fût besoin de la Terreur et de l'Empire, laissé ses enfants anoblis, comme ont pu le devenir, grâce à 93, ceux d'un comte de Péluse ou d'un marquis de Laplace. La plus grande différence entre les deux époques est qu'il était utile alors, pour avancer vite, d'être protégé par un grand seigneur ou par un évêque, ce qui constituait une humiliation évidente, tandis qu'il suffit aujourd'hui d'obtenir la chaude recommandation de quelque sénateur ou député. Monge eut ainsi pour protecteur, après ce colonel Du Vignau, un personnage plus haut placé dont nous reparlerons, le maréchal de Castries.
L'École de Mézières a joué un rôle capital dans la vie de Monge. Il y a professé pendant vingt ans, dont dix-sept de séjour permanent. Il y a pris ses opinions et formé ses idées. Il s'y est marié, y a fondé sa famille et y a produit, on peut le dire, la meilleure partie de son œuvre scientifique, le reste de sa vie ayant été occupé surtout par la politique. Mais l'École de Mézières nous intéresse encore plus par tout ce que lui a emprunté plus tard l'École polytechnique. Monge, le principal fondateur de notre grande École, avait acquis là toute son expérience et ses idées d'organisation. Ses collaborateurs de la première heure pour l'École polytechnique, Carnot, Prieur, Bossut, Letourneur, Hachette, avaient, eux aussi, figuré à Mézières comme professeurs ou comme élèves. Mézières leur a fourni l'idée fondamentale d'une école à la fois théorique et pratique destinée à préparer des ingénieurs militaires. C'est pour éviter les dissentiments constatés là-bas entre les diverses armes de formations différentes qu'on réunit, en 1794, à l'École polytechnique les futurs officiers de l'artillerie avec ceux du génie, puis avec les ingénieurs civils. Enfin, c'est un peu aussi de Mézières que vint la tradition d'une école où tout le monde reste associé par une solidarité constituant un véritable esprit de famille. A Mézières, cet esprit résultait tout simplement de ce que les officiers du génie se succédaient de père en fils (les de Caux, de Caligny, Bizot, Noizet, etc.). On devait voir de même à l'École polytechnique les familles se perpétuer et, sans aucun lien de parenté, les anciens traiter les jeunes avec une camaraderie paternelle ou fraternelle.
La conception de l'École de Mézières remonte à 1743, année où le comte d'Argenson, secrétaire d'État de la Guerre, ayant reçu dans son service le corps du génie et la fortification, jugea nécessaire d'établir une école du génie, où les élèves « seraient parfaitement instruits ». Mais la réalisation n'eut lieu qu'en 1748, lorsque le traité d'Aix-la-Chapelle eut mis fin à la guerre de Succession d'Autriche, pendant laquelle le génie s'était montré insuffisant. A cette époque, le nombre total des officiers du génie étant de 300, on limita le nombre des élèves à 30 pour le porter : à 40 en 1762; puis à 50, de 1763 à 1770; à 40 en 1771 ; à 30 en 1772, etc.
Au début, une grande partie des candidats venait de l'École de La Fère et la rivalité était grande entre les anciens élèves de La Fère et ceux qui n'avaient pas subi cette première sélection. Mais, peu à peu, d'autres écoles préparatoires concoururent en proportion croissante : celles de Paris, Nanterre, Sedan, Reims, Clamecy, etc. Comme dans nos écoles militaires actuelles, on entrait à l'École par un examen et on en sortait de droit officier. Mais cet examen n'était pas, ainsi qu'aujourd'hui, ouvert à tous les Français d'un âge déterminé. Il fallait, pour y être admis, recevoir une « lettre d'examen », précédée d'une enquête sur la famille, analogue à celle qui accompagne maintenant encore les admissions à certains concours. On aurait tort d'en conclure que l'entrée de l'École fût réservée à la noblesse [L'ordonnance du 31 décembre 1776 spécifie bien qu'il faut être « né noble ou fils d'un officier au grade supérieur » ; mais, pratiquement, il suffit de feuilleter les dossiers pour voir que, constamment, on passait outre]. Sur les listes annotées, les roturiers abondent. Mais on exigeait les habitudes, la tenue et les manières de la bourgeoisie; et, lorsque l'administration [L'École a été dirigée successivement par le chevalier de Châtillon (1756), de Ramsault de Baulcour (1767 a 1771), puis de Villelongue] se laissait aller à quelque faiblesse, c'étaient les élèves qui s'insurgeaient. Un Thiriat, fils d'un procureur, ou un Godineau, dont le père est simple « inspecteur des Manufactures », bien d'autres encore dont les parents vivent « honorablement sur leurs terres », sont déclarés « bons » sans difficulté. A cet égard, certaines nuances nous échappent. Un Lazare Carnot, de bonne famille bourgeoise, est admis, tandis qu'on refuse comme indésirable Cochon de l'Apparent, fils du sénéchal de Champdeniers, son futur collègue à la Convention. Mais d'autres décisions s'expliquent aisément. Ainsi, un candidat, d'abord admis en raison des parentés militaires dont il s'était vanté, est rayé quand on apprend que son père est marchand à Calais. A tort ou à raison, l'ancien régime professait, moins contre la roture que contre le commerce, un préjugé analogue à celui qui fait aujourd'hui déclamer le peuple contre les mercantis. Dans l'année qui précéda l'arrivée de Monge à Mézières, en 1763, cette question des admissions plébéiennes venait précisément de provoquer, parmi les élèves-officiers, une petite insurrection parce que le commandant s'était, à leur avis, montré trop large pour des gens « de basse extraction ».
Une fois munis de leur lettre d'examen, les candidats passaient à Paris un examen où, suivant les termes d'un rapport de 1771, « la protection n'intervertissait jamais en aucune façon un choix fondé sur la justice et le bien du service ». Examen d'ailleurs simple, comportant des éléments de mathématiques empruntés, suivant un usage très ordinaire, au cours en quatre volumes du vieil examinateur Camus, qui s'en faisait un petit revenu. On demandait aux candidats de savoir écrire et chiffrer très lisiblement, de connaître des notions d'arithmétique, algèbre, géométrie, mécanique et hydrodynamique, de dessiner le paysage et l'ornement à la plume et au crayon, de n'avoir ni l'oreille dure ni la vue courte. Mais, du moment qu'il y a concours, la difficulté du programme importe beaucoup moins que le nombre et le mérite des candidats. A Mézières, la sélection était réelle, puisqu'un cinquième seulement des candidats en moyenne trouvait place.
Une fois admis, les élèves touchaient 720 livres d'appointements, outre 200 livres exigées de leur famille. Ils étaient sous-lieutenants et devaient être rendus à Mézières le 1er janvier pour le commencement des cours.
La première année, ils apprenaient alors, pendant trois mois, la coupe des pierres et des bois, puis passaient à l'architecture, à la perspective et à la physique jusqu'au mois de juin. Après quoi, ils faisaient des exercices de campagne, des levers de fortifications et des simulacres de siège qui les conduisaient jusqu'à un examen au mois d'octobre. L'année suivante, le programme comportait : fortifications, levers, attaque et défense des places. Enfin, pour obtenir leur grade dans l'armée, ils passaient, avec le même examinateur qu'à l'entrée, un dernier examen de sortie, à la suite duquel ils pouvaient être forcés de recommencer une année ou même deux.
Cette École proprement dite s'était annexé un établissement où l'on exécutait des travaux pratiques et où l'on montrait aux élèves l'assemblage des charpentes, la confection des voûtes, le dessin de plans, en même temps que l'on y formait des sortes de contremaîtres pour les travaux de sape. Un charpentier nommé Marion y montrait le travail du bois. Un maçon y enseignait à façonner et tailler du plâtre gâché pour obtenir des voussoirs susceptibles d'être assemblés en voûtes. C'est pourquoi, cet atelier où Monge fut placé à son arrivée portait, dans la langue des élèves, le nom de gâcherie ou de gâche. Je remarquerai, à ce propos, que, cent ans plus tard, par une tradition ininterrompue remontant à Mézières, les élèves de l'École polytechnique pratiquaient encore le même exercice dans quelques séances de travail joyeux où, revêtus de longues blouses, ils taillaient, sciaient et polissaient des voussoirs aux modèles désuets en s'enveloppant d'un blanc nuage de plâtre pulvérisé. Et, si quelque Monge m'a donné alors des conseils utiles, je m'excuse de n'avoir pas su l'apprécier à sa juste valeur. C'est le court passage dans cet atelier de la gâche auquel, beaucoup plus tard, Mme Roland faisait allusion quand cette ardente démocrate appelait Monge avec dédain un ancien « tailleur de pierre ».
Monge, dessinateur ou répétiteur de dessin, choisi par la protection du colonel Du Vignau, ne pouvait songer à être assimilé avec des officiers triés par un concours, touchant la solde de sous-lieutenant et appelés à une carrière militaire. On s'explique pourtant fort bien qu'habitué à un travail plus relevé et connaissant sa force en mathématiques, il ait souffert de rester confiné dans des exercices manuels et d'être uniquement complimenté pour son talent de dessinateur, cause de son admission. « J'étais mille fois tenté, disait-il longtemps après, de déchirer mes dessins, par dépit du cas qu'on en faisait, comme si je n'eusse pas été bon à produire autre chose. » Ayant du loisir, il s'amusait à tracer, sur un pilastre de l'aile droite de l'École, l'épure de la méridienne et de la courbe du temps moyen. Il étudiait surtout la géométrie et apportait, en partant naturellement des problèmes pratiques qui se posaient à lui, la sagacité précoce, la force d'invention qui devaient un jour faire sa gloire. Il ne fut pas longtemps à en récolter les fruits. Un an à peine après son arrivée, on lui avait donné à résoudre un cas particulier de « défilement ». Il s'agissait, comme dans toute opération semblable qui constitue une des œuvres principales du génie, de combiner économiquement un tracé de fortification mettant le défenseur à l'abri des coups. Monge, au lieu d'employer les méthodes de tâtonnement usitées jusqu'alors, imagina à ce propos le principe de sa géométrie descriptive et résolut le problème si vite qu'on lui reprocha d'abord d'avoir bâclé le travail. Il insista. On vérifia les résultats. On les reconnut justes et, dès ce jour, appuyé par son premier protecteur Du Vignau, auquel s'adjoignit son professeur de mathématiques, l'abbé Bossut, il sortit de la gâche pour prendre place dans le corps enseignant.
Peut-être, étant donné l'importance que ce premier travail eut sur toute la carrière scientifique de Monge et sur la direction de ses recherches ultérieures, ne sera-t-il pas inutile d'en préciser le caractère.
« Quand on veut établir une fortification, nous explique Monge lui-même dans sa Géométrie descriptive, on suppose d'abord que, dans tous les sens, le terrain qui environne la place à la portée du canon soit horizontal et ne présente aucune éminence qui puisse donner quelque avantage à l'assiégeant. Dans cette hypothèse, on détermine le tracé de l'ouvrage. Après quoi, pour tenir compte du relief topographique, on donne aux fortifications une hauteur telle que le défenseur ne soit nulle part dominé par une zone dangereuse du relief extérieur. Le « défilement » d'une ligne par rapport à une telle zone consiste donc à mener, par cette ligne, un plan tangent au relief en question. On montera alors les parapets de manière qu'ils dépassent ce plan tangent de la hauteur d'un homme. Le problème géométrique est, par conséquent, de déterminer un plan ou une série de surfaces coniques tangentes au relief plus ou moins compliqué du terrain. »
Quand, à l'époque de Vauban et de Cormontaigne [Louis de Cormontaigne, ingénieur, 1696-1752], on commença à s'occuper du défilement, on se borna à chercher la solution pratique sur le terrain avec des règles et des jalons. Dès que l'École de Mézières commença à fonctionner en 1748, on y enseigna une solution qui transportait le travail dans l'atelier des dessinateurs. Le chevalier de Châtillon, premier commandant de l'École, avait imaginé de représenter le terrain par des projections cotées, comme on indique sur une carte le fond de la mer. En 1749, un autre officier du génie, Milet de Mureau, perfectionna le système en figurant sur son papier les cotes de chaque point rabattues suivant une même direction perpendiculaire à la ligne que l'on voulait défiler. Le terrain étant ainsi bien défini, on menait, par la ligne de base et le point le plus haut du relief, un premier plan tangent approximatif. On calculait à quelle hauteur ce plan passait au-dessus des divers points représentés par leurs projections. On comparait avec les longueurs cotées correspondantes. Si le plan laissait au-dessus de lui un point dangereux, on recommençait le travail avec un nouveau plan passant par ce point; et ainsi de suite. Tout cela était fort long. L'idée, très simple mais décisive, de Monge fut, en somme, de déplacer toutes ces droites représentatives des cotes pour les faire partir d'une même ligne de terre, en les supposant projetées sur un plan vertical perpendiculaire au premier comme un mur l'est au sol. Il pouvait par là, ainsi que nous le verrons plus tard, résoudre géométriquement, au moyen de la règle et du compas, tous les problèmes posés. On voit, en même temps, comment il fut amené à étudier spécialement les intersections de surface, les lignes à double courbure et à traiter les problèmes algébriquement après les avoir traités graphiquement : ce qui a entraîné tout l'enchaînement scientifique de son œuvre.
Voici donc Monge occupant à l'École une place plus digne de lui. Quel était alors le personnel dirigeant et enseignant ? L'École était commandée par M. de Ramsault-Baulcour, « brigadier des Armées du Roy, directeur des Fortifications de la Meuse, lieutenant du Roy de Mézières et Charleville». Nous connaissons déjà le commandant en second Du Vignau. Les mathématiques étaient enseignées depuis plus de douze ans par un savant de grande valeur, âgé alors de trente-cinq ans, l'abbé Bossut, qui a beaucoup contribué à la carrière de Monge. Il y avait également un professeur de physique éminent, l'abbé Nollet, auteur d'un traité célèbre, membre de l'Académie des Sciences, professeur au Collège de Navarre et à La Fère en même temps qu'à Mézières. Enfin, les examens, aussi bien pour l'entrée à Paris que pour le régime intérieur, étaient confiés depuis 1747 à Camus, qui commençait à vieillir. L'abbé Bossut, prévoyant sans doute la retraite prochaine de Camus et désirant le remplacer à Paris, vit dans Monge son successeur possible pour Mézières et le demanda comme suppléant. Une note de Monge précise qu'il fut nommé en 1766 à une place de répétiteur par M. de Ramsault, avec 900 francs d'appointements.
Deux ans après, Camus était mis à la retraite et l'abbé Bossut, nommé examinateur à sa place, partait pour Paris, où il devenait, en même temps, associé de l'Académie. Désormais, Bossut allait, pendant les vingt-cinq ans que devait encore vivre l'École, garder les mêmes fonctions d'examinateur à Paris et à Mézières, venant chaque année passer quelques semaines à l'École pour les examens intérieurs. Un rapport du commandant, daté du 24 avril 1768, montre comment on avait envisagé la combinaison financière. On maintenait à Bossut, comme examinateur, les 3 000 francs qu'il touchait comme professeur. On payait à Camus (qui mourut peu après) 3 000 francs comme retraite, au lieu de 4200 qu'il touchait comme examinateur, et on remplaçait Bossut par « un bon répétiteur à 900 francs », que le rapport ne nomme pas, mais qui était Monge. La situation ne fut ainsi régularisée que le 1er janvier 1769. Quelques jours plus tard, le 22 janvier 1769, Monge écrivait à l'abbé Bossut pour le remercier de l'avoir fait nommer et l'entretenait en même temps de problèmes mathématiques : « Une découverte faite par lui en réfléchissant sur ce qui arrive à plusieurs surfaces courbes que l'on fait mouvoir les unes sur les autres pour engendrer des épicycloïdes sur toutes sortes de surface. » En même temps, l'abbé Nollet commençait également à se faire aider pour la physique par cet auxiliaire de vingt-deux ans toujours prêt à toutes les tâches.
Monge s'installa alors dans un logement situé au-dessus de la porte de Theux, à l'extrémité de Mézières, du côté sud [Biographie Eschassériaux. Voir la planche 3] : une habitation double à trois fenêtres de façade, dont l'entrée est sous le porche; habitation qu'il devait occuper jusqu'à la fin de son séjour. En même temps, ce qui montre bien les relations affectueuses établies désormais entre le maître et ses élèves, il commença, avec un officier sortant de l'École, Du Breuil du Marchais, une correspondance mathématique qui se continua pendant plusieurs années. Un jour, il s'agit d'intégrer certaines différentielles ; un autre jour, il étudie les développées des courbes à double courbure ; et c'est toujours cette même joie juvénile que la seule science mathématique peut donner au même degré : la joie d'avoir mis le pied solidement et pour jamais sur un point jusqu'alors inaccédé de la vérité !
Le travail sur les développées, le premier qui ait donné lieu à une publication de Monge, l'occupa pendant les deux années 1769 et 1770. En décembre 1769, il écrit à du Marchais qu'il vient de le refondre : le 13 janvier 1770, il annonce qu'il va le lui envoyer et lui écrit qu'il a envie de le faire imprimer, avec quelques morceaux de calcul intégral dont il lui donne un échantillon. Sur ces entrefaites, le 24 avril 1770, l'abbé Nollet meurt et Monge le remplace officiellement. Par une lettre du ministre en date du 25 juin 1770, Monge est informé que ses appointements sont doublés et portés à 1 800 francs. Enfin, le 30 octobre 1770, il termine le mémoire sur les développées et leurs inflexions, qui fut présenté à l'Académie des Sciences le 31 août 1771, mais imprimé seulement en 1784. Le 14 décembre 1771, le gouverneur de Ramsault, faisant ses propositions de fin d'année pour ses officiers, ajoutait (et c'est la première fois où le nom de Monge figure dans les archives de l'École) :
« Je n'ai que de bons témoignages à vous rendre de toutes les personnes attachées à l'École pour l'instruction des élèves. Le sieur Monge, répétiteur et démonstrateur de physique, mérite les plus grands éloges pour ses connaissances, ses soins et son assiduité. Vous pourrez, Monseigneur, lui donner une marque flatteuse de votre satisfaction en lui accordant le titre de professeur de physique, ce qui n'exige aucune augmentation de traitement. »
La proposition de M. de Ramsault était de celles qu'une administration centrale accueille volontiers, puisqu'elle n'entraînait pas de frais. A partir de ce moment, Monge put donc s'intituler « professeur de mathématique pratique et de physique à l'École Royale de Mézières ». Son traitement devait être progressivement porté à 3 000 francs.
Parmi les élèves de cette époque, il en est un dont la célébrité future mérite au moins une mention. En 1771, entrait à Mézières Lazare Carnot, avec lequel Monge garda des relations, accentuées plus tard au Comité de Salut public, mais destinées à se refroidir par des divergences d'opinion sous l'Empire.
Comment professait Monge ? Sans doute avec les qualités qui, longtemps après, le rendaient si cher à ses élèves de l'École polytechnique : beaucoup de clarté et de vie, une grande attention à se faire comprendre et à recommencer ses explications quand il s'apercevait qu'elles avaient été mal saisies ; une parole embarrassée et légèrement bégayante, mais entraînante, lucide et complétée par la mimique éloquente des gestes. On disait plus tard de lui qu'en professant il pensait tout haut, ou encore « que d'autres parlaient mieux, mais que nul ne professait aussi bien ».
Dans sa jeunesse, il devait exercer, en outre, cette attraction d'un professeur que l'on sent profondément savant et qui est à peine plus âgé que ses élèves. Plein d'ardeur et d'enthousiasme, il ne bornait pas ses rapports avec eux à un enseignement plus ou moins distant. Il continuait ses leçons dans des promenades où, tout en causant, il appelait leur attention sur les phénomènes naturels, les formes géologiques des terrains, les usines et fabriques diverses, etc. ; il leur donnait ce qu'on appelle aujourd'hui des leçons de choses. A en croire Charles Dupin, parfois, dans le feu de la conversation, il s'égarait et, voulant gagner tout droit quelque usine, il s'en allait traverser à gué un large ruisseau, sans interrompre ses explications et sans que ses élèves, absorbés par sa parole, fissent mine de protester.
En même temps, il avait le loisir de travailler pour lui-même et, comme on pouvait le faire en cet heureux temps, il abordait de front les recherches les plus différentes, passant de l'algèbre à la physique. Mais sa vraie voie, où il donna immédiatement sa pleine mesure, était la géométrie. Et ici, il convient de citer d'abord sa principale création qui remonte à cette époque. A tort ou à raison, comme l'humanité est pressée et sa mémoire courte, elle veut pouvoir accrocher au nom d'un savant, d'un écrivain, d'un artiste, le nom d'une œuvre qui le résume. Monge reste ainsi, avant tout, le fondateur de la géométrie descriptive.
Qu'est-ce donc que la géométrie descriptive? C'est, en termes vulgaires, un moyen graphique de résoudre sur le papier, par des épures précises, avec la règle et le compas, une série de problèmes pratiques qui se posent en réalité dans l'espace, tels que les intersections de deux surfaces dans la charpente, la taille des voussoirs de pont, la perspective, etc. « Cet art, dit Monge avec plus de précision, a deux objets principaux. Le premier est de représenter, avec exactitude, sur des dessins qui n'ont que deux dimensions, les objets qui en ont trois. Le second est de déduire de la description exacte des corps tout ce qui suit nécessairement de leurs formes et de leurs positions respectives. »
La géométrie descriptive avait déjà été ébauchée avant Monge, notamment par Desargues, d'une façon empirique ; mais, sous sa forme moderne, elle est bien son œuvre et sa chose. Toute sa vie, il l'a professée un peu partout et il avait été naturellement conduit à lui attribuer une importance excessive, voulant qu'elle fît partie de toute éducation et qu'on l'enseignât dans toutes les grandes villes de France. Aussi, bien que son Traité de Géométrie descriptive ait été publié seulement en 1795 pour les élèves de l'École normale, convient-il d'indiquer dès maintenant quelles en sont la valeur et la position réelle dans la science. Nous serons ainsi amenés à faire un peu de mathématiques faciles. Mais, comme Monge lui-même, nous abandonnerons ce genre de préoccupations dans la suite.
Monge a toujours insisté sur ce fait que la géométrie descriptive est intimement liée à la géométrie analytique (ou résolution des problèmes géométriques par l'algèbre) et se propose un objet analogue : la solution d'un semblable problème géométrique, ici par une méthode graphique. Il faut, pour cela, dans les deux cas, commencer par définir rigoureusement la position d'un point dans l'espace : ce qui s'obtient très aisément en connaissant sa projection sur un plan et sa hauteur au-dessus de ce plan. Algébriquement, on définit cette projection elle-même par ses distances à deux axes rectangulaires. On est ainsi amené à considérer dans l'espace trois axes rectangulaires et trois distances à une même origine suivant ces axes qui constituent trois coordonnées. Graphiquement, il suffit de deux plans rectangulaires, tels que le sol et le mur ; et, comme on veut les figurer tous deux sur une même feuille de papier plane, on suppose l'un d'eux, le mur, ayant tourné d'un angle droit autour de leur intersection comme charnière, de manière à se rabattre dans le prolongement de l'autre. Le dessin étant tracé, l'imagination fait exécuter au plan mobile le mouvement inverse, afin de se le représenter dans sa position réelle. Il est facile de voir que les deux projections d'un point se trouveront sur une même perpendiculaire à la charnière, appelée ligne de la terre. Avant Monge, on employait déjà des projections cotées, comme je l'ai rappelé à propos du défilement. L'idée propre à Monge, et qui constitue le principe de sa découverte, a été d'employer deux projections orthogonales.
On conçoit, dès lors, comment on peut de la même manière représenter, ou du moins définir par leurs propriétés essentielles des lignes ou surfaces situées dans l'espace et résoudre ensuite, avec le crayon, le compas et l'équerre, les problèmes qui se posent à leur propos, tangentes, intersections, etc. A mesure que les problèmes se compliquent, on est amené à utiliser des artifices, tels que l'emploi de plans, de projections auxiliaires, les rabattements, etc., qui ont pour but de ramener un cas difficile à un cas plus simple : par exemple, de remplacer une ellipse par un cercle en changeant le plan de projection pour retourner ensuite, par une rotation inverse, à l'ellipse.
La géométrie descriptive de Monge apparaît aujourd'hui très élémentaire auprès de nos traités modernes et, déjà de son vivant, ses disciples, tels que Hachette et Dupin, avaient dû la compléter. Mais, pour apprécier un génie scientifique, il faut le comparer à ses devanciers, non à ses successeurs. Monge a apporté la clarté dans un chaos. C'est ainsi que l'on a souvent cité le mot de Lagrange disant un jour, beaucoup plus tard, après l'avoir écouté professer : « Avant d'avoir entendu Monge, je ne savais pas que je savais la géométrie descriptive. »
La géométrie descriptive appliquée à la stéréotomie (ou coupe des solides) formait à Mézières le principal enseignement de Monge et c'est là encore, pour le dire en passant, un des points où une vieille tradition remontant à Monge s'est perpétuée à l'École polytechnique. Un siècle après, j'en ai fait l'expérience, les élèves devaient y suivre un cours datant de Monge dans son principe, où l'on continuait à leur enseigner les procédés les plus archaïques de la taille des pierres ou des bois. Après quoi, ils traitaient les mêmes problèmes graphiquement en des épures dont la plus fameuse, reproduite de promotion en promotion, représentait certaine arche biaise.
Mais, pour assurer aussitôt la gloire scientifique de Monge, sa géométrie descriptive ne pouvait guère lui servir. Tous les biographes ont répété que l'administration militaire lui avait interdit de faire connaître un procédé nouveau qui, restant ainsi ignoré des ennemis, pouvait assurer un avantage à nos troupes. La chose est parfaitement possible et, de tout temps, on a vu le ministère de la Guerre cacher mystérieusement des secrets beaucoup plus banals et moins utiles que celui-là. A cette époque, la jalousie entre les deux corps savants de l'artillerie et du génie, qui n'a jamais complètement disparu, ne permettait même pas aux sapeurs de communiquer leurs méthodes aux artilleurs. En fait, Monge ne publia sa géométrie descriptive que vingt-cinq ans après. Mais ce retard fut-il uniquement dû à des difficultés administratives et n'arriva-t-il pas à Monge ce qui se produit pour tant de savants, toujours ardents quand il s'agit de chercher ou même d'enseigner, mais trop épris de la perfection, trop négligents ou trop occupés ailleurs s'il faut se décider à écrire? Lorsque Monge, vers 1789, eut avec la direction de Mézières de longs démêlés dont nous reparlerons, le gouverneur de Villelongue écrivait (26 sept. 1783), en parlant de son successeur Ferry : « Il a déjà fait un très bon ouvrage sur la stéréotomie, la coupe des pierres, etc., vainement promis depuis sept ans par M. Monge. » Cela ne concorde guère avec l'idée que cet ouvrage eût été interdit. On a souvent bien du mal à savoir la vérité historique !
En tout cas, les travaux connus de Monge pendant son séjour à Mézières portent presque tous sur une autre branche de mathématiques : la géométrie pure, ou l'application du calcul intégral à la théorie des surfaces. Si nous parcourons ces travaux dans leur ordre chronologique (ce qui est la seule manière de faire connaître une série d'œuvres sans plan d'ensemble), nous rencontrons d'abord un vieux manuscrit inédit remontant à 1769 et intitulé : « Supplément au calcul des variations de MM. Euler et Lagrange, ou Méthode de trouver les surfaces courbes qui jouissent d'un maximum ou d'un minimum ». Peut-on, en langage vulgaire, donner une idée de ces premières recherches sur la théorie des surfaces et sur les lignes de courbure, qui furent continuées dans les années suivantes? Arago l'a essayé.
Quand on veut connaître le degré de courbure d'une courbe plane en un point, on détermine le rayon du cercle qui, passant par ce point, approche le plus possible de la courbe, cercle dit « osculateur ». Le rayon de courbure est, par définition, le rayon du cercle osculateur. Si l'on envisage ensuite une surface, on peut, en un point donné, faire passer une infinité de plans par la normale à la surface en ce point. Chacun de ces plans coupe la surface suivant une courbe et chacune de ces courbes présente une courbure différente. Parmi toutes les courbures, il en est une plus grande et une plus petite que toutes les autres. Quelle que soit la surface, quel que soit le degré de l'équation par laquelle elle est représentée, ces plans de courbure maxima et minima sont toujours, Euler l'a montré, perpendiculaires l'un à l'autre. Cela résulte de l'équation par laquelle on calcule ce maximum et ce minimum. Les courbures de toutes les sections planes que l'on peut imaginer ainsi en un même point sont, en effet, liées entre elles par une relation algébrique très simple.
On peut alors, et c'est ce qu'a fait Monge, pousser plus loin. Si l'on examine, toujours au même point de la surface, l'arc infiniment petit compris dans un de ces plans de courbure maxima ou minima, il présente cette particularité que les normales consécutives à la surface sont contenues dans le plan et se rencontrent. Eux seuls jouissent de cette propriété. Mais on peut, de proche en proche, tracer sur la surface deux directions suivant lesquelles toutes les normales consécutives se rencontrent ainsi. Ces lignes, que Monge a appelées lignes de courbure, sont, elles aussi, rectangulaires entre elles. Il a montré leur rôle nécessaire pour limiter correctement les voussures d'une voûte et même pour tracer en gravure les hachures d'un modelé. Cette notion des lignes de courbure est encore aujourd'hui regardée comme une des découvertes principales de Monge et comme le classant parmi les fondateurs de la géométrie infinitésimale.
En 1770, il écrit le mémoire dont nous avons déjà parlé sur les développées des courbes à double courbure et leurs inflexions, mémoire qui fut présenté à l'Académie des Sciences le 31 mai 1771 [Voir Appendice 1, page 263, la bibliographie de ces travaux]. Il étudie également les équations des surfaces connues par leur mode de génération. Enfin, il commence à travailler sur les équations aux dérivées partielles : théorie dont il fut, avant Ampère, un des initiateurs. C'est l'objet d'un premier mémoire, le 16 mars 1771, sur lequel d'Alembert et Condorcet firent un rapport élogieux. Le 27 novembre, étant à Paris, Monge en lut un second. A ce moment, il était heureux d'utiliser son passage à Paris pour fréquenter Condorcet, quand le ministre de la Guerre lui intima l'ordre de rejoindre aussitôt son poste à Mézières. C'était le début de dissentiments avec l'administration de l'École, que nous allons voir s'accentuer quelques années après.
Ce premier voyage à Paris, fait à vingt-six ans, n'en fut pas moins profitable pour Monge, en le faisant sortir du milieu un peu confiné où il avait vécu jusqu'alors et en lui imprimant ce mouvement d'idées nouvelles qu'entraîne toujours la fréquentation personnelle d'hommes distingués. Longtemps après, causant un jour en Italie avec le général Desaix, qui a noté la conversation [Notes de voyage du général Desaix (Carnet de la Sabretache, 1899)], il lui disait comment il s'était lié alors avec Vandermonde, ami de Diderot, et avait été présenté par lui chez d'Alembert qu'il voyait bientôt après au moins une fois par semaine. D'Alembert, quoique pauvre, recevait beaucoup de gens très riches et avait beaucoup d'influence. Monge se rappelait, quand les Confessions de Jean-Jacques parurent (en 1781 et surtout sans doute en 1788), les intrigues de d'Alembert pour les faire tomber. Quant à Vandermonde, qui collabora longtemps avec Monge [Voir, sur la liaison de Monge avec Vandermonde, les notes du général Desaix (loc. cit.)], il ne faut pas trop le juger d'après le portrait malveillant de Mme Roland, qui n'aimait aucun des deux amis : « Je n'ai jamais rencontré, nous dit-elle, des yeux aussi faux et qui accusassent plus juste la nature du personnage. On dirait que celui-ci a le sien coupé en deux parts; avec l'une, on peut commencer tous les raisonnements; mais il est impossible d'en suivre aucun avec l'autre... Vandermonde, ami de Pache et de Monge, se vantait de servir de conseil à ce dernier et d'être appelé sa femme... »
Le 11 mars 1772, d'Alembert, Bossut et Condorcet étaient chargés d'examiner les titres des candidats proposés pour correspondants à l'Académie. Leur rapport sur Monge s'exprime ainsi : « Nous rappelons à l'Académie que Monge lui a présenté quatre mémoires, dont le premier est sur les équations de maximum qui contiennent des différentielles, le second sur l'intégration des différences partielles, le troisième sur les développées des courbes à double courbure et leurs inflexions, le quatrième sur la détermination des fonctions arbitraires dans les intégrales des équations aux différences partielles, et que, tous ces mémoires ayant été approuvés avec les plus grands éloges et jugés dignes d'être imprimés dans le Recueil des Savants étrangers, nous croyons que leur auteur mérite le titre de correspondant de l'Académie et qu'il en remplira les fonctions avec honneur. »
Le 8 avril 1772, Monge fut donc élu correspondant pour correspondre avec l'abbé Bossut.
On sait que, dans l'ancienne Académie des Sciences antérieure à la Révolution, il y avait une sorte de hiérarchie où l'on avançait par degrés. On pouvait commencer par être correspondant, et le mot était à peu près entendu dans son sens étymologique, c'est-à-dire que des savants provinciaux envoyaient à Paris des correspondances qui étaient transmises à l'Académie par un membre déterminé. Ces correspondants ne figurent pas dans le personnel de l'Académie indiqué chaque année par les almanachs royaux, et les efforts que l'on a faits récemment pour les identifier n'ont pas toujours été fructueux. On était ensuite adjoint ou adjoint vétéran pour telle ou telle science : par exemple, en 1773, Vandermonde et Cousin pour la géométrie ; Cassini pour l'astronomie ; de la Place, professeur à l'École royale militaire, pour la mécanique; Sage pour la chimie; de Jussieu pour la botanique. Après quoi, on pouvait passer associé (libre, vétéran ordinaire, ou étranger). Je relève seulement, parmi les noms célèbres de cette époque ou ceux qui nous intéressent par leurs rapports avec Monge : Perronet, premier ingénieur des ponts et chaussées; Joseph de Jussieu; l'abbé Bossut (examinateur des ingénieurs); Bezout, auquel Monge devait succéder comme examinateur de la Marine; Lavoisier; le botaniste Adanson, et, à l'étranger, Bernouilli, Haller, Euler, Linné et Franklin. Enfin, il y avait les pensionnaires ordinaires et vétérans, le secrétaire perpétuel et les membres honoraires choisis parmi les grands seigneurs. On trouve, comme pensionnaires : d'Alembert, Borda, Cassini, de la Lande, Vaucanson, d'Aubenton, de Jussieu et Guettard.
Bientôt après, Monge envoyait des « réflexions sur un tour de cartes », dont il fut rendu compte dans les termes suivants : « Ces discussions sont intéressantes parce qu'elles sont d'un genre tout à fait neuf, et il serait à désirer que M. Monge examinât de même d'autres lois moins simples de permutation, afin de parvenir, s'il est possible, à une théorie générale. Nous croyons ce Mémoire digne d'être inséré au Recueil des Savants étrangers. »
Tout cet hiver-là, Monge travailla beaucoup l'algèbre et il en résulta une série de mémoires qui achevèrent de le mettre en évidence.
Le printemps 1774 amena pour Monge deux relations qui eurent dans la suite sur sa vie une influence capitale : celle du maréchal de Castries, son futur protecteur, et celle de Pache, qui devint plus tard ministre de la Guerre et maire de Paris dans des circonstances trop fameuses. La seconde provoqua la première. Pache, né en 1746 comme Monge, était le fils d'un Suisse, concierge à l'hôtel de Castries. Le maréchal s'était intéressé à lui, l'avait fait élever, le traitait paternellement et l'avait donné comme précepteur à son fils, le jeune duc de Charlus. Tous deux vinrent visiter l'École de Mézières et se lièrent avec Monge qui les accompagna à Namur dans les premiers jours d'avril [Biographie Eschassériaux]. L'amitié de Monge et de Pache devait durer toute leur vie et avoir des contre-coups politiques. Le duc de Castries, très accueillant, reçut dans la suite chez lui et hébergea à la campagne l'ami du précepteur comme le précepteur lui-même. Il le protégea quand Monge demanda une place d'examinateur à la Marine, et cette protection s'étendit également au frère de Monge.
Il semble, d'ailleurs, que le jeune savant, à cette époque, ait exercé une véritable séduction par son activité d'esprit et son intelligence. Car, dans une autre famille de cette aristocratie militaire que l'on peint si arrogante pour les roturiers, il trouvait au même moment un accueil non moins affable. Le commandant de l'École, M. de Ramsault, l'avait pris en affection. Forcé par sa santé d'aller, cet été-là, prendre les eaux de Barèges avec sa fille et trois autres personnes de Mézières, il proposa à Monge de les accompagner en leur rendant quelques services. Sur ce voyage, qui dura trois mois (fin juin à fin septembre) et qui permit à Monge d'intéressantes observations physiques, nous sommes abondamment renseignés par une correspondance de Monge avec un ami de Mézières, M. Tisseron, cousin de sa future femme. Ce récit, écrit d'une plume enjouée, est précieux pour nous; car il nous montre Monge sous un jour plus intime que d'habitude et sortant du ton positif un peu lourd qui domine habituellement dans ses lettres ultérieures. On y observe un certain tour plaisant qui, d'après ses contemporains, était fréquent chez lui en conversation, mais qui ne ressort guère de ses autres écrits parvenus jusqu'à nous. C'est pourquoi nous allons lui faire quelques emprunts. [Biographie Eschastériaux]
La compagnie voyageait à petites journées dans une berline (et d'abord avec des chevaux de poste), en couchant chaque soir à l'auberge. La première lettre raconte l'arrivée à Bordeaux, le 29 juin, et le passage en bateau « au milieu d'une foire de navires, à peu près comme on passe les rues de Paris à travers les carrosses et les voitures publiques ». Monge — et nous lui en savons gré — montre, dès lors, un souci qu'on retrouvera plus tard chez lui dans tous ses voyages, de visiter les curiosités de la ville. S'il ne le fait pas en artiste, il le fait du moins en homme consciencieux ayant des préoccupations d'histoire et désireux de s'instruire. Le lendemain, on remplace les chevaux de poste par des chevaux de louage pour pouvoir éviter les routes banales, les seules sur lesquelles les relais de poste sont établis.
Voici la traversée des Landes, avant le boisement qui en a tellement changé l'aspect : « Ah ! le triste pays ! On voyage des journées entières sans rencontrer ni un arbre, ni un buisson, ni un ruisseau. Le pays est plat et uni comme la main à perte de vue de part et d'autre et n'offre d'autres productions que des fougères maigres et qui couvrent à peine le sol qui s'épuise à les produire. Ce terrain n'offre que du sable, de manière que nous étions voiturés comme dans un bateau sans secousse ni cahot... »
Une lettre amusante raconte l'arrivée à Pau dans une auberge encombrée où M. et Mlle de Ramsault doivent partager une petite chambre à deux lits avec un de leurs compagnons de voyage et un de leurs domestiques, tandis que Monge se réfugie dans la salle à manger servant de passage à plusieurs chambres où couchaient une douzaine de domestiques. Il se hâte d'aller voir le château à la nuit tombée, revient manger avec ses compagnons un souper mal servi, et chacun se retire dans l'espoir de dormir à peu près paisiblement. Ici Monge adopte le ton héroï-comique :
« O ma mémoire, retrace-moi toutes les circonstances de cette nuit tragique!... Je venais de me coucher dans ma chambre de passage. Déjà j'avais vingt fois imploré la compassion d'une vingtaine de laquais : « Eh! Messieurs, leur avais je dit, n'avez-vous pas pitié d'un pauvre voyageur? Au nom de Dieu, ne passez pas ici; ou passez-y plus doucement! » Mais leurs cœurs étaient inaccessibles à la pitié, comme mes yeux l'étaient au sommeil. Je m'agitais dans mon lit, en maudissant l'auberge, l'aubergiste et les gens qui y logeaient, lorsque j'entendis un grand tumulte, au travers duquel je crus reconnaître les accents plaintifs d'un mourant. Je fais un saut, tire mes rideaux et aperçois un convoi qui passait au milieu de ma chambre et beaucoup de gens qui suivaient. Les uns demandaient ce que c'était; les autres disaient : « Est-il mort? » Je passe vite mes culottes, et, dans la frayeur que le malheureux ne fût un de nos gens, je le demandai au premier venu qui ne le connaissait pas... On finit par me dire que c'était le cocher. J'en fus pénétré, parce que c'était un honnête homme dont nous avions été très contents et dont la santé était d'autant plus intéressante qu'il avait femme et enfants... Je courus dans sa chambre... Il avait eu répugnance à coucher dans une petite chambre sale où l'on pouvait à peine se tourner et où on avait mis sept ou huit lits pour coucher une vingtaine de personnes. Il s'était plaint et avait enfin gagné une des servantes de l'auberge qui l'avait appelé pour venir dans une autre chambre où il devait être mieux. Il avait voulu y aller, et, comme il savait que, pour aller à cette chambre, il fallait monter quelques marches, il était monté sur une caisse qu'il avait prise pour une marche et s'était jeté par la fenêtre qu'il avait prise pour une porte. L'étage était assez élevé, et il devait infailliblement se tuer. Mais, par une espèce de bonheur, il s'était trouvé précisément là l'impériale d'une chaise qui avait protégé la chute et l'avait fait arriver en deux temps sur le pavé... »
Monge, avec son bon cœur habituel, s'agite pour obtenir un chirurgien. Enfin, on en amène un, et la plaie se trouve moins grave qu'on n'aurait pu le craindre.
Ajoutons ce post-scriptum pour montrer la forme de l'intimité entre ces voyageurs de condition si différente : « M. de Ramsault, qui a la bonté de me voir écrire mon bavardage et d'en rire, vous fait ses compliments. »
Le 5 juillet au matin, on part donc en prenant pour cocher un des postillons. On passe à Betharam où Monge, pendant un relais, va visiter l'église et en est si frappé qu'il revient chercher Mlle de Ramsault pour la lui montrer. On traverse Lourdes, Pierrefitte, Saint-Sauveur et l'on atteint enfin Barèges, après s'être émerveillé sur l'aspect des montagnes dont on commençait à cette époque à apprécier le pittoresque. Les voyageurs étaient restés une quinzaine de jours en route et c'était à peu près le temps que mettaient alors les lettres de Paris pour arriver dans les Pyrénées.
A Barèges, Monge fait bientôt la connaissance d'un jeune médecin de Paris, M. d'Arcet, gendre du chimiste Rouelle, avec lequel il organise des observations barométriques à diverses altitudes, afin d'obtenir des hauteurs de montagnes précises, sur lesquelles on avait alors fort peu de renseignements. Monge lui-même le prouve en disant que le pic du Midi est peut-être la plus haute montagne de l'Europe, après le pic de Ténériffe. Personne, en effet, à cette époque, n'avait gravi ni la Maladetta, ni le Mont-Blanc, qui fut seulement atteint en 1786 et mesuré le 3 août 1787 par Saussure.
M. d'Arcet avait apporté un très bon baromètre portatif (baromètre à mercure, bien entendu), auquel était adaptée une lame de cuivre soigneusement graduée en pouces et en lignes. Le programme était de niveler d'abord au niveau d'eau une montagne des environs, puis de descendre successivement des degrés de 10 toises chacun et d'observer la hauteur du mercure à chaque station correspondante.
Les observations faites au pic de Leyrey durèrent du 14 au 20 août, avec un jour de repos pour l'Assomption. On commença par l'ascension du sommet, à l'occasion de laquelle Monge peint avec lyrisme le passage successif de l'été au printemps, puis à l'hiver, et fait des réflexions d'un style précieux sur les fleurs : « La pensée n'a pas la belle couleur bleue que vous lui connaissez. Quoique plus proche de la voûte azurée, elle n'en emprunte pas la couleur. Elle semble, à sa couleur jaune et triste, s'affliger de ne point ressentir les soins du jardinier. Les œillets ont de l'odeur, mais les fleurs sont découpées, et M. Firmin les bannirait de son jardin. Je crois qu'à la Chine on les trouverait plus beaux, parce qu'il paraît que la nature met plus de soin à former une fleur découpée qu'une toute nue. Mais vous savez qu'à la Chine on n'a pas le sens commun. »
Dans une autre ascension, Monge s'évertue à décrire une mer de nuages, au-dessus de laquelle ils sont passés : « Les nuages nous cachaient le fond des vallées : ils étaient de niveau, blancs comme la neige, et mettaient notre vue à l'aise en diminuant de moitié la hauteur apparente du point où nous, étions. La blancheur éblouissante de ce plancher flottant affaiblissait beaucoup la vivacité des couleurs d'un arc-en-ciel qui doit nécessairement paraître couché dessus ; mais on le reconnaissait néanmoins et nous fûmes quelque temps muets, immobiles; nous étions tout yeux. » Scientifiquement, Monge conclut que la hauteur de la montagne de Barèges au-dessus du seuil de la paroisse de Luz « est de vingt fois le clocher de Mézières ».
Le 29 août, une bande composée de M. et Mme d'Arcet, de Monge et d'un chirurgien logé dans la même maison que M. de Ramsault, part pour Cauterets, où Monge va dîner chez l'évêque de Dijon, « qui le comble d'honnêtetés ». Aussitôt revenus à Barèges, ils transportent leurs observations au pic du Midi de Bigorre. Monge profite de l'occasion pour examiner s'il y a une faune dans les lacs des hautes altitudes et y trouve des salamandres. Il recueille également de la glace pour se rafraîchir en route et, arrivé au sommet, il jette le reste, en lui disant par une plaisanterie bien géographique : « Il t'est libre de couler dans le Gave ou dans l'Adour; mais, quelque route que tu prennes, ton sort est d'aller laver les murs de Bayonne ! » Ils gravent « le nom de la dame compagne de leur expédition sur le rocher le plus éminent » et font leurs relevés barométriques.
Ces observations parurent, l'année suivante, en annexe à une thèse inaugurale de d'Arcet pour l'installation de la chaire de chimie au Collège de France : « Discours en forme de dissertation sur l'état actuel des montagnes des Pyrénées et sur les causes de leur dégradation. » Le manuscrit, entièrement de la main de Monge, et une lettre écrite à M. du Marchais montrent que ces observations barométriques, publiées sous les deux noms de d'Arcet et de Monge, sont en réalité presque entièrement l'œuvre de Monge. Monge écrit, en effet, à son ami qu'il a laissé ses observations à M. d'Arcet, « qui l'avait aidé à les faire et qui les a fait imprimer ». Il ajoute qu'il n'en a pas eu un seul exemplaire et qu'il va chercher le moyen de lui en procurer un.
A la fin de septembre 1774, les voyageurs rentraient à Mézières et Monge commençait la préparation des élèves à l'examen de l'abbé Bossut. En cette même année 1774, il composa pour un de ses amis un grand cadran horizontal, avec courbe méridienne du temps moyen, qui, longtemps après, fut un jour découvert à Mézières dans une boutique de friperie par Hachette, l'élève de Monge, et installé par Monge au château de Pommard.
L'année 1775 fut employée par Monge à quelques travaux mathématiques, notamment « sur les surfaces développables, avec application à la théorie des ombres » [Dans une lettre à Condorcet du 16 septembre 1776, il écrit: « Il suit, du mémoire de M. Lagrange, qu'il n'y a point d'équation qui ne soit l'intégrale particulière d'une infinité d'équations différentielles du premier ordre, parce qu'il n'y a pas de courbes qui ne soient tangentes à une infinité de familles d'autres courbes »]. Elle fut aussi marquée par la mort de son père, pour lequel il avait une profonde vénération, mais qu'il ne voyait plus que de loin en loin, comme c'était l'habitude d'un temps où les communications restaient difficiles et, dans le peuple, peu usitées (septembre 1775). Monge, en remerciant le baron de Joursanvault qui lui avait appris la nouvelle, parle « des voyages réguliers qu'il avait précédemment résolu de faire en Bourgogne », sans aucune allusion à sa mère qui, cependant, vivait encore. Le 1er janvier suivant, ses appointements furent portés à 3 000 livres et il devint officiellement professeur de physique, de mathématiques pratiques, de chimie et d'histoire naturelle.
La physique commençait à l'attirer de plus en plus. Il était entré en relations avec Lavoisier, chez lequel il fit, avec Vandermonde, le 4 février 1777, les expériences dont le manuscrit subsiste : expériences sur le refroidissement dans le vide de la machine pneumatique. Ce travail dut avoir lieu à l'occasion d'un froid intense qui avait sévi en 1775-1776. L'Académie avait chargé une commission comprenant Lavoisier, Vandermonde et Bezout [Bezout, examinateur à l'École militaire de Paris et examinateur à l'École de Marine, poste où Gaspard Monge lui succéda en 1783 (voir Grimaud, LAVOISIER, p. 129) ] de lui résumer les observations faites à ce sujet, en les comparant à celles de l'hiver 1709, également rigoureux. La commission traita la question à fond en étudiant les causes d'erreur des thermomètres et indiquant les moyens de les construire sur des principes fixes et invariables. Elle présenta finalement à l'Académie douze thermomètres étalons, dont six devaient être conservés comme témoins dans des établissements publics.
C'est en cette année 1777 que se place le mariage de Monge. Je ne puis mieux faire que d'en emprunter le récit à Arago, évidemment informé de première main. On y constate, dans un cas d'une gravité particulière, cette vivacité de sursaut devant l'injustice et la vilenie que le géomètre a montrée plus tard tant de fois :
« Dans un salon de Mézières, certain personnage, infatué de son mérite et de sa fortune, racontait, comme une chose à peine croyable, que la belle Mme Horbon n'avait pas voulu l'accepter pour mari. « Au reste, ajoutait-il en s'efforçant de rire pour égayer ses auditeurs, je m'en suis bien vengé. Des historiettes de ma façon, que j'ai répandues dans la ville et aux alentours, ont déjà empêché la dédaigneuse veuve de contracter un autre mariage. » Monge ne connaissait pas Mme Horbon. Il n'en écarta pas moins rudement avec les mains et les coudes la foule, toujours si prompte à se grouper autour des médisants, alla droit à l'épouseur éconduit et, d'un ton d'autorité qui n'admettait point de délai dans la réponse, il lui posa cette question : « Est-il vrai, Monsieur (j'ai besoin de vous l'entendre répéter), est-il vrai que vous ayez essayé de nuire à une faible femme, en colportant des anecdotes dont vous connaissiez la fausseté ? — Cela est vrai ; mais que vous importe ? — Je vous déclare un infâme, reprit Monge d'une voix retentissante. » Et l'action, aussi prompte que la foudre, accompagna cette exclamation... »
Je résume la fin de l'anecdote, qui paraît avoir été légèrement arrangée par le narrateur. Le drôle, souffleté, néglige de demander réparation. Mme Horbon, veuve d'un maître de forges de Rocroi et habitant cette ville, avait des cousins à Mézières. Monge, quelque temps après, la rencontre dans un salon et, s'attachant à elle pour l'avoir défendue, finit par demander sa main. Leur âge était à peu près le même, vingt-neuf ans et trente et un ans. Mme Horbon qui, paraît-il, ignorait l'incident, hésite d'abord. Elle s'informe, apprend l'estime dont jouit le jeune professeur, mais s'inquiète encore de lui imposer la liquidation difficile de son premier mari. Monge plaide chaudement sa cause. La liquidation : il a résolu dans sa vie des problèmes bien plus difficiles! La situation de fortune modeste qu'aura le ménage : il tâchera de l'améliorer par son travail! Finalement, le 12 juin 1777, Mme veuve Horbon, née Marie-Catherine Huart, devenait, à Rocroi, Mme Monge et, dans les deux années suivantes, elle lui donnait deux filles : Jeanne-Charlotte-Émélie [L'acte de baptême orthographie Émélie] (plus tard Mme Marey) et Louise-Françoise (Mme Eschassériaux).
Ce mariage modifiait, à tous égards, la position de Monge. Avant tout, il lui créait une vie de famille et des relations de parenté qu'il ne connaissait plus depuis bien des années. Son père était mort, on l'a vu, depuis deux ans. Sa mère vieillissait et ne vint même pas à Rocroi pour le mariage. Ses frères étaient partis à l'autre bout de la France. Au contraire, Mme Horbon avait encore son père, sa mère, des oncles, une sœur et de nombreux cousins... Même, pécuniairement, elle apportait un commencement d'aisance. D'après son contrat passé à Bay, sa dot comprenait une forge, des bois et 50 000 livres en créances. Rocroi n'est pas bien loin de Mézières. Monge alla s'y établir un moment maître de forges, afin de tirer au clair la situation. Cinq mois après, il écrivait à du Marchais que ce métier nouveau le distrayait considérablement des mathématiques, mais que ce ne serait sans doute qu'une trêve [Biographie Eschassériaux. Lettre du 22 novembre 1777]. Il était encore à Rocroi quand, le 7 mars suivant, naquit sa première fille.
En réalité, le changement dans sa mentalité était plus profond qu'il ne le croyait lui-même. Quelques années après, le 24 juin 1783, il écrira au même ami du Marchais que, depuis quatre ans, il ne s'occupe plus de mathématiques : « Les circonstances m'ont jeté sur la physique et toutes les autres considérations me sont devenues presque étrangères. » Les circonstances dont il parle n'ont, d'ailleurs, probablement fait qu'accélérer une évolution fréquente, surtout à cette époque, et dont je me suis déjà trouvé étudier un autre exemple célèbre avec Ampère. Ampère, comme Monge, avait commencé par être un mathématicien. Plus tard, il a écrit des lettres où il exprimait Son passage des mathématiques à la physique : ce qui ne veut pas dire que l'un comme l'autre n'aient pas, à l'occasion, continué à chercher quelque problème d'algèbre. On peut ajouter que tous deux ont subi, dans la suite, une troisième transformation pareille. La dernière partie de la vie de Monge fut entièrement consacrée à la politique et celle d'Ampère à la philosophie, qui est sœur de la politique entendue dans un bon sens. Les hautes mathématiques exigent une fraîcheur d'imagination et une absorption continue dans un rêve abstrait qui disparaissent souvent avec l'âge mûr.
Cette adaptation de Monge au métier de maître de forges eut une autre conséquence plus directe, celle de préparer ce géomètre au rôle de praticien -qu'il devait remplir avec gloire pendant la Révolution, en particulier pour le travail du fer.
Les notes données à Monge en cette fin d'année 1777 par son directeur, M. de Villelongue, caractérisent bien son allure : « Très savant, doux, sage, complaisant, honnête; se livre avec le plus grand zèle à l'instruction des élèves. » Cependant, Monge prenait tournure de personnage officiel. Au baptême de sa seconde fille Louise, le 30 juin 1779, il pouvait se qualifier : « Membre de la Société royale de Turin, correspondant de l'Académie royale des Sciences, professeur royal des mathématiques, physique et chimie à l'École royale du génie. »
Au même moment, il écrit une longue lettre à Lavoisier pour lui annoncer un envoi de minéraux et discuter sur la nature de la lumière produite par le choc de deux pierres vitrifiables. De plus en plus passionné pour les études physico-chimiques, il demande et obtient 4000 livres pour l'installation d'un laboratoire de chimie, et nous verrons tout à l'heure l'administration lui reprocher d'avoir délaissé l'École au moment où elle avait fait pour lui cette grosse dépense.
Le début de l'année 1780 marqua une nouvelle étape. Le 12 janvier, Monge était proposé par l'Académie des Sciences « en première voix » pour la place d'adjoint-géomètre, en remplacement de Vandermonde, passé associé. Le roi ayant ratifié ce choix le 15 avril, Monge vint siéger pour la première fois à l'Académie le 19. Il prit alors un appartement meublé dans l'hôtel Bellevue, au bout de la rue de Turenne, et s'y installa pour l'hiver. En même temps, son protecteur, le duc de Castries, ministre de la Marine, le nommait adjoint à Bossut, qui professait l'hydrodynamique au Louvre, en le chargeant d'enseigner l'hydrographie. [Le cours de l'abbé Bossut avait été lui-même créé quelques années auparavant par Turgot, sur la demande de d'Alembert et Condorcet]
Nous trouvons donc, à partir de cette époque, Monge assistant aux séances de l'Académie, chargé de ses rapports et professant au Louvre, devenu en un mot Parisien, ainsi que l'exigeait le règlement de l'Académie pour les adjoints. Mais, où la situation se compliquait, c'est que ses amis prétendaient lui conserver en même temps ses appointements de Mézières et, par conséquent, son cours à l'École du génie. Aujourd'hui, avec les chemins de fer, ce serait difficile ; avant eux, il semble bien y avoir eu quelque incompatibilité, et c'est ainsi que l'envisagea plus tard, expérience faite, la direction de l'École en y apportant de plus en plus d'impatience à mesure que la situation se développa et s'accentua.
[Si les voyages étaient plus difficiles et plus longs avant les chemins de fer, on y mettait plus de patience et nous sommes souvent étonnés de voir comme on pouvait rouler d'un bout à l'autre de la France ou même de l'Europe. Quand on prétendit installer l'École des Mines à Moutiers en Savoie, on adopta pour les professeurs une solution analogue à celle de Mézières. Ils venaient seulement à Moutiers deux ou trois mois par an.]
Mais, au début, chacun y mit de la bonne volonté. On admit des deux parts que six mois de séjour dans chaque endroit justifieraient ce cumul. Le 19 février 1780, l'abbé Bossut, dont on retrouve partout l'influence efficace dans ces débuts de Monge, écrivait le mémoire suivant :
« M. l'abbé Bossut, de l'Académie royale des Sciences, examinateur des élèves de l'École du Corps royal du génie, représente que le sieur Monge, professeur de mathématiques de ladite École, venant d'obtenir la place d'adjoint qui vaquait dans la classe de géométrie de l'Académie, les fonctions de cette place exigent que le sieur Monge passe désormais une partie l'année à Paris ; que, d'un autre côté, l'École du génie doit désirer de conserver autant qu'il est possible un sujet d'un mérite aussi distingué. Pour concilier les deux objets, M. l'abbé Bossut propose de laisser au sieur Monge le titre et l'emploi de professeur de mathématiques à l'École du génie et de lui donner pour adjoint son frère dont il garantit la capacité et les talents. Le sieur Monge cadet sera toute l'année à Mézières et le sieur Monge l'aîné pendant six mois seulement. Le traitement du sieur Monge étant de 3 000 livres, M. l'abbé Bossut propose que celui de l'adjoint devra être de 1500 livres. M. de Caux de Blacquetot, commandant en chef de l'École, vient à l'appui de ces représentations et les trouve en tout conformes au bien du service. »
La pièce originale porte en marge, d'une autre écriture, la réponse de l'autorité supérieure : « Bon pour mille livres »
C'est là, pour nous, la première apparition de Louis Monge, dont la similitude de nom et d'occupations avec son illustre frère a entraîné les historiens en beaucoup d'incertitudes et quelques erreurs. Docteur en théologie de la Faculté de Valence, ancien professeur à l'École militaire de Paris et mis à pied par suite d'une réforme en 1777, Louis Monge devait, en effet, suppléer son frère aîné à Mézières du 1er janvier 1780 au 17 novembre 1781, pour revenir ensuite passer cinq ans à l'École militaire de Paris, où il eut comme élève Bonaparte, et devenir plus tard, pendant de longues années, le suppléant de son illustre frère comme examinateur de la Marine. Son dossier marque, à la date du 26 octobre 1781, que le maréchal de Castries, ministre de la Marine et protecteur de son frère, étendait également sa protection sur lui.
Dès lors, Monge va mener, pendant quatre ans, une existence en partie double, où Mézières devient de plus en plus accessoire et passe peu à peu à l'état de villégiature. A Paris, son adresse est maintenant rue du Sépulcre (rue du Dragon). Sur l'Almanach royal de 1781, il figure comme « adjoint en survivance à l'Académie pour la géométrie, professeur royal de physique expérimentale à l'École du génie, professeur royal d'hydrographie », tandis que l'abbé Bossut, devenu pensionnaire ordinaire, est qualifié « examinateur du Corps royal du génie, inspecteur général des machines et ouvrages hydrauliques des bâtiments du Roi, professeur royal d'hydrodynamique ».

Une grande partie de son temps est, depuis lors, occupée par le travail académique, dont on se ferait une idée très fausse si l'on en jugeait par ce qu'il est devenu aujourd'hui. L'Académie des Sciences actuelle n'est plus qu'un cercle honorifique et un office d'enregistrement, où l'on ne discute jamais aucune question qui ne soit électorale et où presque le seul travail consiste à résumer verbalement des notes peu écoutées. Cela tient beaucoup à la publicité des séances et à l'influence croissante du journalisme. Au dix-huitième siècle et dans la première moitié du dix-neuvième siècle, il n'en était pas de même. Les séances, ayant lieu à huis clos, étaient plus libres. Les connaissances scientifiques étaient moins spécialisées. La matière était moins abondante, le temps pressait moins et les discussions occupaient une grande place, comme cela se passe encore dans beaucoup de sociétés savantes. Mais, surtout, l'ancienne Académie était un véritable office des inventions, auquel on soumettait toutes les idées nouvelles et que l'on consultait sur toutes les découvertes. Chaque travail déposé donnait lieu à la nomination d'une commission et l'un au moins des trois commissaires était forcé de rédiger un rapport écrit demandant une étude approfondie de la question. Un académicien avait ainsi à faire chaque année dix ou quinze rapports sur les sujets les plus variés. Je cite au hasard quelques-uns de ceux dont fut chargé Monge à ses débuts ; en 1780 : mémoire sur la poussée des vents; machines à curer les ports, à moudre le grain, à monter les eaux; sur la possibilité de voler en l'air comme les oiseaux ; sur les limites de certaines fonctions algébriques ; sur le mouvement des rivières ; sur le calcul des probabilités; en 1781 : machines diverses; sur le froid de 1776; calcul des chances; machine à remonter les bateaux; moulins à sucre; théorie des torrents et des rivières et moyen d'empêcher leurs ravages; en 1786 : machine mue par le flux et le reflux de la mer ; machine à remorquer les bateaux ; fourneau pour les essais de minerais; pressoir; chaudières, etc., etc. Il serait fastidieux de prolonger cette énumération relative à des rapports dont la liste complète peut être consultée dans les procès-verbaux de l'Académie et dont les expéditions subsistent souvent dans les archives. Mais ces quelques exemples montrent assez à quelle gymnastique intellectuelle étaient alors soumis les académiciens. Elle accuse en même temps le rôle utile de cette Académie royale qui précéda l'Institut et fait mieux comprendre comment, le jour du danger venu pour la patrie, un Monge, un Berthollet se sont trouvés tout naturellement passer de leurs études, qui n'étaient pas exclusivement théoriques, à des réalisations pratiques.
Pour satisfaire à ce labeur académique, Monge passait à Paris les mois d'hiver du 15 novembre au 15 mai; après quoi, il retournait séjourner à Mézières pendant l'été. Afin d'accroître ses ressources devant des charges de famille croissantes, il avait signé le 23 janvier 1781 avec l'éditeur Panckoucke un traité par lequel il s'engageait à lui fournir un dictionnaire de physique moyennant 24 livres par feuille. Ce traité devait être remanié le 25 novembre 1788 en portant le prix de la feuille à 36 livres et aboutir finalement à une peu importante collaboration.
Comme travail plus personnel de cette période, il suffit de mentionner un mémoire du 28 mars 1780 sur les déblais et remblais et une note du 13 mars 1782 sur des expériences électriques de Volta. Un rapport fait le 15 janvier 1783 sur un travail de Prony donna à Monge l'occasion de manifester ce dévouement pour la jeunesse qu'il pratiqua toute sa vie. La solidité du pont de Neuilly, construit par Perronet sur des principes nouveaux, avait été discutée. Perronet avait osé substituer à la forme ordinaire arceau une forme horizontale. Le jeune Prony démontra par le calcul de la poussée qu'il avait eu raison. Monge, nommé commissaire, s'intéressa à Prony et lui donna pendant quelque temps des leçons trois fois par semaine.
Mais cette année 1783, en amenant une amélioration dans sa position parisienne, devait lui créer à Mézières de grosses difficultés. Bezout, examinateur des élèves de la Marine, ou, comme on disait alors, des gardes du Pavillon, étant mort, Monge, par la protection persévérante du maréchal de Castries, obtint la place, qu'il devait conserver pendant seize ans, à travers des vicissitudes très diverses. Il lui arriva, en cette occasion, d'être préféré à l'abbé Bossut, son autre protecteur fidèle, plus âgé que lui et plus ancien l'Académie.
[Le 16 novembre 1783, Monge en remerciait le maréchal de Castries par une lettre conservée aux Archives de la Marine.]
Cette manifestation d'ambition, peut-être légitime mais un peu impatiente, amena entre eux un refroidissement que les ennemis de Monge, comme Mme Roland, lui ont vivement reproché. Monge s'efforça, d'ailleurs, plus tard, d'assurer des compensations à l'abbé Bossut et lui fit attribuer une place à l'École polytechnique lorsque son influence y fut dominante.
[Dans une lettre à du Marchais du 24 juin 1783, il dit que son cours de physique et ses occupations à l'École absorbent tout son temps. « Depuis quatre ans, il ne s'occupe plus de mathématiques. Les circonstances l'ont jeté sur la physique et toutes les autres considérations lui sont devenues étrangères. »]
Une lettre de remerciements écrite le 2 octobre 1783 à Vandermonde montre la part que Vandermonde et Pache avaient prise à cette nomination en intervenant auprès du maréchal de Castries :
« Que vous êtes de dignes amis, vous et M. Pache, mon très cher ami, et quelles obligations ne vous ai-je pas ! M. Pache m'avait déjà mandé l'événement et informé des espérances que je pouvais concevoir et que vous m'assurez pour ainsi dire dans votre lettre. Si les arrangements dont nous parlions cet hiver s'étaient exécutés, le plaisir qu'ils m'auraient fait n'aurait pas été altéré par des idées chagrinantes qui sont inséparables de ceux-ci. Je ne ferai rien sans vous prévenir, mon cher ami, ou plutôt vous ferez tout et je ne ferai rien... Je n'avais pas l'intention de faire parler de moi dans les journaux ; mais la circonstance présente peut le rendre nécessaire pour justifier le choix du ministre. Aussi, je vous mande à la hâte les nombres de mes expériences... » Les nombres dont il s'agit sont les poids d'hydrogène et d'oxygène combinés pour former de l'eau, comme je l'expliquerai bientôt : expérience dont la valeur constituait, en effet, un titre sérieux.
Le rapport du maréchal de Castries, au bas duquel Louis XVI a écrit « Bon », disait : « Parmi les membres de l'Académie des Sciences qui se présentent pour la place d'examinateur des gardes du Pavillon et de la Marine vacante par la mort du sieur Bezout, on n'en voit pas de plus capable de la remplir que le sieur Monge, par les talents et les qualités morales qu'il réunit. Sa Majesté est supplié de l'agréer. »
Cette nomination de Monge comme examinateur de la Marine, le départ antérieur de son frère Louis, remplacé à Mézières par un suppléant moins commode, peut-être aussi les torts envers l'abbé Bossut que l'on aimait fort à Mézières et qui, comme examinateur, y jouait un grand rôle, accentuèrent à partir de ce moment l'hostilité que la direction de cette École avait commencé à manifester contre lui. Pendant deux ans, l'École va demander avec une insistance tout administrative qu'il remplisse réellement et complètement des fonctions pour lesquelles, on le fait remarquer avec aigreur, il croit bon de toucher une rétribution, et, en fait, cette lutte de deux ans va, nous allons le voir, se terminer par le départ de Monge.
La correspondance officielle, remplissant un volumineux dossier aux Archives de la Guerre, témoigne, on va en juger, d'une exaspération croissante.
Au début, le directeur des Fortifications, de Caux de Blacquetot, s'imagine, ou feint de s'imaginer que la nomination de Monge comme examinateur de la Marine va régler définitivement une situation préjudiciable à l'École et le débarrasser d'un savant qui a sans doute les plus grands mérites, mais qui, pareil à la jument de Roland, y joint le tort d'être mort pour son enseignement. Le ministre rectifie ses idées et, le 22 novembre 1783, M. de Caux récrit au maréchal de Ségur pour s'étonner que Monge reste à la fois à Mézières et à la Marine : « Puisque M. Monge conserve la place de professeur à Mézières, la justice et l'avantage des élèves de l'École du génie demandent qu'il remplisse les devoirs de sa place... L'adjoint ne peut pas seul suffire à expliquer les choses tout à fait nouvelles à plusieurs jeunes gens qui n'ont pas le même degré d'intelligence... D'ailleurs, le professeur ayant 3000 livres d'appointements, tandis que l'adjoint n'a que 1 000 livres, le premier est obligé bien plus étroitement que le second de se livrer tout entier à l'enseignement pour lequel il est payé... En conséquence, je vous supplie de vouloir bien prononcer que M. Monge soit tenu de se rendre tous les ans à Mézières dans les premiers jours de janvier et d'y rester jusqu'au commencement d'octobre, à l'effet de se donner tout entier à l'instruction de l'École, comme son devoir l'exige... »
Le 26 novembre 1783, le commandant en chef M. de Villelongue appuie ses observations par une longue lettre autographe adressée personnellement à M. de Fourcroy, maréchal de camp, où l'on trouve, avec les mêmes arguments, quelques détails plus précis :
« Plus M. Monge a de talents, plus il m'est douloureux de les voir inutiles à l'instruction de nos élèves. C'est malheureusement ce qui nous arrive depuis que M. Monge est de l'Académie; car, ne venant ici qu'en été, dans le temps que des levers de toute espèce, des reconnaissances de terrain, le simulacre de siège, etc., nous appellent au dehors, comment peut-il donner des leçons sur les autres parties qui sont particulièrement de son ressort?
Lui-même, avant de partir en dernier lieu pour Paris, a dit à M. de Sanlot, de qui je le tiens, qu'il sentait très bien qu'étant examinateur de la Marine, il ne pourrait garder la place de professeur à Mézières, qui allait de droit à M. Ferry. [Passage souligné dans l'original] Comment, après cet aveu, a-t-il pu vouloir la conserver?
« Puisqu'il tient si fort aux appointements de cette place, il doit les mériter en en remplissant les devoirs avec l'assiduité et le zèle dont doit être animé un homme qui a quelque délicatesse. Pour cela, il est indispensable qu'il se rende à Mézières le 1er janvier et y reste jusqu'au 1er octobre. L'adjoint modiquement payé qu'on lui donne le secondera pendant ces neuf mois et le suppléera le reste de l'année. S'il répugne à cet arrangement qui est de toute justice et qu'on doit exiger rigoureusement de lui, il faut qu'il remette un emploi qu'il refuse de remplir. Ce n'est point un bénéfice simple et les fonctions en sont trop essentielles pour être négligées... Je suis assuré que vous voudrez bien employer tout votre crédit pour que le Roi soit servi pour son argent comme il doit l'être et pour que l'instruction de l'École ne soit pas sacrifiée à l'intérêt personnel... »
A ce moment, Monge lui-même croit devoir intervenir pour proposer une solution un peu différente. Le 12 décembre 1783, il écrit à son protecteur le maréchal de Castries afin que celui-ci suggère au maréchal de Ségur, ministre de la Marine, de lui conserver seulement sa place de professeur de physique en supprimant le cours de mathématiques et lui laissant les mêmes appointements de 3000 livres qu'avait eus pour ce seul cours son prédécesseur, l'abbé Nollet. Au fond, le désir de Monge était de passer l'hiver à Paris et d'aller, pendant les vacances d'été, donner quelques leçons à Mézières. La correspondance interministérielle se continue par une lettre du ministre de la Guerre au ministre de la Marine du 18 juillet 1784, où l'on admet de laisser Monge à Paris pendant les mois de janvier à avril, pourvu qu'il consacre à Mézières les huit autres mois, « absolument nécessaires à l'instruction des élèves... S'il en était autrement et si son état d'académicien ne permettait pas qu'il se livrât tout entier à cette instruction, il faudrait alors qu'il optât » .
Le maréchal de Castries pesait d'un poids très fort dans la balance en faveur de Monge.
[Déjà une lettre du 26 octobre 1781 au ministre de la Guerre, proposant de titulariser Monge, rappelle qu'il a été recommandé par M. de Castries.]
Le département de la Guerre abandonna deux mois par la décision suivante écrite en marge de cette pièce : « Il doit passer les six premiers mois à Mézières et le reste à la disposition du département de la Marine. » Après quoi, il accentua encore sa retraite en laissant Monge à Paris pendant avril et mai et se bornant finalement à exiger sa présence en janvier, février, mars, juillet, août et septembre.
Cette convention elle-même ne fut pas longtemps respectée. Nous connaissons tous cette maladie de l'absentéisme, comparable au vote par procuration des députés, qui fut un moment si répandue dans notre enseignement supérieur. On lui fait difficilement sa part. D'après un rapport de la Direction, Monge, dans cette année 1784, arriva à Mézières le 4 janvier. Deux lettres écrites par lui à Vandermonde confirment, en effet, qu'il s'est trouvé retardé par un accident de route et parlent d'expériences chimiques de son répétiteur Clouet qu'il continue. Il suivit alors le travail des élèves de la stéréotomie et la coupe des pierres et des bois jusqu'au 1er avril. Il commença enfin cours de physique qui était seulement aux deux tiers achevé quand il l'interrompit le 15 mai pour aller faire passer les examens de la Marine à Rochefort et à Brest.
[Le 5 mai, le ministre de la Marine avait prié le ministre de la Guerre de lui onner un congé à cet effet.]
Il étudia à cette occasion le défrichement du marais poitevin [biographie Eschassériaux], revint à la fin de juin à Paris, y assista aux séances de l'Académie et ne rentra à Mézières que le 11 septembre, alors que les élèves étaient occupés dans la campagne et ne pouvaient plus suivre la fin de son enseignement. D'où lettres indignées du commandant en chef de Villelongue au secteur des Fortifications de Caux et de celui-ci, le 21 septembre, au ministre de la Guerre, le maréchal de Ségur. Cette dernière lettre, sur laquelle le maréchal a écrit en marge « m'en parler », commence ainsi :
« Monseigneur, M. de Villelongue, commandant l'École du Corps royal du génie, vient de faire part que le sieur Monge, professeur à ladite École, venait de reparaître pour y rendre, dit-il, six semaines qu'il redoit des six mois de présence que vous lui avez ordonnés à Mézières. Ce commandant observe avec raison l'indécence de la conduite de ce professeur qui vient à l'Ecole dans un temps où il sait que sa présence est inutile, vu que les élèves sont occupés au simulacre de siège et qu'immédiatement après ils doivent subir l'examen. Ce professeur vient marquer un zèle apparent pour venir à son but qui est de jouir d'appointements sans les mériter. Je vous avais déjà prié, Monsieur le Maréchal, de mettre fin à ce désordre en faisant opter le sieur Monge, soit pour la Marine ou pour la terre... »
Et, la solution désirée n'étant pas encore intervenue, il envoie de nouveau le 10 octobre une longue lettre avec mémoire annexe, dans laquelle se trouve cette phrase qui donne le fond de l'affaire : « Vous verrez, dans le mémoire, le tableau des obligations que M. Monge est tenu de remplir envers l'École et qu'il cherche à éluder par toutes sortes de moyens. On assure que M. le maréchal de Castries prend intérêt à lui. Les motifs de cet intérêt ne peuvent être que très respectables. Mais il n'est pas possible que M. le maréchal de Castries, dont tout le monde connaît l'intégrité et le zèle rigide à faire observer les lois et la discipline dans toutes les parties de son administration, approuve et protège une infraction manifeste à des devoirs sacrés, pour lesquels M. Monge jouit de 3 000 livres de traitement... »
Cette fois encore, M. de Caux appuya le commandant par une lettre très développée, sur laquelle on lit cette solution bien ministérielle des questions délicates : « Ce mémoire a été lu à Monseigneur, qui n'a rien décidé. »
L'affaire se perpétuait quand, le 6 décembre 1784, fut envoyé au ministre le tableau des propositions relatives aux professeurs et employés de l'École, avec nouvelles réflexions pénibles sur Monge. A ce moment, le dénouement intervint enfin. Le maréchal de Castries demanda pour Monge une retraite de 1 000 livres, en échange de laquelle il abandonnerait son cours de Mézières à son suppléant Ferry. La proposition passa le 20 décembre 1784 au travail du Roi. Louis XVI y écrivit de sa main: « Bon », sans pouvoir se douter que cet employé, auquel il accordait par grâce une retraite, signerait huit ans après l'ordre de le conduire à la guillotine. Le brevet, daté du 24 décembre 1784, accorde la somme de 1 000 livres de pension sans retenue au sieur « Gaspard de Monge » comme marque de la satisfaction qu'a eue Sa Majesté de la manière dont il a rempli la place de professeur de mathématique pratique, physique à l'École royale du génie de Mézières ».
[L'École de Mézières fut transférée à Metz, le 12 février 1794. Après la guerre de 1870, l'École de Metz est devenue l'École de Fontainebleau.]
M. de Caux de Blacquetot était très vif, comme il lui arriva un jour de le montrer en mettant aux arrêts de rigueur le lieutenant Lazare Carnot, pour une aventure de jeunesse dont on lui avait exagéré les torts. Le commandant de Villelongue était également peu patient. On conçoit aisément qu'après cette longue lutte pour éliminer un professeur dont on ne pouvait obtenir un cours sous prétexte qu'il était académicien, l'un ou l'autre ait prononcé, avec un soupir de soulagement, le propos rapporté par la malveillance d'Arago sans le contexte qui l'explique : « Il nous faut remplacer Monge par un homme qui ne soit personne ! »

| Table des matières | Chapitre suivant |