
Très florissantes sous les Gaulois, nos mines métalliques avaient été délaissées depuis l'époque romaine, reprises avec quelque activité au XIVe et au XVe siècle, puis abandonnées encore pour les fabuleuses richesses de l'Amérique. Mais, vers la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe, il semble que, désappointés par l'épuisement des métaux précieux, les mineurs se soient tournés vers des produits plus communs, mais aussi plus abondants : la houille et le fer. Dès le milieu du XVIIIe siècle, Anzin est en pleine production, de nombreuses mines métalliques, comme Poullaouën, sont activement exploitées; on s'attaque de tous côtés aux minières de fer, et au moment où va être fondée l'Ecole des Mines, le bassin de Briey, pour ne citer qu'un exemple [Mémoire sur la conversion des fers lorrains en acier, par M. Nicolas, professeur royal de chymie en l'Université de Nancy (1783, Bibl. de l'Ecole des Mines) ], ne compte pas moins de dix mines de fer avec forges en pleine prospérité!
Inquiet de voir ces nouvelles exploitations se développer à l'aventure au risque de gaspiller leurs gîtes, l'intendant des Finances Trudaine, cet administrateur avisé qui avait fait retirer aux propriétaires du sol le droit d'exploiter les mines de houille dans leurs fonds, eut la pensée d'organiser un service de surveillance des exploitations minières. Comme les éléments n'en existaient nulle part en France, il fallait former de toutes pièces un personnel apte à remplir cet emploi. Ne croyant pas encore le moment venu de fonder une véritable Ecole des Mines, à l'exemple de celles qui existaient depuis longtemps en Allemagne, Trudaine, conseillé, semble-t-il, par Hellot, essayeur en Chef de la Monnaie à Paris, se contenta d'utiliser l'Ecole des Ponts et Chaussées qu'il venait de créer en 1747, et offrit aux directeurs de mines l'entrée de cette nouvelle école pour les jeunes gens qu'ils croiraient devoir recommander.
Dans le plan de Trudaine, l'instruction technique des futurs ingénieurs des Mines, admis à l'Ecole des Ponts et Chaussées, devait être complétée par un cours spécial de chimie et par des voyages dans les meilleurs établissements miniers et métallurgiques, en France et à l'étranger. C'est ainsi que furent formés les deux premiers Inspecteurs des Mines de France, que l'on peut considérer comme l'avant-garde de notre « Corps des Mines » : Jars, l'auteur des célèbres Voyages métallurgiques, que nos élèves peuvent encore prendre comme modèles de leurs journaux de voyage, et Guillot-Duhamel père, qui après avoir dirigé des forges dans le Limousin, pour le compte du duc de Broglie, devait être le premier professeur d'exploitation et de métallurgie de notre Ecole. Ce n'est donc pas d'hier que les Ecoles des Ponts et Chaussées et des Mines sont des « écoles soeurs », comme nous aimons à les appeler; elles ont eu le même berceau, et sont bien du même sang!
Le modeste recrutement des inspecteurs des Mines envisagé par Trudaine pouvait suffire à l'aurore de l'ingérence, encore discrète, de l'Etat dans les entreprises industrielles; mais il parut bientôt ne plus répondre au développement croissant des exploitations minières.
Elargissant les visées de son prédécesseur Hellot, le chimiste et minéralogiste Balthasard-Georges Sage, né à Paris le 7 mai 1740, commissaire aux essais à la Monnaie, rêve de fonder à la Monnaie même une école des Mines, distincte de celle des Ponts et Chaussées, d'en être le directeur, en même temps que le professeur principal et d'y installer ses riches collections de minéraux. Loué par les uns, combattu par les autres, le projet de Sage reçoit un commencement d'exécution par la création à l'Hôtel des Monnaies, suivant lettre patente du 11 juin 1778, d'une école publique et gratuite de minéralogie et de métallurgie « docimastique », pour permettre aux entrepreneurs des mines de France « de n'être plus réduits à recourir à des étrangers pour les mettre à la tête de leurs exploitations ».
Il peut nous paraître singulier que le premier projet d'une école des Mines en France n'ait prévu pour la constituer qu'une chaire unique avec un chimiste comme titulaire, et que les protagonistes de ce projet aient été deux chimistes de la Monnaie. On se l'explique mieux si l'on considère l'état des connaissances acquises à cette époque dans l'élaboration des minerais et la production des métaux utilisables. Ces connaissances n'étaient pas encore sorties d'un empirisme très lointain, et les idées les plus bizarres régnaient alors sur l'origine des qualités ou des défauts de chaque métal, notamment du fer et de l'acier : c'est ainsi que le promoteur de notre école, Sage, attribuait la fragilité des fers aigres à une certaine proportion de zinc, et considérait au contraire le phosphore, qui était le vrai coupable, comme un élément indispensable à la qualité des bons aciers. De pareilles erreurs tenaient à ce qu'on ignorait presque tout de la composition exacte des minerais, en dehors du métal qu'on en retirait, et c'est par chance que telles régions fournissaient de bons aciers, tandis que d'autres semblaient vouées à la production de métal médiocre.
Toutefois, mineurs et métallurgistes commençaient à soupçonner que la composition chimique devait être un facteur essentiel des propriétés physiques des métaux, et c'est ainsi que le chimiste suédois Bergmann, dans un opuscule sur la cause de la fragilité du fer froid publié en 1781, mettait pour la première fois les qualités respectives du fer, de l'acier et de la fonte en parallèle avec les teneurs du métal en carbone, silicium et manganèse. On comprend donc que la principale préoccupation de nos fondateurs ait été l'analyse chimique et son application à la métallurgie. D'autre part, l'analyse minérale, réduite encore aux procédés de voie sèche des métallurgistes, n'était guère pratiquée à ce moment que par les minéralogistes et les essayeurs : on comprend ainsi que ce soient des essayeurs de la Monnaie qui aient eu, les premiers en France, l'idée de créer une école des Mines, et d'en faire préluder l'enseignement par la « docimasie », ou chimie analytique.
Ce ne fut pas sans peine que Sage obtint des pouvoirs publics d'être le titulaire de la nouvelle chaire de « minéralogie et métallurgie docimastique » et de la faire installer dans l'Hôtel de la Monnaie. Monnet, l'un des premiers inspecteurs des Mines, chimiste rival de Sage, avait mis en jeu toutes les influences dont il disposait pour faire créer à son profit cette chaire à Paris, au Jardin du Roi.
Le maître des requêtes Valdec de Lessart, suggestionné sans doute par Sage, persuada à Necker que cette chaire devait être instituée avant tout pour les besoins de la Monnaie elle-même; le Conseil du Roi, admettant à son tour que cette chaire était tout indiquée pour fonctionner à la Monnaie, vu les rapports étroits entre les monnaies et les minéraux, en décida l'installation dans l'Hôtel des Monnaies; et c'est ainsi que Sage en fut nommé titulaire.
La fonction nouvelle d' « Intendant général des Mines », instituée par le ministre des Finances Joly de Fleury, vient donner bientôt un relief plus accentué aux plans de Sage. Son projet tout entier est enfin réalisé par un arrêt du Conseil du Roi du 19 mars 1783, établissant à l'Hôtel des Monnaies, à Paris, une « Ecole des Mines, à l'instar de celle qui a été établie avec tant de succès sous le règne du feu roi pour les Ponts et Chaussées », et stipulant que les inspecteurs et sous-inspecteurs du roi pour les Mines ne pourront être pris désormais que parmi les élèves ayant conquis dans la nouvelle école le brevet de sous-ingénieur. A ce moment, le Corps des Mines était déjà constitué, mais à l'état embryonnaire, car il ne comprenait encore que douze titulaires : 4 inspecteurs, 2 sous-inspecteurs et 6 ingénieurs. Il était si peu en rapport avec l'importance des mines en exploitation sur tout le territoire du royaume, qu'on le renforçait même par des éléments étrangers, comme l'avait fait observer tristement l'arrêt du 11 juin 1778, et c'est ainsi qu'un ingénieur allemand, Schreiber, ancien élève de l'Ecole de Freiberg, appelé en 1777 par le comte de Provence pour exploiter la mine d'or et d'argent d'Allemont, en Dauphiné, que le roi, son frère, venait de lui concéder, fut nommé, en 1784, « inspecteur honoraire des mines ». L'école de Sage allait permettre de doubler en peu de temps l'effectif du corps royal des mines.
On a beaucoup discuté la valeur scientifique de Sage, notre fondateur; il faut bien reconnaître que la lecture de ses traités n'inspire qu'une médiocre estime pour le savant, bien que l'Académie des Sciences lui ait ouvert ses portes alors qu'il n'avait que trente ans. Mais si cet adepte attardé du phlogistique a eu le grave tort de combattre les théories nouvelles de Lavoisier et d'Haüy, on ne peut certes lui refuser le mérite d'avoir été un administrateur remarquable : le fonctionnement de « son école » (comme il appelait volontiers l'Ecole de la Monnaie), apparaît, en effet, singulièrement jeune, moins différent du nôtre, sous certains rapports, que celui de certaines périodes intermédiaires. Voici, en effet, quels étaient le régime de l'Ecole Royale des Mines de la Monnaie et le plan des études au moment de sa fondation. Il y avait - comme aujourd'hui - deux sortes de cours : des cours publics et ceux qui étaient destinés aux élèves seulement. Les élèves, pour être admis, devaient subir des examens d'entrée, conformément aux prescriptions de l'arrêt du Conseil du 19 mars 1783. La durée de l'instruction devait être de trois ans, avec période scolaire de six mois, du 1er novembre au 1er juin; chaque année, les élèves devaient passer deux examens partiels, l'un sur la théorie, l'autre sur la pratique, et à la fin du mois de mai, un examen général. Pendant les vacances, les élèves qui s'étaient distingués par leur application et leur intelligence étaient envoyés dans les principales exploitations pour s'instruire de tous les objets relatifs à la pratique des travaux. Les concessionnaires de mines étaient chargés de l'entretien des élèves envoyés chez eux, « à raison de 60 livres par mois », et ils devaient donner des certificats sur leur conduite et leur travail. Les stages actuels des élèves, entre les périodes de cours, dans des établissements miniers ou métallurgiques, rappellent de fort près cette lointaine origine.
Les cours de l'Ecole de la Monnaie étaient organisés comme il suit : deux professeurs principaux, Sage et son collègue de l'Académie des Sciences, Guillot-Duhamel, faisaient chacun trois leçons par semaine, de trois heures chacune. Sage professait la minéralogie et la chimie docimastique (ou métallurgie), Guillot-Duhamel le cours d'exploitation des mines et géométrie souterraine, et celui des machines et appareils utilisés dans les mines. Des cours de mathématiques et de physique étaient faits aux débutants; un ingénieur des mines enseignait le dessin et le tracé des plans; un professeur de langues étrangères donnait des leçons d'allemand et d'anglais. Enfin les élèves étaient exercés aux opérations de la chimie analytique dans un laboratoire créé pour eux.
Le nombre des élèves admis chaque année devait être de 12.
Il faut reconnaître que, pour un premier essai, cette organisation avait une fort belle tenue, puisque après plus d'un siècle de retouches, d'additions, de suppressions, parfois même de bouleversements, elle survit encore tout entière dans celle d'aujourd'hui. (texte rédigé en 1931)
Les cours étaient professés dans la grande salle du premier étage de l'Hôtel des Monnaies (L'Hôtel des Monnaies, par Fernand Mazerolle, archiviste à la Monnaie ,Laurens, édit., 1907), où est installé le musée actuel, et qui n'a pas été modifiée depuis sa création; elle avait été créée, en 1772, comme salon d'assemblée, et magnifiquement décorée pour recevoir « tous les princes et seigneurs étrangers venant visiter la capitale » (Journal de Paris du 2 avril 1772). Sage avait transporté dans cette salle les remarquables collections de minéralogie qu'il avait mis vingt-cinq ans à former. Le roi, sur la proposition du successeur de Joly de Fleury, d'Ormesson, qui estimait avec l'intendant général des mines de la Boullaye qu'une collection de ce genre était indispensable pour les travaux de la nouvelle école, la fit acheter à son possesseur moyennant une rente viagère de 5.000 livres. Sage a donné le catalogue de sa collection dans sa Description méthodique du cabinet de l'Ecole royale des Mines, publié en 1784, et conservé dans la Bibliothèque de l'Ecole des Mines. Nous y avons relevé 3.549 échantillons.
Le contrôleur des Finances Calonne, qui s'intéressait particulièrement à la création de la nouvelle école, en raison des progrès qu'elle pouvait susciter dans les entreprises métallurgiques, voulut que le cabinet minéralogique de Sage acheté par le roi, et comprenant des minéraux du monde entier, fût complété dans l'Hôtel des Monnaies par une collection rassemblant toutes les productions minérales du royaume et les distribuant « par ordre de département », de façon à offrir le « tableau minéralogique » de la France. Un tel aménagement (qui est évidemment l'origine de notre collection minéralogique départementale actuelle) exigeait des dépenses considérables, et voici comment on parvint à donner à ces collections une installation répondant au but envisagé.
Il existait en 1784 dans le garde-meuble de la couronne une énorme quantité de tentures hors d'usage, qui contenaient beaucoup de fils d'or et d'argent. C'étaient sans doute d'admirables tapisseries du XVe siècle, très peu appréciées au XVIIIe, qui n'avait d'admiration que pour les tapisseries des manufactures des Gobelins et de Beauvais. Il en avait été offert 60.000 livres par des brocanteurs. Sage en ayant signalé la valeur bien supérieure à cette offre par l'or et l'argent que contenaient ces tapisseries - l'essayeur de la Monnaie s'y connaissait, sinon en valeur artistique, du moins pour les métaux précieux - proposa de les incinérer (quel vandalisme inconscient!) pour en retirer l'or et l'argent.
Cette opération criminelle produisit 440.000 livres, sur lesquelles le Roi en préleva 110.000 qui furent affectées à la décoration de la salle de cours de la nouvelle Ecole des Mines et à l'aménagement des collections. Le seul détail qui soit à l'honneur de Sage, c'est qu'il abandonna pour cet aménagement la part des 110.000 livres (40.000) que le Roi lui avait offerte comme gratification personnelle.
Une gravure du temps, dessinée par Née, représente un cours public - sans doute celui de Sage - dans cette belle salle de la Monnaie. On peut la voir aujourd'hui, exposée dans un cabinet attenant à cette salle, du côté de la Seine. Nos premiers « antiques », en habit à la française et en culotte courte - tenue différente, (ô combien !) de celles qu'ont souvent aujourd'hui nos jeunes camarades - boivent les paroles de leur maître, tandis que quelques auditeurs, arrivés en retard, sont obligés de s'en aller, toutes les places étant déjà occupées dans l'amphithéâtre elliptique, formé par la juxtaposition des magnifiques vitrines contenant les collections de Sage. Ce document est particulièrement précieux pour nous, puisqu'il nous donne l'image fidèle des premiers cours de notre Ecole, et qu'en voyant la salle encore intacte où ils se professaient, nous pouvons nous en représenter aisément l'atmosphère et l'activité.
Bien que l'Ecole des Mines ait quitté en 1794 les bâtiments de la Monnaie, les collections minéralogiques qui y avaient été installées sous l'ancien régime y restèrent jusqu'à la mort de Sage (9 sept. 1824) qui avait continué à y professer la Chimie docimastique. A cette époque, on estima avec raison qu'un cabinet mineralogique aussi important n'était guère à sa place dans un établissement monétaire, et les collections furent partagées entre l'Ecole des Mines, pour laquelle elles avaient été constituées, et le Muséum d'histoire naturelle. On donna malheureusement un droit de préemption au Muséum qui écréma la collection en prélevant 466 échantillons; l'Ecole des Mines reçut le reste, soit environ 3.000 objets.
Les seuls vestiges certains qui nous restent de l'Ecole des Mines de l'Hôtel des Monnaies sont la balance d'essayeur de Sage et son buste, pieusement recueillis dans l'appartement du Directeur actuel de l'Ecole. Le buste de Sage en bronze, exécuté par le sculpteur Ricourt, en 1786, était posé sur un cippe, en imitation de marbre vert, placé dans l'escalier menant à la salle de cours de l'Hôtel des Monnaies. C'étaient les élèves de l'Ecole royale des Mines qui avaient fait faire ce buste au-dessous duquel on lisait cette épigraphe :
Discipulorum pignus amoris
La balance d'essayeur, à socle en bois de rosé, signée par le constructeur Mégnié en 1781, est un spécimen très rare des appareils de physique qu'exécutaient avec tant de perfection les artistes du XVIIIe siècle. Elle devait être exposée dans l'une des vitrines existant encore dans la grande salle du musée de l'Hôtel des Monnaies. La description que donne Sage de sa balance d'essayeur dans son catalogue, ne laisse aucun doute sur l'attribution de cet appareil au fondateur de notre Ecole.
Bientôt, en effet, l'Ecole des Mines allait être reconstituée sous l'impulsion réorganisatrice de la Convention. On était au début de 1794. Le Comité de Salut public, investi par la Convention des pouvoirs les plus étendus, venait de remplacer les différents ministères par douze commissions dépendant étroitement du Comité, et qui préparaient avec une ardeur invraisemblable les mesures destinées à remplacer toutes les institutions du pouvoir déchu : suivant la forte expression de Thiers, « on administrait, on combattait, on égorgeait avec un ensemble effrayant ».
C'est aux jours les plus sombres de la « Grande Terreur » que l'Ecole des Mines a été recréée, et l'on est stupéfait du travail méticuleux et réfléchi auquel se sont livrés les auteurs de sa restauration pendant que l'échafaud redoublait d'activité sur la Place de la Révolution, à deux pas de l'Hôtel de Mouchy où allait s'installer notre Ecole.
C'est la « Commission des subsistances » qui fut tout d'abord chargée par le Comité de Salut public de lui présenter un « Rapport sur l'organisation de l'Ecole des Mines ». Ce rapport est daté du 19 Germinal an II (8 avril 1794) et signé par le président de la Commission, le conventionnel Johannot (Archives nationales, folio 14, no 1302 A). Il ne donne pas la composition de la Commission, mais, comme on va le voir, les connaissances scientifiques et techniques nécessaires pour l'établir ne permettent pas de douter qu'Hassenfratz, devenu jacobin militant, n'ait été l'inspirateur de ce curieux document, auquel ont peut-être collaboré les rapporteurs habituels du Comité de Salut public pour les questions scientifiques : Fourcroy, membre de la Convention, Monge et Berthollet, tous les trois ardents républicains comme Hassenfratz. Il nous paraît intéressant de donner ici une analyse succincte de ce rapport, très intéressant pour l'histoire de notre école, car il contient en germe les conceptions d'une école supérieure technique à Paris et d'écoles pratiques sur des exploitations minières, conceptions qui furent quelques années plus tard opposées les unes aux autres.
Le plan de la Commission est ainsi défini au début du rapport : « Répandre l'instruction des Mines sur les principales exploitations de la République, l'accompagner de la pratique et la concentrer en un seul point pour le complément des études. » Pour exécuter ce plan, la Commission envisage l'établissement d' « écoles primaires des mines » auprès des principales exploitations, et d'une « Ecole Centrale » à Paris. Dans les écoles primaires, on enseignera les mathématiques, la géométrie souterraine et toutes les branches du travail des Mines qui sont usitées dans les exploitations voisines de l'Ecole. Les candidats à ces écoles primaires devront avoir 14 ans au moins, et savoir lire, écrire et connaître les règles de l'arithmétique. A l'Ecole Centrale des Mines de Paris, on enseignera les sciences suivantes, dont voici l'énumération textuelle :
C'est, croyons-nous, pour la première fois qu'on voit figurer dans un document officiel le terme de « Géologie », science dont les bases étaient encore bien fragiles et qui ne devait être réellement constituée qu'une dizaine d'années plus tard (on désignait alors sous le nom de « Géographie physique » les premiers essais de notions géologiques). Le programme de la Commission marque un progrès sérieux sur celui de l'Ecole de la Monnaie.
Les matières de ce programme devaient être réparties en 6 chaires distinctes, chacune d'elles étant pourvue de deux professeurs titulaires, dénommés « instituteurs », devant alterner tous les ans, une année étant consacrée à l'enseignement, l'autre à des tournées d'étude et de surveillance dans les mines de la République, où « l'instituteur » prenait le titre d' « agent des Mines ».
La Commission prévoit enfin des traitements annuels pour les instituteurs (6.000 fr.), pour les élèves de l'Ecole Centrale (2.000 fr.), et même pour les élèves des Ecoles primaires (600 fr.), afin que les déshérités de la fortune puissent y accéder aussi bien que ceux qui en sont favorisés.
Cette organisation très complète, trop complète même, fut sans doute jugée par le Comité de Salut public comme bien compliquée et coûteuse pour un début, et, trois mois après, le Comité prenait, coup sur coup les arrêtés suivants aboutissant à la création d'une seule Ecole des Mines à Paris :
Ces cours étaient complétés par des leçons et conférences de mathématiques, de physique générale, de perspective, de stéréotomie et d'allemand.
Comme on le voit, d'après le tableau précédent, Sage était éliminé de « son Ecole », et définitivement confiné dans son cours de chimie à l'Hôtel des Monnaies; Vauquelin ne le fit certainement pas regretter.
On peut juger de l'enthousiasme qui dut exalter les professeurs et les élèves de cette époque héroïque, par le ton enflammé du « Programme » ouvrant le Journal des Mines de la République, fondé par arrêté du 13 messidor an II, et annonçant au public la création de l'Ecole des Mines et de 1' « Agence des Mines ».
« Il est temps (dit l'auteur de ce programme, Coquebert de Montbret), il est temps que le génie de la liberté mette en oeuvre les trésors que la Nature a tenus pour lui en réserve. A sa voix, le salpêtre est sorti de nos souterrains. Cette voix puissante va retentir jusque dans les entrailles de la terre; les républicains y trouveront ce que la politique des autres peuples leur refuse : du fer et de la houille... Laissons les peuples amollis par la servitude donner le nom de précieux aux métaux brillants et rares; ce qui est précieux pour nous, c'est ce qui sert à nous défendre... »
Grâce à l'excellent choix des professeurs de la « Maison d'éducation », nom donné par l'Agence à la nouvelle Ecole, le succès en fut bientôt très grand. Quatre ans après sa fondation, l'Agence des Mines (qui avait pris entre temps le titre de « Conseil des Mines »), jugeant la constitution de l'Ecole définitive, faisait une ouverture solennelle des cours en présence du ministre de l'Intérieur, le 26 brumaire an VII (16 nov. 1798), et rappelait dans un discours enthousiaste (Journal des Mines, no 51 de frimaire, an VII) les étapes parcourues dans les différents cours professés depuis la fondation de l'Ecole. Les professeurs invités à présenter le programme de leurs leçons dans cette séance mémorable, se levaient chacun à leur tour, et dans des discours du style emphatique cher à cette époque, résumaient le programme qu'on leur demandait, en s'attachant surtout à faire un éloquent exposé des progrès récemment réalisés dans le domaine de leur enseignement. Il nous paraît intéressant de donner ici quelques extraits de ces discours, qui situent bien l'état d'avancement, à cette époque, des sciences intéressant le plus notre Ecole.
Brongniart (qui avait remplacé Hassenfratz en l'an V, dans la chaire de Minéralogie), après avoir énuméré les principales découvertes faites en minéralogie, dans les dernières années, et indiqué les grandes lignes de son programme, ajoute : « Je ne traiterai point la géologie séparément, mais je m'étendrai sur la situation géologique des pierres dont je ferai l'histoire; et lorsque nous serons parvenus aux appendices qui renferment les roches, je ferai une ou deux leçons sur les diverses sortes de terrains, et sur les lois que l'on croit avoir reconnues dans la disposition des couches pierreuses qui forment la petite partie de la terre que nous connaissons. »
Comme on le voit, c'est l'aurore de la géologie qui se lève!
Le discours de Vauquelin montre que son cours de docimasie comprenait une longue introduction de chimie générale « pour les élèves nouveaux qui pourraient n'être pas suffisamment avancés dans la connaissance des généralités ». Puis venaient les leçons de docimasie étudiant les différents éléments et leurs composés, dans un ordre tout à fait semblable à celui des programmes actuels, et il terminait son discours par ce conseil très judicieux dont nos professeurs et nos élèves actuels peuvent encore faire leur profit :
« Citoyens, je ferai en sorte d'être clair et précis dans mes démonstrations; néanmoins, je vous conseille de mettre vous-même la main à l'oeuvre; ce qu'on entend, quelque clair qu'il soit, passe avec la rapidité du son qui le transmet; ce qu'on voit s'oublie quelquefois : mais ce qu'on a fait, surtout guidé par une sage méthode et un bon raisonnement, reste bien plus longtemps gravé dans la mémoire. »
Hassenfratz (qui avait remplacé Schreiber en l'an VI dans la chaire de métallurgie), donne un exposé très complet mais assez confus de son enseignement; on est surtout frappé de l'effort qu'il fait pour dégager des idées générales du chaos des procédés empiriques et des « recettes » qui constituaient alors à elles seules l'art du fondeur, et l'on peut voir dans le plan de son cours l'embryon des deux parties actuelles de l'enseignement métallurgique : la métallurgie générale, et la métallurgie appliquée (sidérurgie et préparation des métaux autres que le fer).
Des quatre discours inauguraux de ces pionniers de notre enseignement, publiés par le Journal des Mines, c'est à coup sûr celui de Baillet qui donne le programme le plus complet et le mieux ordonné: il n'avait pour cela qu'à suivre les traditions de son maître Guillot-Duhamel père, dont il avait été l'élève à l'Ecole de la Monnaie et auquel il avait succédé en l'an IV dans le cours d'Exploitation. Les huit pages de son programme ne contiennent pour ainsi dire rien qui ne soit encore d'actualité, et tout serait à citer; qu'il nous suffise de dire ici que le cours de Baillet comprenait 45 leçons, dont 6 consacrées à la recherche des mines, 16 aux méthodes d'exploitation, 3 à l'aérage, 14 à l'épuisement des eaux, 3 à l'extraction et enfin 3 à la préparation mécanique.
Dans ces différents discours, tant du Conseil des Mines que des professeurs, on voit percer partout la préoccupation de compléter l'instruction théorique par des stages pratiques dans les établissements miniers et métallurgiques, et aussi dans des « écoles pratiques » à créer sur des mines en exploitation. Dès le début, l'Agence avait, en effet, compris que la « Maison d'éducation » avait pour rôle d'enseigner aux élèves nouvellement arrivés avec un bagage de sciences pures, l'application de la théorie à la pratique, mais que l'instruction des élèves de l'Ecole des Mines n'était pas finie avec cette synthèse d'ordre encore didactique, et qu'il fallait la compléter par l'observation et l'étude du métier manuel proprement dit. L'Agence avait donc étudié dans ce but la création d' « Ecoles pratiques » situées sur des mines appartenant aux Domaines, dont les bénéfices assureraient le fonctionnement de ces écoles, et dans lesquelles les élèves ingénieurs, au sortir de l'Ecole de Paris, iraient parachever leur instruction. C'était en somme la conception de la Commission des subsistances, mais inversée dans l'ordre du programme de celle-ci qui plaçait l'Ecole scientifique après les écoles pratiques.
Le projet de l'Agence, fort sage cependant, faillit compromettre l'existence de l'Ecole de l'Hôtel de Mouchy en 1795, et la fit sombrer définitivement en 1802, malgré le très grand succès qu'elle avait obtenu à peine fondée et qui s'était maintenu jusqu'à sa suppression : voici quelles furent les étapes de ces périls, puis de ce naufrage.
A la suite du décret de la Convention du 21 ventôse an II (11 mars 1794), décidant la réorganisation de tous les services de travaux publics civils et militaires, la loi du 7 vendémiaire an III (28 septembre 1794) créa l'Ecole Centrale des Travaux publics qui devait, dans l'esprit de ses fondateurs et surtout de Monge, se substituer à toutes les écoles techniques existant encore et créées sous l'ancien régime: l'Ecole des Mines, malgré ses succès, n'avait plus ainsi de raison d'être. Mais sous l'influence de mathématiciens, d'esprit plus théorique que celui de Monge, et dont les idées étaient ardemment défendues par Laplace, l'Ecole centrale des Travaux publics fut bientôt transformée en une école de haute culture scientifique d'ordre général, en même temps qu'elle prenait le nom d'Ecole polytechnique avec la loi du 15 fructidor an III (1er sept. 1795). On devait y enseigner les matières communes à toutes les professions techniques, et y préparer les ingénieurs civils et militaires dont la formation professionnelle serait achevée dans des écoles spéciales d'application.
La loi du 30 vendémiaire an IV (22 oct. 1795) vint bientôt préciser cette organisation en réglant les rapports de l'Ecole polytechnique avec les diverses écoles spéciales et notamment avec l'Ecole des Mines. Cette loi a fait plus tard la grande force de notre Ecole en posant en principe que les ingénieurs du Corps des Mines seraient désormais recrutés parmi les polytechniciens nommés élèves-ingénieurs des Mines et formés dans leur « école particulière », mais le nom de l'Ecole des Mines de Paris ne figure pas explicitement dans la loi, qui, par contre, s'étend longuement sur la création d'une « Ecole pratique pour l'exploitation et le traitement des substances minérales » sur une mine en activité appartenant à la République, et dans laquelle pourraient être envoyés chaque année des élèves-ingénieurs des Mines sortant de l'Ecole polytechnique. (La loi du 30 vendémiaire an IV prévoit en outre des élèves externes pouvant suivre à leurs frais les cours pendant un an. Mais il semble que cette faculté n'ait guère été utilisée qu'une seule fois jusqu'en 1817 par deux élèves envoyés en 1797 à l'Ecole de Mouchy par le Préfet de l'Hérault, aux frais de ce département. Ils ne figurent d'ailleurs pas sur les annuaires de notre Ecole). Du jour où serait créée cette école pratique, les élèves ingénieurs des Mines pourraient ainsi, au gré du gouvernement, être envoyés directement de l'Ecole polytechnique dans cette école, sans passer par l'école de Paris, qui dès lors, devenait inutile. Une semblable mesure pouvait d'autant plus être envisagée que l'enseignement de l'Ecole polytechnique, encore imprégné des tendances initiales des fondateurs de « l'Ecole centrale des Travaux publics », comportait quinze leçons sur les « travaux des mines » (4 % du total des leçons) qui ne furent supprimées qu'en 1807 : pour un esprit peu au courant des projets du Conseil des Mines, le cours professé à l'Ecole polytechnique pouvait constituer à lui seul la transition naturelle entre la science pure et la pratique des travaux d'exploitation, alors que, interprété dans le sens des idées du Conseil des Mines qui considérait l'Ecole de Paris comme intangible, la nouvelle loi signifiait que celle-ci restait l'étape obligatoire entre l'Ecole polytechnique et les écoles pratiques.
Il faut d'ailleurs reconnaître que l'insistance avec laquelle le Conseil des Mines réclamait sans cesse des pouvoirs publics la création d'écoles pratiques sur des exploitations minières (il n'en réclamait pas moins de quatre) pouvait donner à croire qu'il n'avait de prédilection que pour celles-ci (voir à ce sujet le discours d'inauguration des cours de l'Ecole des Mines de Mouchy à la rentrée de brumaire an VII prononcé par le Conseil des Mines : Journal des Mines, t. IX, p. 173), et c'est ainsi que finalement, sur la proposition des « Conseils de la République », le premier Consul signait l'arrêté du 23 pluviôse an X (12 février 1802), créant deux écoles pratiques des Mines, l'une à Geislautern, dans le département de la Sarre, l'autre à Pesey, dans le département du Mont-Blanc.

L'arrêté stipule que dans la première de ces écoles « on enseignera l'art de traiter les mines de fer et d'extraire la houille, en même temps qu'on s'occupera de tout ce qui a rapport aux préparations dont les substances minérales sont susceptibles », et que « dans la seconde, on fera connaître tout ce qui a rapport à l'exploitation des mines de plomb, cuivre, argent et sources salées. » L'arrêté règle en détail toutes les questions de personnel des deux Ecoles, et reconstitue en même temps le Conseil des Mines, en lui conservant d'ailleurs son effectif de trois membres, et en le chargeant expressément de « s'occuper de tout ce qui a rapport aux Ecoles et qui intéresse la partie des mines ». De l'Ecole de Paris, si bien installée dans l'Hôtel de Mouchy, il n'est pas question dans l'arrêté, mais elle est supprimée implicitement du fait qu'elle ne figure pas dans les attributions du nouveau Conseil des Mines.
L'Ecole de Mouchy, à laquelle on ne devait plus envoyer d'élèves pendant toute la durée du Premier Empire, tombait ainsi dans une profonde léthargie, et l'Ecole des Mines de Paris devait attendre la Restauration pour se réveiller de ce long sommeil.

Les deux écoles pratiques ont donc des histoires distinctes méritant d'être exposées chacune séparément.
Et d'abord, celle de Pesey, qui, en fait, par la continuité de son enseignement établit une liaison à peu près complète entre l'Ecole de Mouchy et l'Ecole des Mines de Paris rétablie en 1816.
Les mines de Pesey, comme celles de Geislautern d'ailleurs, avaient été indiquées par le Conseil des Mines parmi celles où l'on pouvait créer une école pratique des Mines. Le choix de Pesey n'avait sans doute été dicté que par la possibilité d'en nommer immédiatement directeur l'Inspecteur des Mines Schreiber, qui exploitait les mines voisines d'Allemont, car l'emplacement des mines de Pesey n'était nullement indiqué pour y installer une école. Pesey est en effet à 1.300 m. d'altitude, dans une âpre vallée des montagnes de la Tarentaise, à 20 km. de la petite ville de Moutiers, qui ne comptait alors que 2.000 habitants et était la seule ressource du pays. On ne peut descendre de Pesey jusqu'au débouché de la vallée vers la rive gauche de l'Isère, que par un sentier accessible seulement aux mulets. Les mines sont à 4 km. au-dessus de Pesey, le gîte affleurant à 1.580 m. Très beau à la surface, le gîte avait été l'objet d'une exploitation fructueuse de 1742 à 1760 par une Compagnie anglaise, puis reprise avec moins de succès par une Compagnie sarde, et arrêtée en 1792, lors de la conquête de la Savoie par les armées républicaines.
L'Ecole de Pesey avait d'ailleurs été créée par l'arrêté consulaire sans qu'on s'inquiétât de la possibilité de l'installer matériellement. A peine arrivés sur place, les organisateurs envoyés à Pesey s'aperçurent qu'il était impossible de loger professeurs et élèves sur des pentes neigeuses, inhabitables pendant une grosse partie de l'année, et hors de portée de voies carrossables. On remédia à cet inconvénient en affectant à l'Ecole, par arrêté consulaire du 27 nivôse an XI (17 janvier 1803) les bâtiments de l'ancien séminaire de Moutiers, transformés en manutention militaire. Des installations suffisantes pour le fonctionnement de l'Ecole : laboratoire, bibliothèque, salles de dessin et d'étude, logement pour le directeur et quelques ingénieurs, y furent faites par Schreiber et le sous-directeur Lefroy. L'Ecole de Pesey, qu'on appela aussi l'Ecole de Moutiers ou l'Ecole du Mont-Blanc, pouvait dès lors fonctionner, mais dans des conditions bien dures pour les élèves qui devaient monter chaque jour à la mine, distante de 4 kilomètres et à 300 m. de hauteur au-dessus de Pesey.
Les professeurs au nombre de trois : Baillet du Belloy, pour l'exploitation, Hassenfratz pour la métallurgie et Brochant de Villiers pour la minéralogie, résidaient en principe à Paris et ne venaient à Pesey que un par un, faisant leur cours à la hâte, en deux ou trois mois. Schreiber, soucieux avant tout des bénéfices de son exploitation, utilisait beaucoup les élèves dans ses mines de plomb : ils y exécutaient tous les travaux manuels et faisaient les levers de plans superficiels et souterrains.

C'est pourtant dans ce milieu, en apparence bien peu favorable aux études scientifiques, qu'a germé la vocation de chimiste d'un Berthier ! On comprend mieux que le plus jeune des professeurs, Brochant de Villiers, de la promotion 1799, séduit par la beauté des montagnes qui environnaient l'Ecole, ait eu l'idée de les étudier pour elles-mêmes, et puisé dans ses longues excursions en Tarentaise, les éléments de son Traité des roches, l'un des premiers ouvrages de géologie pure. Il est vrai que si l'installation de l'Ecole était lamentable, les professeurs étaient de premier ordre, et les élèves peu nombreux (dix au début, et plus tard 24 au maximum) provenaient tous de l'Ecole polytechnique.
De l'Hôtel de Mouchy, privé de ses élèves, le Conseil des Mines n'avait cessé de s'intéresser au sort de l'Ecole de Pesey et d'encourager Schreiber à créer une école mieux située et plus largement aménagée. En 1813, Schreiber, grâce aux bénéfices réalisés par la mine de Pesey, avait pu terminer l'installation d'une grande fonderie centrale pour plomb et cuivre, à Conflans, en face d'Albertville; il se disposait à y transporter l'Ecole de Pesey, lorsque survinrent les événements de 1814. La France perdant, par le traité de Paris du 30 mai 1814, tous les territoires conquis par les armées de la République et de l'Empire, la Tarentaise retourne à la couronne de Savoie, et c'en est fait de l'Ecole des Mines du Mont-Blanc. L'école de Pesey fut rouverte le 1er juillet 1825, par le gouvernement Sarde, exactement dans le système français. Elle dura ainsi jusqu'en 1846, époque à laquelle le gouvernement Sarde décida d'envoyer ses ingénieurs des mines se former à l'Ecole des Mines de Paris.
Le peu d'élèves qui lui restaient, six en tout, viennent en hâte rejoindre leurs professeurs et le Conseil des Mines à l'Hôtel de Mouchy. Mais l'hôtel était rendu le 18 juin 1814 par la Restauration au prince de Poix, son ancien propriétaire, et le 1" juillet suivant, l'Ecole, ses collections, sa bibliothèque et son laboratoire étaient transférés à l'Hôtel du « Petit Vendôme », construit par les Chartreux, qui a disparu, comme on le verra plus loin, lors du percement du boulevard Saint-Michel, et qui était situé au nord de l'emplacement actuel de l'Ecole.
On tenta, paraît-il, de reprendre les cours dans l'hiver 1814-1815, mais sans doute devant un auditoire très restreint, car plusieurs des élèves de l'Ecole de Pesey, comme nous l'indiquerons ci-après, avaient été envoyés à l'Ecole de Geislautern, restée française, le territoire de la Sarre, qui faisait partie du royaume de France avant la Révolution, nous étant conservé par le traité de Paris. Cette reprise de cours au Petit-Vendôme dut être en tout cas bien courte, car à peine l'Ecole de Mouchy était-elle réinstallée dans cet hôtel, qu'il fallut encore déménager. Après les Cent jours, le Petit-Vendôme, jugé trop petit pour l'Ecole, est affecté à la résidence du Président de la Chambre des Pairs, et l'Ecole des Mines transférée, à quelques mètres de là, dans l'Hôtel de Vendôme, loué avec un bail à dater du 14 août 1815. Tous les bénéfices économisés par Schreiber sur les produits des mines de Pesey payèrent ces deux déménagements effectués par l'Inspecteur des Mines Lefroy qui devait pendant une longue période, présider à l'installation de notre Ecole dans l'Hôtel de Vendôme - installation définitive cette fois - à partir du 11 janvier 1816, date de la réouverture des cours après son dernier déménagement.
De l'Ecole de Pesey, la seule relique qui nous reste dans l'Ecole actuelle, est un superbe mortier en bronze, de 0 m. 45 de haut, dans lequel on devait sans doute broyer les minerais destinés aux analyses des élèves, et dont le bord supérieur porte l'inscription suivante :
Laboratoire de l'Ecole pratique des Mines de Pesey, établie à Moutiers, an X de la République française.
La Monnaie de Paris possède également comme souvenir de l'Ecole du Mont-Blanc une très curieuse médaille commémorative que nous reproduisons à la fin de ce volume.
Qu'était devenu pendant ce temps le projet d'établissement d'une Ecole pratique des Mines à Geislautern? Un ingénieur allemand, Hasslacher, a prétendu que « vraisemblablement » cette école n'a pu être construite faute de fonds, et n'a jamais fonctionné. Par contre, il existe à Geislautern un fort joli bâtiment, que son style date sans aucun doute du premier Empire, et que les habitants de la région, ainsi que la famille qui l'occupe depuis un siècle, désignent sous le nom de Maison de l'Ecole des Mines : pouvait-on démontrer par des documents historiques qu'il s'agit bien d'un bâtiment construit pour l'Ecole pratique de Geislautern, envisagée par le Conseil des Mines?
Il existe aux Archives Nationales à Paris, de très nombreux dossiers concernant l'histoire de la domination française dans la Sarre, et qui étaient tombés dans l'oubli lorsque, pendant la grande guerre, ils y furent découverts par M. le député Fernand Engerand, avec l'aide de son frère Louis, archiviste paléographe : l'inventaire des pièces ainsi exhumées a été joint par M. F. Engerand à son rapport sur le projet de loi créant un Office des Mines domaniales de la Sarre. C'est grâce à cet inventaire que nous avons pu retrouver un assez grand nombre de documents permettant d'esquisser l'histoire de l'Ecole pratique des Mines de Geislautern, et notamment d'identifier le bâtiment dont nous venons de parler avec la maison construite pour cette école par l'Ingénieur en Chef des Mines Guillot-Duhamel fils, nommé Directeur de cette école par décret du 10 mars 1807.
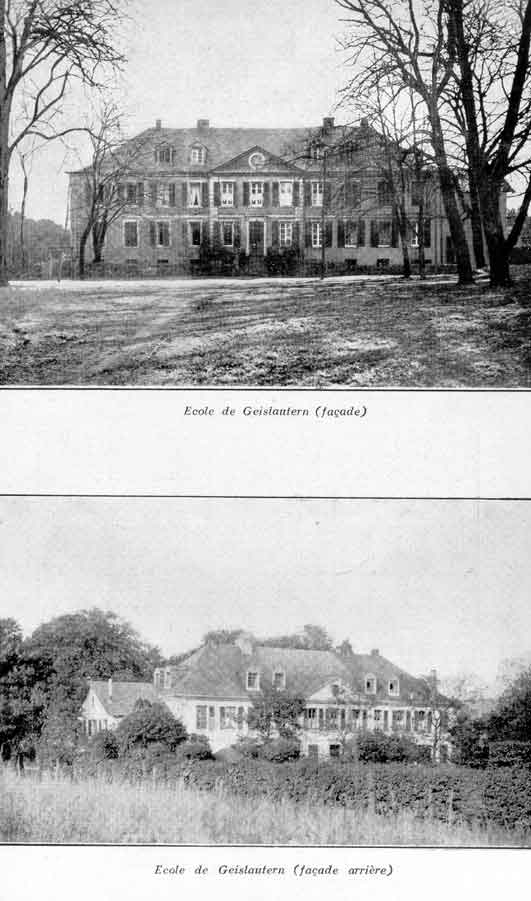
Un rapport de Duhamel fils, publié en l'an XII (1803) dans le Journal des Mines (tome XV), montre que dès avant cette époque, le gouvernement français avait chargé cet ingénieur en chef, avec l'aide de deux jeunes ingénieurs des Mines, Beaunier (promotion 1795) et Calmelet (promotion 1800), d'inventorier les richesses minières du département de la Sarre, et notamment les mines de houille et les forges faisant partie du domaine des princes de Nassau-Sarrebrück, dont nos ingénieurs allaient devenir les exploitants en même temps qu'ils dirigeraient l'Ecole pratique des Mines de Geislautern. Mais les mines de houille étaient très mal exploitées et les forges pour la plupart en chômage : tel était le cas des mines de charbon et de fer ainsi que de la fabrique de fer-blanc de Geislautern, dont les produits devaient servir à couvrir les frais de la future Ecole. Le premier soin de nos ingénieurs devait donc être de réorganiser l'exploitation minière et métallurgique de la Sarre, avant d'entreprendre l'établissement de l'Ecole pratique.
D'autre part, les magnifiques pronostics du rapport de Duhamel sur l'avenir houiller de la Sarre avaient déterminé Napoléon à partager le bassin houiller sarrois en un grand nombre de concessions pour en développer l'extraction qui atteignait à peine 50.000 tonnes en 1803. Mais avant de concéder le sous-sol et pour pouvoir l'exploiter, il fallait en faire une prospection méthodique et dresser une carte à grande échelle du pays avec indication des affleurements des couches de houille, leur inclinaison, etc., toutes choses qui n'existaient pas. Napoléon décida que cet important travail serait fait par l'Etat et confié aux ingénieurs de l'Ecole de Geislautern, Beaunier et Calmelet, sous la direction de Duhamel : cet énorme travail fut terminé pendant l'été 1809. Entre temps, les mines et usines de Geislautern avaient été remises en activité : nos ingénieurs pouvaient dès lors s'occuper du fonctionnement de l'Ecole pratique impériale des Mines de la Sarre.
Duhamel n'avait pas attendu jusque-là pour préparer la construction de l'Ecole d'enseignement à proximité des usines de Geislautern. Celles-ci, à partir de notre prise de possession définitive, le 1er janvier 1807, furent elles-mêmes toujours désignées dans les documents officiels sous le nom d' « Ecole pratique de Geislautern », ce qui a pu prêter à une confusion avec l'école d'instruction des élèves et faire croire que celle-ci n'a existé que sur le papier. Mais les rapports, plans, devis et comptes envoyés par Duhamel au Conseil des Mines, établissent de façon certaine que « les constructions à faire à Geislautern pour le logement des Directeur, professeurs, élèves et employés » ont été commencées le 26 septembre 1808 par la maison du Directeur, qui a été terminée en 1810 et a coûté 72.806 fr. 04, plus le mobilier évalué à 12.000 fr. La « Maison des Mines » actuelle coïncide exactement avec celle du plan de Duhamel, comme emplacement et comme dimension : il n'est donc pas douteux que c'est bien là le bâtiment élevé par Duhamel pour l'Ecole pratique de Geislautern, à proximité des usines. D'après les rapports de Duhamel, cette maison comprenait au rez-de-chaussée l'appartement du Directeur et, au premier, des pièces (dont 6 chambres) destinées aux professeurs. Elle pouvait donc suffire pour les débuts d'une école n'ayant encore que peu d'élèves, et l'on ne jugea pas utile d'exécuter en même temps le complément du projet de Duhamel, qui comportait deux autres grands bâtiments. Un rapport du Conseil des Mines au ministre, en date du 1er janvier 1810, sur les « Ecoles pratiques des Mines » dit en effet que la maison qui vient d'être construite à Geislautern « suffira jusqu'à ce qu'on y ajoute des logements pour un plus grand nombre d'élèves et pour les salles d'études ». Il y avait d'ailleurs à proximité du bâtiment qui venait d'être édifié une vaste grange - qui existe encore - suffisante pour l'installation des laboratoires d'élèves et des magasins.
L'Ecole des Mines de Geislautern a dû fonctionner dans ces bâtiments à partir de 1810. Les documents des Archives Nationales ne contiennent malheureusement plus les registres de l'Ecole d'instruction qui y sont mentionnés comme pièces annexes; nous n'avons donc pu relever que sur des pièces éparses les noms de quelques-uns de ses élèves, notamment de de Gargan et Lefebvre, venant de l'Ecole polytechnique où ils avaient été reçus en 1810, et d'un Rhénan, Van den Brock, admis comme élève, après examens, en 1813. Il ne semble pas, il est vrai, que des professeurs spéciaux aient été chargés d'y faire des cours comme à Pesey, mais cela s'explique par le fait que les ingénieurs des Mines chargés d'exploiter les mines de houille et de fer, et de diriger les forges, étaient à même de donner sur place aux élèves l'instruction pratique voulue, en les faisant participer à leurs fonctions industrielles.
Après les événements de 1814, faisant disparaître l'Ecole de Pesey, le préfet de la Moselle s'empressa d'informer l'administration de Paris que l'Ecole de Geislautern « devenue le centre unique dans le royaume de l'instruction pratique des mines et de la métallurgie », était prête à remplir dignement ce rôle. Beaunier, qui avait succédé en 1813 à Duhamel comme directeur de l'Ecole, n'hésite pas, dès juin 1814, à prier instamment le Conseil des Mines de faire transporter à l'Ecole de Geislaulern tout le matériel de l'Ecole de Moutiers, « qui semble revenir de droit à l'Ecole de la Sarre ». Plus tard, le 6 mars 1815, pendans les Cent jours, il insiste à nouveau auprès du Conseil des Mines, pour qu'on lui envoie « la collection de minéralogie, les instruments de physique et le mobilier de l'Ecole du Mont-Blanc », et il ajoute : « D'ici à quinze jours, j'aurai préparé neuf chambres d'élèves indépendantes des logements destinés aux Ingénieurs et aux employés; il serait bien à désirer que je puisse pourvoir, du moins en partie, à leur ameublement, avec les garnitures de lit et le linge qui ont été enlevés de Pesey et de Moutiers. »
La prévoyance de cet administrateur avisé devait, hélas! être déjouée par les événements: trois mois après, le 18 juin, c'est Waterloo et l'invasion prussienne !
Beaunier s'était tout d'abord retiré à Metz, où il avait mis à l'abri les pièces essentielles des archives de l'Ecole, chez l'aspirant de Gargan, dont la famille habitait Metz. Il avait laissé à Geislautern l'élève-ingénieur Lefebvre en le chargeant de procéder à l'inventaire des approvisionnements de toutes sortes des usines et mines de l'Ecole; mais, prévenu par Lefebvre des déprédations auxquelles commençaient à se livrer nos ennemis, il revient bientôt à Geislautern, où il était maintenu officiellement, ainsi que tous les employés de l'Administration française, en exécution d'une déclaration du « ministre des hautes puissances » en date du 24 juillet 1815.
La correspondance de Beaunier avec le Directeur général des Mines à Paris, montre avec quelle énergie il a lutté pied à pied contre les envahisseurs pour maintenir intacte la « dot » de notre Ecole pratique. Mais il devait l'abandonner bientôt définitivement, au moment où le second traité de Paris, du 20 novembre 1815, obligeait la France à remettre le territoire de Nassau-Sarrebrück à la couronne de Prusse.
Si la part de l'Ecole de Geislautern dans l'enseignement de l'Ecole des Mines a été sans doute moindre que celle de l'Ecole de Pesey, on voit, par ce qui précède, qu'elle a joué un rôle beaucoup plus considérable que celle-ci dans le domaine minier et métallurgique, grâce au magnifique travail poursuivi par nos ingénieurs pour mettre en valeur le bassin houiller de la Sarre. L'admirable levé topographique qu'ils avaient exécuté dans ce but, avait été emporté au moment de l'invasion des alliés par l'aspirant de Gargan et caché chez M. Villeroy, à Sarrelouis. Il était d'une telle importance pour la continuation des travaux, que le gouvernement prussien exigea de la France la remise de l'Atlas contenant ces cartes. Nous avons eu la grande satisfaction de le récupérer après le traité de Versailles de 1919, grâce au reçu que la Prusse en avait donné en 1816 et que M. Engerand a fort heureusement retrouvé dans nos Archives Nationales : ce splendide volume est actuellement le plus précieux joyau de la bibliothèque de notre Ecole.
Pendant leur séjour dans la Sarre, nos ingénieurs avaient tellement amélioré la situation des houillères de ce bassin, dont ils avaient doublé la production en cinq ans, que les Allemands eux-mêmes ont dû reconnaître l'heureuse influence de l'administration napoléonienne pendant l'occupation de la Sarre par la France.
Et voici que l'année 1815 s'achève : c'en est fait de toutes les écoles des Mines de nos territoires perdus. De l'Ecole des Mines de Paris, il ne reste que le souvenir, mais ce souvenir est vivace et l'heure de sa résurrection va bientôt sonner.
L'histoire de l'Hôtel de Vendôme et de son emplacement, où allait se dérouler la vie désormais paisible de notre Ecole, ne manque pas d'intérêt même pour les étrangers à l'Ecole des Mines, et à plus forte raison pour ses élèves : elle mérite donc bien de nous arrêter quelques instants. Cette histoire a fait l'objet d'une charmante plaquette, pleine d'érudition et d'esprit, d'un ancien élève de notre Ecole, M. Mahler (La Chartreuse de Vauvert et l'Hôtel de Vendôme ; Béranger édit, Paris 1909).
Au moyen âge, l'enceinte de Paris, du côté sud, s'arrêtait à la place Médicis (aujourd'hui Edmond-Rostand), et, venant d'Orléans, on entrait dans la ville par la porte Gibard ou Saint-Michel, située à l'angle du boulevard Saint-Michel et de la rue Monsieur-le-Prince. Les abords de cette porte étaient infestés de malandrins qui rançonnaient fréquemment les voyageurs attardés; leur repaire préféré était une construction très ancienne, abandonnée, connue sous le nom de « Château de Vauvert ». L'imagination des bourgeois du voisinage le peuplait de spectres, de monstres et de démons, toujours prêts à s'élancer la nuit sur les passants. Le fameux diable « Vauvert, qui gâte tout et qui tout perd » a été le premier occupant du domaine qui devait recueillir notre Ecole, et c'est ainsi que, peut-être sans s'en douter, nos jeunes camarades en entrant à l'Ecole des Mines, s'en vont au diable Vert, abréviation du diable Vauvert, devenue proverbiale. Le diable en fut chassé par les Chartreux, auxquels saint Louis concéda bien volontiers, avec toutes ses dépendances, un château en ruine qui faisait la terreur des honnêtes gens.
Du diable Vert, il ne resta bientôt qu'un lointain souvenir, consacré par le nom de rue d'Enfer, donné à la partie de la route de Paris à Orléans, bordant le domaine des Chartreux - rebaptisée en 1871 rue Denfert-Rochereau par un patriotique calembour en l'honneur du défenseur héroïque de Belfort.
Ce domaine fut bientôt aménagé, assaini, agrandi par ses nouveaux propriétaires et pourvu de jardins ombragés et de superbes cultures, notamment de vignes, dont le vin était célèbre, au point que les rois de France venaient parfois trinquer avec les bons Chartreux de Vauvert : le vignoble sur lequel est située actuellement l'Ecole des Mines s'appelait le « clos de la Forge », nom prédestiné pour l'emplacement d'une école où la métallurgie est en si grand honneur.
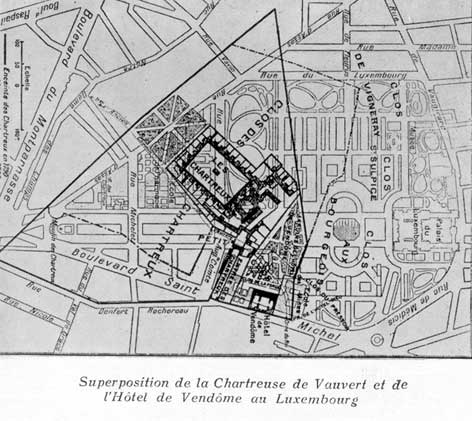
Au XVIIe siècle, les Chartreux eurent l'idée de faire bâtir quelques maisons de rapport du côté de la rue d'Enfer, en bordure de leur monastère, qui était alors entièrement construit et comprenait une magnifique église et un immense cloître, ornés des célèbres tableaux d'Eustache Le Sueur, actuellement au Louvre, représentant la vie de Saint Bruno : le domaine des Chartreux s'étendait alors sur un vaste triangle ayant à peu près pour sommets l'angle Nord-Est de l'Ecole actuelle, le jardin de Bullier et la rue Duguay-Trouin.
Au nombre des maisons construites par les Chartreux, fut édifié en 1707, par l'architecte Courtonne une somptueuse demeure, grâce à une donation de 20,000 livres faite aux Chartreux par le chanoine De La Porte, à charge d'y habiter sa vie durant : cet hôtel forme la partie centrale de l'Ecole actuelle, et sa façade, avec neuf fenêtres, est encore intacte du côté du jardin. Le fastueux chanoine mourut trois ans après, avant d'avoir pu jouir de la belle maison qu'il venait de fonder, et, peu après, en 1714, l'hôtel fut loué à la duchesse de Vendôme, veuve du duc, premier prince du sang en Espagne, le vainqueur de Villaviciosa, qui a puissamment contribué à maintenir sur le trône la maison de Bourbon.
La duchesse trouvant l'hôtel trop petit pour elle et sa maison, le fit agrandir par l'architecte Leblond qui lui ajouta trois fenêtres de chaque côté, créa une grande terrasse à perrons régnant sur toute la longueur de l'hôtel et réunissant le rez-de-chaussée au jardin en contre-bas, formant un vrai parc, qui s'étendait jusqu'à 250 m. dans le jardin actuel du Luxembourg. L'Hôtel de Vendôme et son jardin devinrent bientôt célèbres, et ont été cités comme des modèles dans les traités d'architecture du XVIIIe siècle. L'hôtel a été fréquemment copié à cette époque et l'hôtel de Beauharnais (actuellement ambassade d'Allemagne) construit par l'architecte Boffrand, en reproduit la façade du côté de la Seine.

Le traité d'architecture de d'Aviler, publié en 1738, grâce auquel nous possédons les seules estampes connues de l'Hôtel de Vendôme, avec la vue perspective qu'en donne le grand plan de Paris dressé par Turgot en 1760, permet de se rendre compte des dispositions et de l'affectation des pièces actuelles de l'Ecole dans l'hôtel de Vendôme, auquel il n'a été apporté aucun changement pendant tout le cours du XVIIIe siècle et jusqu'à l'installation de l'Ecole des Mines en 1816.
L'hôtel, de quinze fenêtres en largeur, avait un rez-de-chaussée et un premier étage de grande hauteur, et un second en mansarde, assez bas, surmonté d'une balustrade à fronton. Sur la rue d'Enfer, qui était alors de neuf pieds plus élevée que le boulevard St-Michel, se trouvait une grande cour d'honneur entre deux basses cours entourées des écuries et des communs; ces cours s'avançaient jusqu'au trottoir impair du boulevard actuel, et étaient en bordure de la rue d'Enfer. On accédait dans l'hôtel par la porte qui est vis-à-vis de l'entrée actuelle de la salle du Conseil, et l'on y montait par un petit perron de six marches; en entrant, on apercevait à sa droite le bel escalier qui conduit aujourd'hui aux collections de l'Ecole.
Sur le jardin, le bâtiment édifié par Courtonne et agrandi par Leblond est entièrement conservé, comme le montre le dessin de d'Aviler. On y voit au centre la partie constituant l'hôtel du chanoine de La Porte, à neuf fenêtres en façade; de chaque côté de l'hôtel central, les ailes à trois fenêtres ajoutées par Leblond, dans le style de la façade de Courtonne, qu'ils prolongent sans effet disparate, en portant la longueur du bâtiment à 27 toises. Au rez-de-chaussée, les trois belles pièces centrales sur le jardin, servaient de salle à manger (salle du Conseil actuelle), de salon de réception (amphithéâtre A actuel), et de cabinet d'assemblée (salle de la collection de géologie appliquée). Au premier, les salles en enfilade où est installé le musée de minéralogie, servaient de salons de réception ou de chambres d'honneur. Les trois grandes pièces du centre sont surélevées, suivant la coutume du temps, pour donner plus d'ampleur aux salles de réception, et il en résulte que le plancher du musée de Paléontologie qui est installé dans le second étage, où se trouvaient les appartements privés, présente un ressaut de trois marches dans sa partie centrale. Les cuisines occupaient l'emplacement de la salle Rivot, dans la bibliothèque actuelle, et communiquaient directement avec les immenses caves de l'hôtel, par un escalier, supprimé aujourd'hui, mais dont on peut encore voir les traces sur les murs de ces caves.
La duchesse de Vendôme jouit peu de la belle installation qu'elle avait fait exécuter par Leblond, car elle mourut en 1718, au moment même où Leblond terminait son oeuvre.
Son hôtel acquit une immense célébrité au milieu du 18e siècle, par les splendides réceptions données par les ducs de Chaulnes, qui l'ont occupé 25 ans, de 1733 à 1758, et en particulier par Michel-Ferdinand de Chaulnes, duc de Picquigny, richissime seigneur, président de la Compagnie des Indes, militaire remarquable, savant distingué, excellent musicien (il jouait du violon à ravir), membre de l'Académie des Sciences. Il commandait une partie de l'artillerie à la bataille de Fontenoy et a fortement contribué à la victoire de la France.
Il avait installé un atelier de construction d'appareils de physique dans les salles bordant le couloir actuel allant à la géologie appliquée : on y a construit la première « machine à diviser » et nombre d'instruments de mesure de haute précision.
La femme du duc de Chaulnes, petite-fille d'un riche marchand drapier de Montpellier, le sieur Bonnier, pétillante d'esprit et d'un entrain endiablé, recevait volontiers les confrères de son mari à l'Académie des Sciences, et toutes les semaines on tenait dans l'amphi A actuel une séance de l'Académie au petit pied, où brillaient d'Alembert et le galant Clairaut, qui avait appris en six mois l'algèbre à la séduisante duchesse.
Les salons de l'hôtel de Vendôme étaient les plus célèbres de Paris, au milieu du 18e siècle, et les personnes de qualité passant par la capitale auraient été disqualifiées, si elles n'avaient pas assisté aux réceptions de la spirituelle Mme de Chaulnes.
Les successeurs des Chaulnes dans l'hôtel de Vendôme, jusqu'à la Révolution, n'apportèrent aucune modification dans l'édifice, qui fut confisqué en 1790 par l'Assemblée nationale, ainsi que tous les bâtiments et les terrains des Chartreux. Le couvent et sa belle église furent démolis. L'hôtel de Vendôme mis en vente, fut acheté pour 332.800 livres; le grand enclos et les édifices conventuels des Chartreux, mis à prix 3.600.000 livres, ne trouvèrent pas d'acquéreur solvable, et restèrent propriété de la Nation. Cette circonstance à permis, par la suite, à l'Etat, d'agrandir considérablement le jardin du Luxembourg, en ajoutant au terrain des Chartreux la presque totalité du parc de l'hôtel de Vendôme, vendu au Sénat par les propriétaires de l'hôtel, qui ne conservèrent avec celui-ci qu'une bande étroite le long de la terrasse, formant le jardin actuel de l'Ecole, de 2.800 mètres carrés, dimension fort belle encore pour un jardin en plein Paris.
Au commencement du 19e siècle, l'hôtel de Vendôme était devenu la propriété d'un vieil antiquaire allemand, Hoorn de Wloswyck, qui y mourut en janvier 1809. Une vente d'antiquités mit fin à l'histoire ancienne de l'hôtel de Vendôme, dont toute la décoration intérieure a disparu, sauf le bel escalier en fer forgé montant aux collections, et deux peintures ovales, genre Boucher, qui étaient placées au-dessus des cheminées de deux des grandes salles d'apparat du premier étage, et ont été sans doute oubliées dans la vente : ces derniers vestiges de la splendeur passée de l'hôtel de Vendôme ont été recueillis dans le salon de réception de l'appartement actuel du Directeur de l'Ecole.
Les modifications apportées depuis l'installation de l'Ecole des Mines dans l'hôtel, en 1816, ont été motivées tout d'abord par la nécessité d'agrandir les bâtiments devenus trop exigus pour le nombre de ses élèves : de 1840 à 1852 l'hôtel, acheté par l'Etat en 1837, fut allongé de cinq fenêtres à ses deux extrémités ; ces additions, d'un effet architectural quelque peu contestable, portent à 80 mètres la longueur de l'édifice, longueur qui dans la façade regardant le jardin est excessive pour la hauteur de l'oeuvre de Courtonne, si élégante et si bien proportionnée. On reconnaît aisément ces adjonctions à l'hôtel aux colonnes en fonte qui dans la bibliothèque et les collections de minéralogie et de géologie actuelles, traversent les salles ajoutées aux deux bouts de l'édifice.
Un second changement - encore plus sérieux - a été entraîné par le percement du boulevard Saint-Michel en 1860. Ce percement a abaissé d'environ 3 mètres le sol de la rue d'Enfer, coupé et fait disparaître les communs de l'hôtel, où étaient installés les laboratoires de chimie et les salles de dessin, et l'on a dû édifier, pour remplacer les locaux supprimés, le bâtiment actuel des laboratoires et des salles de dessin, ainsi que les constructions en bordure du nouveau boulevard (direction, secrétariat, salles de travail), séparées par une grande cour du nouveau bâtiment des laboratoires. L'hôtel du Petit-Vendôme, qui avait été occupé sous le Premier Empire par le maréchal Lefèbvre, puis, sous la Restauration, par le président de la Chambre des Pairs, a dû être rasé pour faire place à ces nouvelles constructions, et en passant dans le couloir du nord, menant aux laboratoires de Chimie, nos élèves ne doivent pas manquer d'évoquer le souvenir des salons où a brillé Madame Sans-Gêne.
Les autres modifications apportées depuis 1860 aux installations primitives de l'Ecole ont été nécessitées par les améliorations successives des laboratoires et des collections qu'il fallait tenir au courant des progrès accomplis dans les sciences et l'industrie: ces aménagements font ainsi partie intégrante de l'enseignement de notre Ecole, et c'est dans l'historique de celui-ci que nous aurons l'occasion de les mentionner.
Aussitôt installée à l'hôtel de Vendôme, l'Ecole était munie de tous les actes administratifs devant assurer sa marche régulière : tout d'abord l'ordonnance royale du 5 décembre 1816, suivie le 6 décembre d'un arrêté du ministre de l'Intérieur et complétée peu après par un règlement du 3 juin 1817, sur l'admission des élèves externes. On retrouve dans ces actes le fruit de la longue expérience du Conseil des Mines qui comptait encore à ce moment deux des membres de l'ancienne « Agence des Mines », Gillet de Laumont et Lelièvre, et dont le troisième, Guillot-Duhamel fils, avait été formé à l'école du fondateur de notre cours d'exploitation des mines.
L'évolution de l'enseignement à l'Ecole polytechnique pendant le régime impérial qui l'avait de plus en plus spécialisée dans les considérations théoriques et l'avait notamment allégé des leçons sur les « Travaux des mines », rendait désormais bien difficile la suppression de l'Ecole des Mines de Paris. Toutefois, de minutieuses précautions furent prises dans les nouveaux règlements pour éviter la fâcheuse aventure de Pesey et de Geislautern. L'ordonnance de 1816 stipule en effet expressément que « l'Ecole des Mines, créée par l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 19 mars 1783, est rétablie à Paris » et qu'elle « aura dans les départements une ou plusieurs succursales, sous le titre d'écoles pratiques de mineurs ». Elle fixe à neuf le nombre total des élèves-ingénieurs pris parmi les élèves de l'Ecole polytechnique, et au même chiffre celui des élèves externes qui « envoyés soit par les préfets, soit par les concessionnaires ou les propriétaires d'établissements métallurgiques » auront subi avant leur admission un examen « où ils devront faire preuve qu'ils sont en état de suivre les cours de l'Ecole ». C'est bien, comme on le voit, le plan de l'ancienne Agence de 1794, mais précisé avec soin et mettant obligatoirement l'Ecole des Mines de Paris entre l'Ecole Polytechnique - ou le concours pour les élèves externes - et des écoles pratiques dans les départements, subordonnées à celle de Paris, dont elles ne sont que des « succursales » et n'ayant d'autre but que de compléter par des travaux manuels ou par la « pratique des appareils », l'enseignement théorique donné à l'Ecole des Mines de Paris.
La « succursale » de l'Ecole de Paris dans les départements, celle de Saint-Etienne, venait d'ailleurs d'être créée par ordonnance du 2 août 1816, et les deux ordonnances d'août et décembre 1816, accentuent bien la différence qu'elles entendaient mettre à cette époque dans les fonctions accessibles aux élèves des deux écoles. L'ordonnance du 2 août 1816 décide en effet que l'école des mineurs établie à Saint-Etienne « pour remplacer les écoles pratiques des Mines établies à Pesey et Geislautern » aura pour objet « l'enseignement des jeunes gens qui se destinent à l'exploitation et aux travaux des mines ». Par contre, le titre III de l'ordonnance du 5 décembre 1816 relatif à l'admission d'élèves externes dans l'Ecole de Paris « ayant pour but principal de former des directeurs d'exploitations et d'usines », stipule que les élèves externes ne pourront pas être nommés aux postes d'ingénieurs du corps des Mines, mais « qu'il sera pris des mesures pour qu'à leur sortie de l'Ecole théorique ou de l'Ecole pratique de Saint-Etienne, ils soient convenablement placés dans les grandes exploitations ou établissements des Mines. » L'organisation de l'Ecole des Mines de Paris est réglée en grand détail par l'ordonnance du 5 décembre 1816, complétée pour les détails d'exécution par les arrêtés du 6 décembre 1816 et du 5 juin 1817. Tout d'abord, l'ordonnance institue un « Conseil de l'Ecole » devant se réunir au moins une fois par mois, composé de trois inspecteurs généraux, des professeurs et de l'inspecteur des études, sous la présidence (qui ne fut d'ailleurs jamais effective) du Directeur général des Mines, placé auprès du ministre de l'Intérieur. La présence dans ce conseil de trois inspecteurs généraux, ayant une part considérable dans l'organisation et la marche de l'Ecole des Mines, rappelle implicitement le rôle de l'ancienne « Agence des Mines » dans la direction de l'Ecole.
L'ordonnance institue quatre chaires principales : minéralogie et géologie, docimasie, exploitation des mines, minéralurgie, et des cours secondaires de dessin, d'allemand et d'anglais. Elle prescrit qu'il y aura près de l'Ecole et dans le même local : une collection minéralogique et géologique; une collection des produits d'art qui ont pour objet le travail ou le traitement des substances minérales; une bibliothèque, un dépôt de plans, dessins et modèles relatifs à l'art des Mines - le tout sous la garde de l'inspecteur des études; enfin un laboratoire de chimie et un dépôt des produits des essais et des analyses, dont la direction était confiée au professeur de docimasie. Les travaux pratiques des élèves sont également prévus par l'ordonnance qui renvoie à un arrêté pour leur détail que nous verrons plus loin.
Les professeurs étaient tenus, avant l'ouverture des cours, de soumettre au Conseil le précis développé de chacune de leurs leçons. Les cours devaient être faits entre le 15 novembre et le 15 avril, les élèves étant présents à l'Ecole de 8 heures du matin jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Les examens devaient avoir lieu dans la deuxième quinzaine d'avril.
Les élèves-ingénieurs jugés capables devaient être envoyés dans les écoles pratiques et dans les grandes exploitations de mines où ils devaient faire un véritable stage jusqu'à la rentrée suivante. Les élèves externes devaient suivre à Paris les mêmes cours et exercices que les élèves-ingénieurs et pouvaient aussi être envoyés aux écoles pratiques ou dans de grandes exploitations de mines. En fait, l'envoi dans les écoles pratiques ne fonctionna jamais, et les trois campagnes - pouvant être remplacées par un séjour de douze mois consécutifs dans une école pratique ou sur un établissement de mines - prescrites par l'ordonnance du 5 décembre 1816 ne furent jamais exécutées. Dès 1820, le Conseil de l'Ecole considérait que les exercices pratiques exécutés à l'intérieur de l'Ecole, et les voyages d'instruction qui furent couramment effectués après chaque année de cours, dès le fonctionnement de l'Ecole à l'hôtel de Vendôme et ont persisté jusqu'à nos jours, équivalaient à ces trois campagnes qui étaient un souvenir des idées chères à l'ancienne Agence des Mines.
Les coefficients d'examens, de travaux pratiques et d'assiduité, ainsi que le minimum de points ou « médium » nécessaire pour obtenir le diplôme sont minutieusement fixés par les règlements de 1816. La durée des études n'était pas limitée par l'ordonnance; mais au bout de peu de temps, la pratique s'arrêta pour les élèves-ingénieurs et externes, à trois ans, passés exclusivement à l'Ecole de Paris et coupés par les voyages d'instruction.
L'arrêté du 6 décembre 1816, « portant règlement pour l'Ecole des Mines », spécifie tous les travaux pratiques exécutés par les élèves. Il traite notamment d'une façon précise les « concours » prévus par l'ordonnance et consistant en compositions littéraires, descriptions minéralogiques d'une contrée, lavis de cartes, coupe de pierre et de bois, analyse des substances minérales, projets (avec plans, détails, devis et mémoires) d'exploitation de mines, d'usines métallurgiques et de machines : ces « concours », au nombre de trois au plus par an, sont l'origine des projets et des exercices pratiques de laboratoires d'aujourd'hui.
L'arrêté institue les journaux de voyage, donnant le compte rendu détaillé de l'emploi du temps des élèves et de leurs observations personnelles, les exercices pratiques de topographie superficielle et souterraine, ainsi que les courses minéralogiques dans les environs de Paris. Il prévoit que l'étude des lois et règlements sur les mines fera partie des exercices exécutés dans l'intervalle d'une année à l'autre. Il fixe les règles de discipline intérieure que doivent observer les élèves et les punitions applicables pour infraction à ces règles; par contre, il institue pour les élèves les plus méritants des récompenses allant jusqu'à l'octroi de bourses importantes de voyage.
Il est à noter que l'arrêté du 3 juin 1817 portant « Règlement pour l'admission des élèves externes à l'Ecole des Mines », donne un programme des connaissances exigées, différant très peu du programme actuel : mathématiques, mécanique, physique et chimie y figurent avec le même développement qu'aujourd'hui, eu égard à l'état des sciences à cette époque, et la copie d'une tête d'après un dessin n'y est pas oubliée. On voit apparaître dans ce Règlement l'origine des « cours préparatoires » (institués d'une façon explicite seulement par décision ministérielle du 26 décembre 1844) dans une disposition permettant d'admettre des candidats ayant des connaissances insuffisantes en géométrie analytique, hydrostatique, physique, chimie et dessin, à charge pour eux de suivre, pendant la première année, des cours pour les acquérir et de subir un nouvel examen sur ces matières.
C'est dans ce même règlement que figure à l'article 13, une clause qui a subsisté jusqu'en 1883, et d'après laquelle, à égalité de mérite, on pouvait, faute de place, admettre de préférence les fils de grands industriels miniers ou métallurgiques, - clause qui, mal interprétée, a souvent donné à croire que les fils de grands industriels pouvaient être admis sans examen à l'Ecole des Mines de Paris. En réalité, les choses se passaient ainsi : conformément à l'article 14 de l'ordonnance, les candidats aux places d'élèves externes fixées à 9 au plus, devaient être envoyés soit par les préfets, soit par les concessionnaires ou les propriétaires d'établissements métallurgiques, et c'est entre les candidats ainsi choisis, qu'après les examens d'admissibilité subis en province, devant un ingénieur du corps des Mines (les candidats admissibles à l'Ecole polytechnique étaient dispensés de cet examen préalable), se passait le concours ouvert à Paris et dont les résultats pouvaient, le cas échéant, être soumis à la clause susdite. Nous ne croyons pas d'ailleurs qu'on y ait jamais eu recours, car les agrandissements successifs de l'Ecole ont toujours paré largement aux accroissements prévus du nombre des candidats.
Dans cette organisation, pourtant vieille de plus d'un siècle, il n'est pas un ancien élève de notre Ecole qui ne retrouve l'image des années d'études qu'il y a faites. Ces règlements constituent en effet la « charte » fondamentale de notre Ecole. Il y a été sans doute apporté par la suite quelques retouches et de nombreuses additions, mais le fond en a toujours été respecté, et dans les décrets et arrêtés qui régissent actuellement l'Ecole des Mines, on retrouve intacts les principes établis en 1816 d'après le plan si sagement étudié par l'Agence des Mines de la Convention.
Ce sont, en effet, les grandes lignes de ce plan qui guident encore notre Ecole, et les conceptions de « l'Agence » qui animent son enseignement et se résument dans sa devise lapidaire : « Théorie-Pratique ». Ces termes pouvant être compris de façons quelque peu différentes, il n'est pas inutile d'indiquer ici dans quel sens ils ont été envisagés par ses organisateurs et par tous les continuateurs de leur oeuvre.
Entre la théorie et la pratique, il faut une étape qui en réalise la synthèse et durant laquelle on puisse montrer aux esprits dotés d'une forte culture scientifique, comment les lois générales de la mécanique, de la physique, etc., prennent un corps dans les opérations industrielles. Ce sont ces lois qui en expliquent les succès ou les déboires, mais d'une façon souvent si obscure et détournée, qu'elles échappent à une intelligence, même très ouverte, nourrie seulement jusque-là d'abstractions. Une telle intelligence mise d'emblée aux prises avec le métier proprement dit, risque de passer indéfiniment à côté du problème à résoudre, faute de soupçonner les facteurs dont dépend la solution : c'est le rôle d'une école technique comme la nôtre de les faire connaître aux futurs ingénieurs, ou tout au moins de leur en faire entrevoir l'existence et pressentir la valeur. Il n'est pas nécessaire pour un ingénieur de savoir aussi bien qu'un ouvrier de métier limer un boulon, ajuster des cornières ou pratiquer des mortaises, mais il doit pouvoir se rendre un compte exact des influences qui ne frappent pas les sens : efforts que supporteront les pièces assemblées, propriétés mécaniques des matériaux qu'il emploie, et déterminer leur forme en conséquence.
Certes, il n'est pas mauvais qu'un ingénieur soit adroit de ses mains - cela ne peut pas lui nuire aux yeux de son personnel - mais sa valeur ne dépend pas de son aptitude à pouvoir remplacer à son poste un ouvrier défaillant : on peut être un remarquable directeur de chemins de fer sans être capable de conduire un train.
Ce que l'Ecole doit former avant tout, c'est le cerveau de ses élèves, le bras ne vient qu'après. Les travaux pratiques - car il en faut cependant, et même beaucoup - doivent avoir pour but non pas de faire de nos ingénieurs d'habiles ouvriers, mais de leur apprendre à mesurer de façon précise les facteurs qui influent sur les rendements ou la qualité des produits fabriqués, et qui sont bien souvent ignorés des praticiens les plus adroits. C'est ce qu'avait parfaitement compris l'Agence des Mines en s'appliquant à faire de l'Ecole où devaient être formés les ingénieurs du Corps des Mines et les futurs directeurs d'exploitations et d'usines, la « maison d'éducation » (comme elle l'appelait), placée obligatoirement entre l'Ecole polytechnique et les établissements miniers ou métallurgiques pour lesquels, en même temps, des ouvriers d'élite auraient été formés dans des écoles pratiques. Le triste essai de l'Ecole de Pesey, simple école d'arts et métiers, avait bien montré que la suppression de ce travail d'union indispensable entre la théorie et la pratique ne pouvait aboutir qu'à de médiocres résultats; ce que l'on gagnait en tour de main, on le perdait en hauteur de vue, et l'expérience a montré, en définitive, que l'Ecole des Mines de Paris a bien fait de rester fidèle à ses traditions séculaires, sans jamais oublier l'enseignement des langues vivantes, indispensables pour suivre à travers le monde les progrès de la science et de l'industrie, comme l'avaient si bien prévu nos fondateurs de 1783.
A partir du moment où l'Ecole a été solennellement rétablie à Paris et fortement appuyée sur les règlements de 1816, nos annuaires montrent que les effectifs de nos élèves ont suivi une marche très régulière, les élèves-ingénieurs étant au nombre de 3 à 5 par promotion, les élèves externes atteignant d'abord ce nombre, puis le dépassant bientôt d'une façon constante.
Il nous a paru intéressant de rechercher si à l'origine, comme aujourd'hui, les élèves-ingénieurs des Mines se recrutaient parmi les polytechniciens les mieux classés à la sortie. Les archives de l'Ecole polytechnique sont malheureusement muettes sur les classements généraux de sortie des élèves de 1794 à 1816.
Ces classements avaient lieu jusque-là par service et non pour la promotion entière, le choix des carrières se faisant obligatoirement à l'entrée et non à la sortie de l'Ecole, en vertu de la loi du 25 frimaire an VIII (art. 8 du titre II). On peut toutefois d'après les rangs de sortie, relativement modestes, des élèves-ingénieurs des Mines de la promotion 1817 (13e à 22e), conclure qu'à ce moment l'Ecole des Mines, mal remise de son exil au Mont-Blanc, n'exerçait pas encore un attrait irrésistible sur les polytechniciens. Mais bientôt le courant se dessine, et notre Ecole va prendre désormais la glorieuse habitude de recevoir les élèves sortis les premiers de l'Ecole polytechnique; c'est en 1819 que pour la première fois un major de l'Ecole polytechnique est entré à l'Hôtel de Vendôme : ce major était Jean-Baptiste-Armand Elie de Beaumont.
La réputation croissante de l'Ecole allait promptement nécessiter son agrandissement, pour ses collections, et surtout pour ses élèves dont l'effectif s'augmentait notablement par les élèves autorisés (auditeurs libres d'aujourd'hui) et les élèves étrangers accrédités par leurs ambassadeurs, dont l'apparition dans notre Ecole remonte à 1817 avec deux élèves. Pour cela, il fallait disposer de tout l'hôtel, dont le second étage avait été exclu du bail de 1815, et restait occupé par le propriétaire ou par ses locataires. L'Inspecteur Lefroy, excellent architecte autant qu'habile administrateur, avait dès 1820 ses plans d'agrandissement tout prêts, mais il fallut attendre jusqu'en 1837 pour les réaliser : une loi du 12 juillet autorisa l'achat de l'hôtel pour 380.000 francs. Le plan de Lefroy fut exécuté de 1840 à 1852 pour le gros oeuvre : il consistait, d'une part, en prolongements aux deux extrémités du bâtiment, portant sa longueur à 80 mètres et lui donnant sa physionomie actuelle du côté du jardin, et, d'autre part, sur la rue d'Enfer, en deux ailes perpendiculaires au bâtiment de l'hôtel, enserrant une vaste cour de 32 mètres de largeur, fermée sur la rue d'Enfer par une grille avec arcades en maçonnerie. Les laboratoires portés à 22 places étaient installés au rez-de-chaussée de l'aile nord. Le rez-de-chaussée de l'aile sud était affecté aux salles de dessin, et le premier aux cabinets et laboratoires des professeurs de minéralogie et de géologie. Le directeur, rétabli en 1848, avec Dufrénoy comme titulaire, et l'inspecteur Le Play étaient logés au second étage de l'Hôtel de Vendôme, sur le jardin. A peine cette belle installation était-elle terminée, que le percement du boulevard Saint-Michel obligeait à défaire en partie l'oeuvre de Lefroy et à procéder aux travaux que nous avons décrits plus haut.
Ces travaux ont été les derniers touchant au gros oeuvre de l'Ecole : pendant leur exécution, les laboratoires furent provisoirement aménagés dans une maison située en face, au n° 13 de la rue d'Enfer.
Depuis les agrandissements de Lefroy et les travaux nécessités par le percement du boulevard Saint-Michel, il n'y a pas eu de modifications profondes à enregistrer dans l'organisation et l'enseignement de l'Ecole. L'Ecole des Mines est désormais chez elle, et sans crainte de voir discuter son existence et ses installations, elle se développe normalement, prenant sa large part dans le progrès des sciences, attentive aux besoins de l'industrie et à la sécurité du travail, et étendant au moment voulu le champ de son enseignement par le dédoublement des chaires existantes ou par la création de leçons nouvelles. C'est en effet une caractéristique de notre Ecole que, pour chaque branche nouvelle introduite dans l'enseignement, l'institution d'une chaire distincte proprement dite a toujours été précédée d'un essai, fait d'accord entre le professeur et la Direction ou le Conseil de l'Ecole, soit sous forme de leçons spéciales s'introduisant peu à peu et comme par la force des choses, dans une chaire déjà existante, soit sous forme de conférences, s'incorporant au bout de quelque temps dans la chaire où elles s'adaptaient le mieux, le tout finissant par le dédoublement officiel de la chaire, le jour où l'importance des leçons faites sur un sujet secondaire est devenue telle, que ces leçons méritent de constituer un véritable cours distinct.
C'est ainsi que les quatre cours fondamentaux de 1816 : minéralogie et géologie, doci-masie, exploitation des mines et minéralurgie, faits par quatre professeurs, ont abouti aux 23 cours et à une série de conférences, que comporte l'enseignement actuel, donné par 21 professeurs et 10 chefs de travaux pratiques. Sans entrer dans le détail de ces transformations, il nous suffira de mentionner les étapes les plus intéressantes de cette évolution de près d'un siècle : le dédoublement, en 1835, du cours de minéralogie et géologie, en deux chaires distinctes; la création officielle, en 1844, des cours préparatoires organisés par Delaunay et Rivot; l'institution du Bureau d'Essais en 1845, mettant à la disposition du public les laboratoires de chimie de l'Ecole, qui, depuis 1794, fonctionnaient seulement pour l'Administration; la consécration, par décret du 15 septembre 1856, de chaires distinctes de géologie, de paléontologie, de chemins de fer et construction, d'agriculture, de législation et économie industrielle; une nouvelle refonte des cours en 1887 et 1888, aboutissant au décret du 18 juillet 1890, transformant la chaire d'agriculture en cours de géologie appliquée (évidemment plus indiquée dans une Ecole des Mines qu'une chaire d'agriculture), faisant du cours de machines, une chaire distincte de celles de l'exploitation des mines et de chemins de fer, scindant de même en deux les cours de législation et d'économie industrielle, créant une chaire de chimie industrielle, et complétant les cours par des leçons de pétrographie, de paléontologie végétale, de topographie, de construction de machines et d'applications de l'électricité; enfin, le décret du 18 octobre 1896, érigeant en chaire les leçons d'électricité industrielle et apportant au recrutement des élèves externes une modification importante, nécessitée par la loi militaire du 15 juillet 1889 : tandis que depuis la création des cours préparatoires, les élèves de ces cours devaient, pour passer aux cours supérieurs, subir entre eux un concours qui en éléminait environ un tiers, le décret de 1896 place désormais l'entrée de l'Ecole aux cours préparatoires, en spécifiant que pour être admis aux cours spéciaux, les élèves des cours préparatoires ne seront plus astreints qu'à un minimum de points (70 % du total). On réduisait ainsi le plus possible les inconvénients, au point de vue du service militaire, qui résultaient, pour les élèves des cours préparatoires, de leur échec à l'entrée des cours spéciaux, entraînant pour eux l'obligation de faire deux ans de service militaire de plus que leurs camarades admis aux cours supérieurs.
Nous arrivons enfin au terme de ces évolutions successives, à la dernière période qu'on peut appeler le Régime de la personnalité civile de l'Ecole des Mines.
L'une des conséquences de la loi militaire du 15 juillet 1889, supprimant le volontariat d'un an, avait été d'accroître considérablement le nombre des candidats à l'Ecole. De 45 à la fin du régime du volontariat, ce nombre avait brusquement doublé et s'était maintenu jusqu'en 1899; et tandis qu'auparavant, le nombre des admissions aux cours préparatoires était souvent arrêté au-dessous du maximum autorisé, on avait dû constater, à partir de 1892, qu'on laissait au seuil de l'Ecole bon nombre de candidats parfaitement capables d'en suivre les cours. En même temps, la réputation de l'Ecole au point de vue du placement de ses élèves s'était également accrue, car, à partir de 1897, on constatait que les candidats reçus à plusieurs écoles, optaient en général pour celle des Mines, malgré les avantages que certaines d'entre elles offraient encore à cette époque pour la durée du service militaire.
Frappé de cette situation, la Conseil de l'Ecole jugea, en 1899, le moment venu d'augmenter le nombre des candidats à admettre et de les faire passer de 25 à 40 environ. Mais cet accroissement de l'effectif des promotions exigeait des agrandissements de laboratoires et devait entraîner des augmentations de charges annuelles. Craignant, non sans raison, de ne pouvoir obtenir, sur le budget des Travaux publics, les ressources nécessaires à la prompte réalisation de ce projet, le Conseil, sur le rapport de M. Aguillon, Inspecteur général des Mines et professeur de législation à l'Ecole, se décida à recourir à l'établissement d'un droit de scolarité de 500 francs par an et par élève (déjà envisagé comme désirable par le Conseil dès 1868), droit devant permettre, même avec une attribution très large de bourses, de constituer un excédent de ressources budgétaires capable de couvrir les dépenses de premier établissement et les charges annuelles entraînées par l'accroissement du nombre des élèves.
Ce droit de scolarité ne pouvait être institué que par voie législative : c'est ce qui fut réalisé par la loi de finances du 13 avril 1900 (art. 34), investissant l'Ecole des Mines de la personnalité civile - condition nécessaire pour avoir un budget autonome, contracter au besoin des emprunts, procéder à des adjudications et à des marchés, recevoir des dons sans formalités dilatoires, etc., - puis par les lois du 25 février 1901 (art. 58) et du 8 novembre 1901 (art. 22), stipulant au profit de l'Ecole le droit de scolarité de 500 francs à dater de l'année scolaire 1901-1902.
Le décret du 4 mars 1902 sur l'organisation financière de l'Ecole et celui du 12 mars 1902 sur son fonctionnement, consacraient ces dispositions législatives, et désormais l'Ecole pouvait disposer, en sus des allocations prélevées sur les budgets des ministères pour le traitement de son personnel et l'entretien des bâtiments, de sommes assez importantes pour aborder l'extension de ses laboratoires et de ses salles de cours. Il convient de rappeler ici que M. le sénateur Guillain, rapporteur des lois susdites devant le Parlement, a nettement spécifié à la tribune que les subventions de l'Etat à l'Ecole des Mines devraient toujours dépasser en principe les sommes nécessaires à son fonctionnement normal, de façon à lui permettre, par des économies sagement cumulées, d'entreprendre la création des laboratoires nécessaires à son enseignement : ces engagements ont été quelque peu perdus de vue dans ces dernières années par les pouvoirs publics, mais nous allons voir par quelles aides généreuses cette omission a été réparée.
Mis en possession de cette autonomie financière, le Conseil (comprenant que l'analyse minérale, sans avoir rien perdu de sa très grande importance dans l'art des mines et de la métallurgie, n'offrait plus un champ suffisant pour exercer les élèves aux mesures précises), décida de créer sans tarder de nouveaux laboratoires, ainsi que de nouvelles salles de cours, en y affectant une partie des locaux de la docimasie, très largement dotée dans les agrandissements de 1861; c'est ainsi que, dès 1902, deux salles de cours et le laboratoire de chimie industrielle et métallurgie générale étaient créés dans les dépendances de la docimasie. En même temps, un laboratoire d'électricité était installé, en bordure du boulevard Saint-Michel, dans des soubassements peu utilisés. L'année suivante, un laboratoire de mécanique était créé dans le hall vitré où étaient conservés des modèles de métallurgie et d'installations minières, quelque peu démodés, il faut le reconnaître, depuis les expositions Universelles qui nous les avaient légués. Puis, en 1904, l'outillage des laboratoires de chimie était rajeuni et complété, et le nombre des places d'élèves porté à 48 : en deux ans à peine, toute l'organisation des nouveaux exercices pratiques d'électricité, de mécanique, de métallurgie générale et de chimie industrielle avait été mise sur pied, et l'on ne pouvait plus reprocher à nos élèves de savoir exclusivement « dessécher, calciner et peser » un précipité lavé selon toutes les règles de l'art.
Ces créations et transformations, effectuées grâce aux économies réalisées par l'Ecole sur son budget, ont été poursuivies dans les mêmes conditions jusqu'à la fin de la grande guerre. En 1911 et 1912, le laboratoire de mécanique avait été considérablement agrandi par l'installation de moteurs et de pompes au rez-de-chaussée, dans une construction provisoire en bois, en bordure du boulevard Saint-Michel. Cette construction a été remplacée de 1916 à 1918 par un bâtiment en pierre, surélevé d'un étage formant une grande salle d'exercices pratiques pour la minéralogie et la géologie. En 1913, les laboratoires de chimie analytique ont été fortement améliorés : le nombre de places a été porté à 60 en utilisant mieux l'espace couvert par le grand hall vitré, où ont été disposées huit cabines à balance de précision (d'un modèle inauguré en 1902 et qui a été fréquemment copié depuis dans nombre de laboratoires en France et à l'étranger), puis des cabines plus spacieuses pour l'électrolyse et la volumétrie. Enfin, le laboratoire de métallurgie générale était fortement agrandi, et un laboratoire d'exercices de physique était créé au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Vendôme, sur le jardin.
C'est ainsi que dès avant la guerre, l'Ecole pouvait ouvrir ses portes à des promotions presque doubles de ce qu'elles étaient vers 1900, et il n'était que temps de la mettre en état de le faire, car le nombre des candidats avait largement triplé depuis cette époque.
Notre dernière grande réforme, effectuée avant la guerre, a été celle de la contraction du cycle des études en trois ans au lieu de quatre pour les élèves externes entrés au concours, et en deux ans pour les élèves-ingénieurs et les élèves externes venant de l'Ecole polytechnique. Ce changement a été motivé par la nouvelle loi militaire du 7 août 1913, exigeant de tout citoyen français trois ans de présence sous les drapeaux, au lieu des deux ans de service que demandait la loi de 1905.
La possibilité de réduire la durée des études avait été déjà examinée à différentes reprises; jusque-là, le Conseil de l'Ecole, soutenu par la grande majorité des ingénieurs formant l'Association amicale de ses anciens élèves, avait considéré les trois années de cours spéciaux (réglementaires depuis l'arrêté du 17 avril 1849, et constituant, avec les cours préparatoires, un cycle de quatre ans d'études), comme nécessaires à la haute culture scientifique et technique qui caractérise l'Ecole des Mines de Paris. Mais, en présence du superbe élan patriotique qui avait décidé du sort de la loi de trois ans, le Conseil a pensé qu'on pouvait demander aux élèves un effort suffisant pour réduire d'un an la durée des études, sans leur faire rien perdre de leur valeur, ni de leur efficacité. Chacun a mis du sien dans ce concours général de bonnes volontés : diminution de quelques leçons pour les cours comportant de nombreuses séances d'exercices pratiques, léger allongement des sessions scolaires, utilisation plus complète du temps consacré aux laboratoires. Le renforcement progressif des programmes des classes de mathématiques spéciales avait d'ailleurs fait supprimer peu à peu la moitié des leçons de nos cours préparatoires, dont Ta matière était déjà connue de nos candidats, et cette circonstance a grandement facilité la contraction nécessitée par la réduction de la durée des études. L'essai de cette contraction a été fait pendant l'année scolaire 1913-1914, et dès cette époque le problème a paru assez heureusement résolu par cette expérience d'une année pour qu'elle soit sanctionnée par le décret du 25 février 1914 : le même régime s'est poursuivi sans modification depuis la fin de la guerre jusqu'à présent, et les résultats satisfaisants qu'il a donnés permettent de le considérer comme définitif, alors même que la réduction actuelle du service militaire à un an, permettrait au besoin de reprendre le cycle des études en quatre années, sans nuire sensiblement à l'entrée en carrière de nos élèves diplômés. La réduction du service militaire a seulement permis, en 1929, de porter de 20 à 21 ans la limite d'âge de nos candidats.
Depuis la guerre, il ne s'est produit aucune modification importante dans l'organisation de l'enseignement de l'Ecole; mais les installations des laboratoires ont été largement améliorées grâce aux subventions qui leur ont été accordées chaque année par la Commission générale des Ecoles, fonctionnant au nom du Comité Central des Houillères, du Comité des Forges de France et de la Chambre des Mines Métalliques : c'est ainsi que, notamment, l'outillage des laboratoires de métallurgie générale et de mécanique, a pu être considérablement augmenté et doté des appareils d'essais les plus perfectionnés.
Une dernière amélioration apportée dans les installations de l'Ecole a été la construction, en 1925 et 1926, d'une vaste salle nouvelle, à l'extrémité nord de la bibliothèque, édifiée au-dessus des vestiaires d'élèves, sur un espace de 16 mètres de long et 12 mètres de large, et comportant avec 8 mètres de hauteur, trois étages de rayons, augmentant ainsi d'une bonne moitié la capacité de notre riche bibliothèque, qui étouffait dans le rez-de-chaussée de l'Hôtel de Vendôme et refluait dans les caves et les combles. Bien que la scolarité des élèves eût été portée à ce moment à 2.400 francs en plusieurs étapes, les disponibilités de l'Ecole, qui ne s'élevaient qu'à 200.000 francs, n'auraient pas permis d'engager la dépense de 650.000 francs, à laquelle s'est élevée cette fort belle construction. Les Comités des Houillères et des Forges ont permis de doubler les ressources de l'Ecole, et le complément a été fourni par les anciens élèves qui ont très généreusement répondu à l'appel du Directeur de l'Ecole. Cette salle très spacieuse, munie de tables de travail facilement démontables, peut servir de lieu de réunion pour plusieurs centaines de personnes, et répond ainsi à un besoin que ne pouvaient satisfaire ni les collections, ni les salles de cours à matériel fixe.
Sans doute, les progrès de l'industrie, dont la marche ascendante ne s'arrête jamais, obligeront, par la suite, nos successeurs à envisager de nouvelles améliorations, peut-être même de nouveaux agrandissements dans notre Ecole, soit en élevant ses constructions vers le ciel, soit en les prolongeant dans la terre, comme vient de le faire l'Ecole Centrale. Mais pour le moment nos élèves n'ont pas à se plaindre de l'espace dans lequel évolue l'enseignement qui leur est donné. Un illustre professeur américain de l'Université Harvard, M. Kennelly, auquel nous venions de faire visiter notre Ecole, et qui, dans chaque laboratoire et chaque salle d'étude, avait noté soigneusement le nombre d'élèves pouvant y travailler ensemble, nous dit en quittant l'Ecole : « Monsieur le Directeur, vos laboratoires sont beaucoup plus grands que les nôtres. Vous avez 220 élèves et vous pourriez en faire travailler ensemble plus de 300. Notre Université compte 20.000 étudiants, et nos laboratoires ne peuvent en recevoir que 1.000 à la fois. » Tout en faisant la part de l'exagération que comporte sans doute cette aimable boutade, il est cependant très intéressant pour nous de voir le cas que font de nos installations les plus grandes écoles des Etats-Unis d'Amérique.
Arrivés au terme actuel atteint par notre Ecole, dans l'évolution de son enseignement et des installations servant à l'illustrer, nous croyons utile de résumer brièvement les conditions dans lesquelles elle fonctionne depuis le dernier décret qui la régit (19 septembre 1919).
L'Ecole des Mines est administrée par un Inspecteur général des Mines, placé sous l'autorité du ministre des Travaux publics et portant le titre de Directeur de l'Ecole. Celui-ci est assisté par le Conseil de l'Ecole des Mines, et par un Comité d'Enseignement; il est secondé par un sous-Directeur, Inspecteur général, ou Ingénieur en chef des Mines, qui doit être choisi parmi les professeurs titulaires de l'Ecole. Le sous-Directeur est chargé spécialement de la direction des études.
Le Conseil de l'Ecole est composé de trente-six membres, comprenant dix professeurs de l'Ecole, des directeurs du ministère des Travaux publics, des représentants du Parlement, de l'Association des anciens élèves de l'Ecole, du Conseil municipal et de la Chambre de Commerce de Paris, etc., ainsi que douze grands industriels, pour la plupart anciens élèves de l'Ecole des Mines. Il a la haute main sur l'administration de l'Ecole et en particulier sur les questions financières; il délègue ses pouvoirs pour les affaires courantes à une section permanente de sept membres pris dans son sein.
Le Comité d'Enseignement comprend tous les professeurs titulaires et prépare toutes les questions relatives à l'enseignement.
Le Directeur de l'Ecole est Président de ces trois Conseils ou Comités, et le sous-Directeur en est le Secrétaire.
Les cours sont partagés en deux catégories : les cours à occupation principale, dont les titulaires sont entièrement attachés à l'Ecole par leurs cours, les exercices pratiques, les examens, etc., mais peuvent être autorisés à occuper un emploi étranger à l'Ecole, compatible avec leurs obligations professionnelles, et les cours à occupation accessoire, dont les titulaires peuvent être soit des fonctionnaires, soit des industriels, n'ayant en principe d'autres occupations scolaires que leurs leçons et les examens correspondant à leur cours. Ce régime permet ainsi à nos professeurs de rester en contact étroit avec les industries auxquelles prépare l'Ecole des Mines, et de tenir leur enseignement au courant des progrès de ces industries, progrès dont ils sont fréquemment les auteurs.
L'Ecole reçoit comme par le passé : des élèves ingénieurs du corps des Mines, recrutés soit parmi les élèves de l'Ecole polytechnique classés à leur sortie dans les services des mines métropolitains ou coloniaux, soit parmi les ingénieurs adjoints des Travaux publics (service des Mines), ayant satisfait à un concours spécial, après six ans de service au moins; des élèves titulaires français, admis soit par voie de concours (la limite d'âge est de 17 ans au moins et 21 ans au plus dans l'année où a lieu le concours), soit sans examen, à condition d'être sortis de l'Ecole polytechnique avec des notes satisfaisantes; des élèves titulaires étrangers (il n'y a pour les candidats étrangers qu'une limite d'âge inférieure : 17 ans au 1er janvier de l'année du concours), admis par la voie d'un concours distinct de celui des élèves français, mais portant sur le même programme, qui est celui de l'admission à l'Ecole polytechnique; des élèves étrangers fonctionnaires, admis à l'Ecole sur demande de leur gouvernement et justifiant d'une instruction leur permettant de suivre les cours de l'Ecole; enfin, des auditeurs libres, français ou étrangers, admis à suivre tout ou partie des cours et ne pouvant obtenir à leur sortie qu'un certificat d'études, au lieu du diplôme que seuls peuvent recevoir les élèves proprement dits.
Le nombre des élèves admis chaque année est très soigneusement limité par les Conseils de l'Ecole au contingent d'ingénieurs demandés par les industries auxquelles l'Ecole prépare spécialement : mines, métallurgie, électricité, chemins de fer, produits chimiques, etc. : le diplôme d'ingénieur civil des Mines qu'elle décerne garde ainsi toute sa valeur, sans risquer d'être déprécié par une surabondance d'anciens élèves en quête de situations, parfois très rares dans les périodes de crise industrielle.
Le chiffre des admissions, calculé d'après ces considérations, est à peu près constant et s'élève à cinquante candidats français et dix étrangers reçus au concours, ce qui, avec les élèves-ingénieurs au nombre de cinq en moyenne, les polytechniciens admis sans examen, les élèves fonctionnaires étrangers et les auditeurs libres, porte à 220 élèves environ le total des trois promotions suivant ensemble l'enseignement de l'Ecole.
Le régime de l'Ecole est l'externat, régime qui a toujours été celui de l'Ecole des Mines de Paris. Les cours ont lieu, en principe, au nombre de deux dans la matinée, à 8 h. 1/2 et 10 h. 1/4, et les exercices pratiques dans l'après-midi, de 1 h. 1/2 à 5 ou 6 heures.
L'enseignement oral comprend les matières suivantes, comportant environ 720 leçons ou conférences réparties ainsi entre les trois années d'études :
Première année. - Analyse. Mécanique. Physique. Chimie générale. Exploitation des mines. Métallurgie générale. Sidérurgie.
Deuxième année. - Minéralogie. Paléontologie. Géologie générale. Analyse minérale. Electricité industrielle. Résistance des matériaux. Machines. Topographie. Hygiène industrielle. (Les cours de Minéralogie, Paléontologie et Géologie générale sont publics).
Troisième année. - Construction de machines. Pétrographie. Géologie appliquée. Métallurgie des métaux autres que le fer. Procédés de construction. Chemins de fer. Législation. Economie industrielle. Chimie industrielle. Conférences sur des spécialités. (Le cours de Pétrographie est public).
En outre, des leçons d'allemand et d'anglais sont données durant tout le cours des études par des répétiteurs choisis parmi les professeurs agrégés des lycées de Paris (au nombre de dix pour chaque langue), à raison de deux séances d'une heure par élève et par semaine, d'après la méthode directe par conversation, chaque répétiteur n'ayant à sa leçon que 5 à 8 élèves au plus par séance, de façon que chaque élève puisse converser à son tour avec le professeur.
Les élèves venant de l'Ecole polytechnique sont dispensés des cours d'analyse, mécanique, physique et chimie générale, qu'ils ont déjà suivis à l'Ecole polytechnique, et les horaires sont prévus de manière qu'ils puissent suivre en deux ans les cours des trois années du cycle total.
Les exercices pratiques répartis entre les trois années d'études sont les suivants :
1. Etude du dessin de machines en première année et exécution dans les années suivantes de six projets portant sur les matières : Exploitation des mines, Sidérurgie, Machines et Electricité industrielle;
2. Travaux pratiques de Géologie générale, Minéralogie, Pétrographie, Paléontologie, Géologie appliquée, Chimie générale, Chimie analytique, Chimie industrielle, Métallurgie générale, Mécanique et Machines, Electricité industrielle, Physique et Topographie.
Le nombre actuel des professeurs titulaires est de 16, des professeurs suppléants, de 2, et des maîtres de conférences, de 2. Les chefs de travaux sont au nombre de 11, et celui des aides-préparateurs, de 5.
D'après les horaires actuellement en vigueur, les 6/10 des heures d'études de l'année scolaire sont consacrés aux exercices pratiques et les 4/10 à l'enseignement oral : le travail personnel de l'élève, en dehors même des visites industrielles, des courses géologiques, des stages et des deux voyages d'instruction en France et à l'étranger, entre les années d'études, a donc une part prépondérante dans le système d'études de l'Ecole des Mines, qui permet ainsi aux élèves de développer leur initiative individuelle par un travail personnel, simplement guidé ou surveillé par leurs maîtres (le second voyage des polytechniciens a lieu après leur deuxième et dernière année d'études).
Le lendemain de l'investissement de Paris par les Prussiens, le 18 septembre 1870, l'Ecole fut mise en état de siège par son inspecteur, M. Etienne Dupont, remplaçant le directeur malade, M. Combes.
Tous les échantillons de valeur furent retirés des collections et déposés dans les caves des laboratoires de chimie, puissamment voûtées, mais pour plus de sûreté, M. Dupont, afin de les mettre complètement à l'abri des obus, fit recouvrir le sol des laboratoires de 1 m. 20 d'épaisseur de terre. Toutes les fenêtres de la façade sud, la plus exposée aux bombardements, furent garnies de sacs à terre. Le pourtour de l'Ecole fut dépavé, et les pavés furent disposés pour défendre les ouvertures du rez-de-chaussée. Deux cents baquets d'un hectolitre, constamment remplis d'eau et accompagnés de seaux en zinc, furent disposés en tous les points particulièrement exposés de l'Ecole, et le préparateur de chimie, M. Rigout, logé à l'Ecole, fut chargé de la surveillance de ce matériel et de son utilisation en cas de besoin : c'est grâce à ces sages précautions que l'Ecole ne fut pas incendiée, comme on le verra par la suite.
Le 2 octobre, sur l'initiative de M. Dupont, une ambulance militaire, plus spécialement destinée aux fiévreux, avait été installée dans les pièces du rez-de-chaussée de l'Hôtel de Vendôme. Cette ambulance, qui resta en fonction jusqu'au 29 janvier, reçut 227 malades, dont 13 seulement, soit 6 %, succombèrent. Ces résultats, beaucoup plus satisfaisants que ceux des autres ambulances parisiennes, témoignent de l'excellente organisation que sut réaliser l'Inspecteur Dupont, et en même temps des conditions exceptionnelles d'aération des salles en bordure du jardin.
C'est dans cet intervalle que commença, le 5 janvier 1871, le bombardement de Paris par les Prussiens : il devait durer 21 jours. Deux obus tombèrent sur l'Ecole le 12 janvier, provenant de pièces en batterie sur le plateau de Châtillon. Le premier éclata en traversant les combles mansardés de la collection de paléontologie, et ses éclats tombèrent, dans l'angle nord-ouest de la salle nord, ou l'on aperçoit encore dans le plancher une entaille produite par l'un d'eux (les débris de l'obus sont conservés dans une vitrine de la collection, près du point où le projectile est tombé). Les dégâts matériels furent insignifiants et il n'y eut aucun accident de personnes. Le second obus traversa sans éclater le mur sud du cabinet du professeur de minéralogie, et en écorniflant seulement la boiserie d'une vitrine.
A vrai dire, nous ne pensons pas que l'Ecole fût particulièrement visée par les Prussiens, car, dans ce cas, elle eût certainement reçu un plus grand nombre de projectiles. Les deux obus qui l'ont atteinte ont été vraisemblablement des coups longs destinés à faire sauter une grande poudrière, installée, à la demande du service militaire, par M. Dupont, avec le concours de M. Moissenet, directeur des laboratoires de chimie, sur l'emplacement actuel du lycée Montaigne, qui était alors un terrain vague. L'artillerie se servit beaucoup de cette poudrière, qui fut copieusement bombardée du 9 au 21 janvier, mais sans en souffrir, bien que nombre d'obus soient tombés sur elle. Le recouvrement en terre et pavés dont elle avait été munie par les ingénieurs de l'Ecole des Mines, la protégeait si bien que, plus tard, le 24 mai, les fédérés ne parvinrent pas à faire sauter cette poudrière par l'explosion de plusieurs barils de poudre détonant sur sa couverture.
On voit que l'Ecole des Mines a en somme très peu souffert du bombardement de 1871. Le risque le plus grand qu'elle ait couru à cette époque est venu de la présence dans l'Ecole d'un membre de la Commune, le sinistre docteur Parisel, qui s'y était installé pour fabriquer dans ses laboratoires des produits incendiaires avec du phosphore : c'est la vigilance du chef des Travaux chimiques, M. Rigout, resté seul dans l'Ecole pendant la Commune, avec un gardien (l'Inspecteur Dupont ayant été mandé à Versailles par le gouvernement), qui a sauvé ses bâtiments des incendies provoqués maintes fois par les imprudences du chimiste peu expérimenté qu'était le Dr Parisel.
Les élèves qui formaient l'effectif de l'Ecole au moment de la guerre avaient dû aller remplir leur devoir militaire, sans se préoccuper des obligations scolaires qui pouvaient leur rester à accomplir. Plusieurs le firent avec éclat. Deux furent décorés au siège de Paris : MM. Amalric, externe de 3e année, comme capitaine des mobiles du Tarn; Pélissier, externe de 2e année, comme lieutenant à l'artillerie de la garde mobile de la Seine. Deux furent tués à l'ennemi : Coste, sujet très distingué, élève externe de 3e année, sergent aux éclaireurs de l'armée du Nord, tué à la bataille d'Amiens; Laval, élève libre des cours préparatoires, tué à la bataille du Mans. Plusieurs autres furent grièvement blessés, et deux, Rigaud et Andrieux, succombèrent des suites de leurs blessures ou de maladies contractées au front. Ce glorieux tribut à la défense de la patrie était le prélude des émouvants sacrifices que devait faire notre Ecole pendant la grande guerre.
Les cours, repris le 15 mars 1871, peu après la conclusion de l'armistice, furent interrompus presque aussitôt, le 23 mars, par les événements de la Commune, et ce fut seulement le 19 juin suivant qu'eut lieu la réouverture définitive de l'Ecole, avec son fonctionnement normal.

Elèves instruits de l'usage du canon de 120 mm lors d'une inspection par le général Perruchon, dans la cour de l'Ecole, le 12 mai 1914
Au moment de la déclaration de guerre, professeurs et élèves étaient en vacances ou en voyage d'instruction, et le personnel de l'Ecole, déjà à peu près vide, était bientôt réduit, par la mobilisation générale, à son sous-directeur et à quelques agents ayant largement dépassé l'âge de la territoriale. Le Directeur, M. Küss, venait d'entrer dans une clinique pour y subir une grave opération, à laquelle il ne devait malheureusement pas survivre.
D'après un ordre de mobilisation de 1901, les bâtiments de l'Ecole auraient dû être affectés à une ambulance, dont les résultats obtenus en 1871 garantissaient, semble-t-il, le parfait fonctionnement. Malgré les instances réitérées du sous-directeur et les aménagements qu'il avait fait préparer avec l'aide du personnel restant, la Croix-Rouge en décida autrement, et c'est au collège Sévigné que fut installée, bien médiocrement, il faut le reconnaître, l'ambulance du 6e arrondissement. L'Ecole était donc inutilisée pour la défense nationale, et elle le resta jusqu'au retour du gouvernement à Paris, le 31 décembre 1914, jour où le ministère des Travaux publics nous donna l'ordre de recevoir immédiatement le Service Central de la Trésorerie aux Armées, qui s'y installait dès le lendemain.
C'est ainsi que, pendant toute la guerre, les locaux de l'Ecole ont été occupés par ce service qui a compté jusqu'à 150 officiers et employés ou soldats installés dans les bâtiments des laboratoires, avec cuisine au sous-sol, réfectoire dans celui-ci, protégé par des voûtes épaisses, qu'on utilisait en cas de bombardements, dortoirs dans plusieurs laboratoires d'élèves pour les poilus de garde, etc. Nous avions réservé seulement, en sus des bâtiments de l'Hôtel de Vendôme, notre laboratoire personnel, un laboratoire d'élèves et le Bureau d'Essais qui ont servi pendant toute la guerre à de nombreuses recherches pour la défense nationale : analyses de fontes aciérées pour obus, d'alliages métalliques pour avions, étude de gaz asphyxiants, etc.
Est-ce la présence de la Trésorerie aux Armées qui a motivé le bombardement de l'Ecole par les avions ennemis, ou plus simplement la facilité de viser des bâtiments le long d'un boulevard brillamment jalonné depuis la gare de l'Est jusqu'à Montrouge, par les tramways de cette ligne, toutes lampes allumées, la Préfecture de police ne s'étant pas encore avisée de les faire circuler toutes lumières éteintes?
Quelle que soit l'explication à donner de ce fait, trois bombes de 100 kg chacune ont été lancées sur l'Ecole par un avion allemand, le 30 janvier 1918, à 23 h. 35. Il est à noter que des trois bombes de 300 kg et neuf de 100 kg, lancées ce soir-là par l'escadrille ennemie, seules les trois bombes de l'Ecole des Mines ont fait explosion, et les neuf autres ont raté. Les trois projectiles lancés sur l'Ecole l'ont heureusement manquée de quelques mètres : ils sont tombés sur le trottoir bordant l'Ecole, à 3 mètres du mur extérieur, et à 12 mètres les uns des autres, entre la porte du no 60 et celle du 60 bis. La première et la troisième bombe ont éclaté sur le trottoir et ont formé de grands entonnoirs dans celui-ci; la deuxième est tombée sur une partie dénudée, autour d'un arbre, et n'a fait explosion qu'à trois mètres de profondeur, sur le tunnel du chemin de fer de Sceaux, en formant dans la terre un conduit conique par lequel les gaz se sont dégagés avec violence.
Les éclats des bombes ont tué sur le boulevard un cocher en stationnement près de la rue Royer-Collard, et un passant, M. Paris, Ingénieur des Manufactures de l'Etat.
Les dégâts dans l'Ecole ont été assez importants. Toutes les vitres des fenêtres donnant sur le boulevard ont été pulvérisées en menus morceaux qui ont été projetés horizontalement à l'intérieur du bâtiment, avec une vitesse énorme, en ne saccageant que les objets se trouvant dans la zone comprise entre les fenêtres et leur projection sur le mur opposé. Les gaz de la bombe no 2 ont produit des effets singuliers : un bloc de granit, formant bordure du trottoir, a été lancé par les gaz, vers l'Est, par-dessus les maisons face à l'Ecole, et est retombé à 500 mètres de là, dans le lit d'une infirmière de l'hôpital Lhomond, fort heureusement absente de chez elle. Les gaz lancés vers l'Ouest, après avoir ricoché sur de grosses poutres disposées au plafond du Laboratoire de mécanique en construction, sont entrés par une fenêtre dans la cage de l'escalier menant dans l'appartement du Directeur, ont enfoncé la porte de cet appartement, saccagé son antichambre et sont ressortis dans la cour d'honneur, en ricochant d'un mur à l'autre et brisant plusieurs fenêtres. Le vitrage des laboratoires de chimie est seul resté intact, protégé par les murs qui l'environnent sur ses quatre côtés.
Les bombes sont tombées si près du mur de l'Ecole que pas un éclat n'y est entré directement par les fenêtres.
Une demi-heure après le bombardement, il y avait sur le boulevard des centaines de personnes qui se disputaient les débris des torpilles, et nous n'avons pu conserver, comme souvenir des projectiles destinés à l'Ecole, qu'un seul éclat entré dans notre appartement par ricochet sur l'embrasure d'une fenêtre, et les multiples cassures de la glace centrale de son grand salon, religieusement conservée dans cette tenue de combat.
Sauf un gardien de laboratoire qui a eu des écorchures sans gravité à la tête, personne n'a été tué ou blessé dans l'Ecole.
Le bombardement de la grosse Bertha, bien que l'Ecole fût dans le plan de tir de la première pièce, ne l'a pas atteinte directement; l'Ecole n'a reçu que quelques petits éclats de l'obus tombé dans le bassin du Luxembourg et de celui tombé dans la rue de Médicis. Mais ce bombardement, commencé l'avant-veille des compositions écrites du concours d'admission ouvert en mars 1918, nous a forcés à disposer à la hâte des tables de composition, complètement à l'abri du bombardement, dans les caves de l'Hôtel de Vendôme, et cela a été un spectacle inoubliable de voir nos 95 candidats, alignés dans le grand souterrain longitudinal de 80 mètres de cet hôtel, éclairés par 25 lampes électriques, et faisant tranquillement leurs compositions pendant que l'on entendait tous les quarts d'heure, le bruit sourd de l'éclatement des obus de la grosse Bertha, dont l'un provoquait l'abominable massacre des fidèles de l'église Saint-Gervais, assistant au service du vendredi saint.
Comme on le voit, l'Ecole l'a échappé belle, mais en somme elle s'en est tirée à peu près intacte, tandis qu'au loin, ses élèves tombaient nombreux, hélas! en défendant le sol de la patrie.
Dès le premier jour de la mobilisation, les 157 élèves français des trois promotions présentes à l'Ecole et les candidats reçus au concours de 1914, partaient pour le front, et étaient bientôt rejoints par leurs anciens, formant un total d'environ 700 mobilisés qui ont soutenu vaillamment le renom de notre chère Ecole, en obtenant plus de quatre cents citations à l'ordre du corps dont ils faisaient partie, et une centaine de médailles militaires, nominations et promotions dans la Légion d'honneur. Cent dix de nos camarades sont tombés sur les champs de bataille ou sont morts, soit des suites de leurs blessures, soit de maladies contractées en service de guerre; dans ce nombre impressionnant figurent 36 des élèves qui auraient dû être présents à l'Ecole pendant les années de guerre.
Tous les élèves des promotions postérieures à la loi militaire de 1905, affectant à l'artillerie les élèves de l'Ecole des Mines, ont fait la guerre dans cette arme. Les élèves des promotions antérieures mobilisables ont été affectés soit au génie, soit à l'infanterie, sauf ceux sortis de l'Ecole polytechnique qui, pour la plupart, étaient officiers d'artillerie. Au cours de la guerre, un très grand nombre de nos élèves artilleurs des jeunes promotions, ont été déversés dans l'aviation, où ils ont rendu d'inappréciables services (c'est l'un d'eux, le lieutenant Pierre Leseur qui a effectué le 14 septembre 1916 le raid Salonique-Bucarest avec retour le 18 ; nous mentionnerons en outre que le zeppelin L. Z. 77 a été abattu à Revigny, le 21 février 1916, par une section d'auto-canons de 75 commandée par un de nos jeunes camarades, le sous-lieutenant d'artillerie Mourral). La plupart des ingénieurs de notre Ecole, dégagés par leur âge de toutes obligations militaires, qui occupaient de hautes situations dans des industries en lien étroit avec les besoins des unités combattantes, ont été appelés à former l'état-major et les cadres de l'armée industrielle, soutien indispensable de l'armée du front : et c'est ainsi que toutes les générations d'ingénieurs issus de l'Ecole des Mines ont apporté, grâce, il faut le reconnaître, aux solides enseignements qu'ils y avaient reçus, une part considérable dans l'admirable effort déployé par la nation entière pour la défense de la patrie.
Les pages glorieuses des citations obtenues par nos camarades combattants, montrent avec quel courage, quel sang-froid et quel mépris du danger, ils ont accompli les missions périlleuses qui leur étaient confiées : nous n'en donnerons ici comme exemple que quelques-unes des citations obtenues par des camarades morts pour la patrie, et appartenant à des promotions anciennes ou jeunes.
Promotion 1893. - DE CHAMBURE (Maurice) Ingénieur civil. - Chef de bataillon au 73e d'infanterie territoriale, cité à l'ordre de sa division dans les termes suivants : « Officier supérieur de grand mérite et d'une haute valeur morale. Major de tranchées sur le canal de l'Yser, dans un secteur menacé par l'inondation et constamment bombardé, a dirigé cet important service avec une activité et un mépris du danger au-dessus de tout éloge. Appelé dans un autre région au commandement d'un centre de résistance de première ligne, en a réglé les travaux avec l'autorité que lui donnent ses connaissances techniques, et a su faire de son bataillon une unité bien en main, dont il a l'entière confiance. »
Promotion 1903. - MULLERET (René), Ingénieur civil. - Lieutenant au 246e d'infanterie, a été décoré de la Légion d'honneur, le 28 février 1915, avec le motif suivant : « Porte-drapeau, a été blessé grièvement le 6 septembre 1914, à Barcy, au moment où il montait à l'assaut, drapeau déployé. Revenu sur le front le 30 janvier 1915, et placé à la tête d'une compagnie, a été de nouveau blessé grièvement le 7 février, à côté de son chef de bataillon, tué à ses côtés. » Mort des suites de ses blessures.
Promotion 1905. - DUBOIS (Marcel), Ingénieur au Corps des Mines. Capitaine à l'escadrille M. F. 16.
Après une première citation à l'ordre de l'armée, a été fait Chevalier de la Légion d'honneur, le 2 janvier 1916, avec le motif suivant :
« Pilote remarquable et commandant hors de pair : a fait preuve dans des circonstances difficiles de la plus grande énergie et du plus grand sang-froid. »
Promotion 1905. - LÉCHALAS (Abbé Henri), Ingénieur civil. - Capitaine du génie, chef du service télégraphique d'un corps d'armée, a été cité à l'ordre de l'armée, en octobre 1917, dans les termes suivants :
« Officier d'un dévouement et d'une bravoure au-dessus de tout éloge. Animé d'un esprit très élevé du devoir, joignant à ses remarquables qualités de technicien et de soldat la plus belle modestie. A été mortellement blessé au cours d'une reconnaissance en secteur. »
Promotion 1905. - DE GENOUILLAC (Jean), Ingénieur civil. - Lieutenant au 41e d'artillerie. Cité à l'ordre de l'armée, le 8 septembre 1915, dans les termes suivants :
« Officier d'une rare bravoure. S'est courageusement porté au secours de soldats du génie en danger d'asphyxie dans un rameau de mine à la suite de l'explosion d'une contre-mine et y est resté asphyxié, victime de son dévouement. »
Promotion 1912. - MUSNIER DE PLEIGNES (Pierre), élève à l'Ecole. - Sous-lieutenant au 7e régiment d'artillerie; cité à l'ordre de l'armée, le 1er octobre 1915, dans les termes suivants :
« Officier d'un dévouement absolu et d'une bravoure exceptionnelle. Observateur d'artillerie aux tranchées, s'est rendu aux premières lignes le 8 septembre, sous un bombardement intense. Au moment de l'attaque, a pris un fusil et s'est fait tuer en défendant la tranchée avec l'infanterie. »
Promotion 1914. - GERVAIS DE LAFOND (Marc-Gaston). Elève reçu au concours de 1914. - Sous-lieutenant d'artillerie à l'escadrille P. 19. A été fait chevalier de la Légion d'honneur à son lit de mort, le 8 avril 1917, avec le motif suivant :
« Observateur remarquablement brillant. A l'escadrille depuis plus de quinze mois, y a rendu d'inappréciables services par son activité et son courage. Parti le 8 avril 1917 pour une mission de réglage, malgré des circonstances très défavorables, a été très grièvement blessé. Déjà deux fois cité à l'ordre. »
Décédé en septembre 1917, des suites d'une maladie contractée en service, après avoir été décoré de la Légion d'honneur.
2e Citation à l'ordre de l'armée (20 juillet 1916) : « Par ses qualités de chef et d'organisateur, malgré des pertes cruelles, a su faire rendre à son unité les services les plus considérables et les plus divers, réglages, reconnaissances et bombardements de jour et de nuit, liaisons d'infanterie, photographies. A toujours donné le plus bel exemple, effectuant le premier les missions les plus périlleuses. »
Tué en combat aérien dans la Somme et tombé dans les lignes allemandes, le 21 juillet 1916. Inhumé à Roye, le 23 juillet 1916 : les honneurs militaires lui ont été rendus par l'ennemi.
Dès la fin des hostilités, l'Association amicale des Elèves de l'Ecole des Mines s'est occupée d'ériger à l'intérieur même de l'Ecole un monument commémorant nos héroïques camarades morts pour la patrie pendant la grande guerre, et il a été décidé, d'accord avec la direction de l'Ecole, que l'on honorerait en même temps les camarades tombés au champ d'honneur en 1870 et ceux qui, durant l'histoire séculaire de notre Ecole, ont été victimes d'accidents dans l'accomplissement de leurs devoirs professionnels ou sont morts au cours de missions lointaines. C'est ainsi que le monument comprend deux plaques de marbre blanc scellées de part et d'autre de la grande baie donnant accès à l'escalier des collections, et par laquelle passent tous les jours les élèves en se rendant aux cours dans l'amphithéâtre A. Nos jeunes camarades auront donc sans cesse sous les yeux les noms sacrés de ceux qui ont donné leur vie pour le salut ou la grandeur de la France, et leur pensée ira ainsi tous les jours vers la garde d'honneur de notre chère Ecole.
L'inauguration de ce monument a eu lieu le 30 juin 1919. M. le sénateur Lebrun, ingénieur au corps des Mines de la promotion 1893, ministre des Régions libérées, représentait le gouvernement dans cette émouvante cérémonie, qui réunissait à côté des familles des glorieux morts inscrits sur le marbre, le Directeur, les professeurs et les élèves de l'Ecole, les membres du Comité de l'Association et les Directeurs des grandes Ecoles techniques : Polytechnique, Mines de Saint-Etienne, Ponts-et-Chaussées, Centrale et Institut agronomique, qui avaient tenu à nous apporter, par leur présence, le précieux témoignage de leur sympathie.
Après remise du monument par le Président de l'Association, M. Bâcle, au Directeur de l'Ecole, M. Chesneau, et la réponse de celui-ci au discours de M. Bâcle, le secrétaire général de l'Association, M. Chapot, a procédé à l'appel solennel des morts, suivi de la traditionnelle réplique : « mort au champ d'honneur! » faite par deux élèves de l'Ecole promus officiers de la Légion d'honneur pour faits de guerre, et c'est avec un sentiment d'émotion poignante que l'assistance a écouté ces discours et appels, ainsi que les chants patriotiques admirablement exécutés, sous la direction de l'émanent maître M. Julien Tiersot.
La dernière étape de cette marche guerrière de notre Ecole a été la remise de la croix de guerre qui lui a été décernée le 11 octobre 1925, par le ministre de la Guerre, avec la citation suivante à l'ordre de l'armée :
« L'Ecole nationale supérieure des Mines a fourni au cours de la grande guerre une élite d'officiers de complément, spécialement pour l'artillerie, dont la science étendue, le généreux esprit de sacrifice et le noble dévouement ont grandement contribué au triomphe de la France. »
La remise de la croix de guerre à l'Ecole a donné lieu à une émouvante cérémonie qui s'est déroulée le 13 juin 1926 dans la grande salle de la bibliothèque, inaugurée par cette séance mémorable. Elle était présidée par le Maréchal Foch, entouré des Directeurs de toutes les grandes écoles techniques. Nous reproduisons une photographie prise au moment où le Maréchal donne lecture de la citation à l'assemblée qui remplit la salle, les anciens élèves décorés de la croix de guerre et leurs familles assis au parquet, les élèves présents à l'Ecole occupant les galerie de la bibliothèque. La cérémonie, au cours de laquelle des chants patriotiques ont été interprétés d'une façon splendide par l'admirable voix d'une jeune femme tenant de très près à l'Ecole, s'est terminée par un défilé de tous les assistants devant le monument commémoratif de nos camarades tombés au champ d'honneur.

Et d'abord, la camaraderie. Elle a son histoire tout comme l'Ecole, et son évolution correspond à celle du recrutement des élèves. C'est pour former des ingénieurs chargés de la surveillance des mines qu'a été créée en 1794 l'Ecole des Mines de la Convention qui, jusqu'à la fin du Premier Empire, n'a eu guère comme élèves que des élèves-ingénieurs du corps des Mines, classés dans le service des Mines à leur sortie de l'Ecole polytechnique. Il y avait donc, entre ces élèves, d'ailleurs très peu nombreux, les mêmes liens de camaraderie à l'Ecole des Mines qu'à l'Ecole polytechnique.
Avec l'introduction des élèves externes, nettement consacrée par l'ordonnance de 1816, la composition des promotions s'est modifiée, mais beaucoup moins rapidement que ne pourrait le faire croire la comparaison dans nos annuaires du nombre des élèves ingénieurs et des élèves externes, parce que dans ceux-ci la proportion des polytechniciens a toujours été très considérable pendant tout le XIXe siècle (c'est ainsi que dans la promotion 1879, à laquelle nous avons appartenu, les polytechniciens formaient la majorité des 26 élèves qu'elle comprenait et où ne figuraient que 3 élèves-ingénieurs). Il en résulte que, tout en étant très cordiaux sans doute, les rapports entre les polytechniciens et leurs camarades venant des cours préparatoires, avaient plutôt le caractère de relations « mondaines ». Les courses géologiques, où le joyeux entrain de la vie en commun resserrait forcément ces liens, étaient la seule occasion d'un rapprochement semblable à celui d'un internat; mais elles étaient trop courtes pour faire tomber le « vous » cérémonieux alors en usage, pour le remplacer par le tutoiement qu'impose une fraternelle camaraderie. Il faut aussi reconnaître que la très grande différence qui existait alors entre la difficulté des examens d'entrée à l'Ecole polytechnique et la facilité de l'admission à l'Ecole des Mines (ce n'est que vers la fin du XIXe siècle que le nombre des candidats à l'Ecole des Mines a franchement dépassé celui des élèves pouvant y être admis) permettait aux polytechniciens de s'attribuer une certaine supériorité scientifique sur leurs camarades n'ayant subi, pour entrer à l'Ecole, que des examens oraux relativement faciles, en raison du petit nombre des candidats.
C'est l'augmentation croissante de ceux-ci qui a fini par rendre « homogène » la valeur des élèves de notre Ecole, et permis l'avènement progressif d'une très franche camaraderie qui, actuellement, n'est égalée, croyons-nous, dans aucune autre école. Les candidats au concours d'entrée à l'Ecole des Mines, dont le nombre ne dépassait guère une cinquantaine il y a soixante ans, s'est en effet élevé peu à peu à une centaine en 1900 pour atteindre plus de deux cents en 1914 et quatre à cinq cents aujourd'hui, alors que le nombre des admis est sensiblement le même qu'avant la guerre. Il a donc fallu, dès 1903, régler les examens d'admission à l'Ecole des Mines comme ceux de l'entrée à l'Ecole polytechnique et sur le même programme. En raison du nombre des candidats, il arrive chaque année qu'après le dernier admis à l'Ecole des Mines, un certain nombre de candidats éliminés sont reçus à l'Ecole polytechnique : cette « péréquation » de tous les élèves titulaires de l'Ecole des Mines devait forcément entraîner entre eux la plus cordiale des camaraderies, et c'est ainsi que le tutoiement général est de règle à l'Ecole depuis la promotion 1904.
La même cause a produit le même résultat pour les élèves étrangers. Il y a peu d'années encore, ceux-ci étaient admis - d'ailleurs très largement - à la suite d'un examen ayant simplement pour but de constater qu'ils seraient « aptes à suivre les cours », mais depuis 1911, ils ne sont plus reçus qu'en subissant un concours identique à celui des candidats français, et leur nombre croissant a rendu ce concours assez difficile pour que la valeur scientifique des élèves étrangers admis soit comparable à celle des élèves français : dès lors, la fusion entre élèves français et étrangers est devenue complète. Elle l'est même à tel point que, à plusieurs reprises, les élèves français nous ont proposé spontanément d'attribuer à des camarades étrangers peu fortunés des subsides pris sur un crédit réservé en principe aux élèves français.
Cette communauté de préparation scientifique a été, croyons-nous, la principale cause de la fusion complète des divers éléments qui constituent nos promotions, fusion exprimée d'une façon touchante par un candidat admis au concours de mars 1918 et écrivant à son père avant de partir pour le front : « J'ai la joie de vous annoncer ma réception à l'Ecole des Mines : c'est une grande famille où l'on travaille... » Mais l'organisation des études à l'Ecole et la façon dont les élèves ont réglé leurs rapports entre eux, ont également contribué dans une large part à renforcer cette camaraderie et à créer entre eux une solidarité, une sorte « d'esprit de corps » dont ils sont très fiers, et certes avec raison.
Voyons d'abord le rôle de l'Ecole dans cette heureuse évolution. Les nouveaux laboratoires, constitués depuis que l'Ecole a été investie de la personnalité civile, rapprochent constamment les élèves les uns des autres, beaucoup plus que les salles de dessin et les laboratoires de chimie, qui existaient seuls autrefois, et où chaque élève travaillait isolément pour son propre compte. Les nouveaux laboratoires de mécanique, de physique, d'électricité, de chimie industrielle et de métallurgie comportent tous en effet des appareils complexes, souvent très volumineux, dont le fonctionnement doit être étudié par un groupe d'élèves travaillant ensemble. Ils apprennent ainsi en même temps, et sans s'en douter, à bien se connaître, à apprécier leurs qualités réciproques, à découvrir chez leurs voisins, qu'ils soient riches ou pauvres, des valeurs qu'ils ne soupçonnaient pas. Il se crée ainsi des amitiés solides et durables entre élèves appartenant aux classes les plus distantes de la société, et qui, plus tard, trouveront tout naturel d'être réunis dans le même Conseil d'administration d'une grande industrie, l'un comme Président, l'autre comme Directeur général.
Il y a quelque trente ans, le Conseil de l'Ecole s'est avisé qu'un lieu de réunion permanent pour les élèves, aux heures où ils ne sont pris ni par les cours, ni par les exercices pratiques, ne pourrait que resserrer entre eux des liens de camaraderie si profitables à tous dans leurs carrières futures : c'est ainsi que fut fondé le « Cercle » des élèves dans un local situé dans le bâtiment des laboratoires, local fort bien décoré et qui n'est autre que l'ancien cabinet de travail de l'architecte de l'Ecole. Les élèves y sont tout à fait « chez eux », et pendant qu'ils jouent au bridge ou aux échecs, ils peuvent s'y faire servir le thé par un gardien de laboratoire. Surtout commode pour les élèves dont les familles habitent la province, ce cercle sert parfois le soir à des réunions pour des conférences faites par des professeurs ou d'anciens élèves de l'Ecole. Plusieurs de ces conférences sont demeurées célèbres, et c'est un de nos meilleurs souvenirs d'avoir entendu Alfred Capus, ancien élève de l'Ecole des Mines, membre de l'Académie française, nous raconter que, malgré les sages conseils d'une tante vénérée qui le destinait à une carrière « sérieuse », il avait « mal tourné » en lâchant l'Ecole pour le journalisme, et même la littérature. Il est amusant de constater que le prédecesseur de Alfred Capus sur le siège 24 fut Henri Poincaré, un autre grand ancien de l'Ecole.
En dehors de leur cercle, qui contribue beaucoup à leur rapprochement, nos jeunes camarades ont élargi grandement le cadre de leurs réunions en y introduisant l'élément « mondain » par de fréquents « rallyes » où sont conviées leurs familles, ainsi que par des bals et des revues où sont invités les anciens élèves, et qui sont devenus des événements « très parisiens ». On peut évidemment regretter que le travail scolaire de nombre d'élèves souffre quelque peu de ces festivités qui exigent une longue préparation de la part des élèves exécutant la partie musicale des rallyes, ou formant la troupe théâtrale des revues. Mais nous croyons pour notre part qu'il est bon d'entretenir dans une jeunesse, au fond très studieuse, un courant de gaîté et de bonne humeur qui les suivra dans la vie, et les aidera à supporter sans se plaindre les « coups de chien » surgissant parfois du fond de la mine, ou du gueulard des hauts-fourneaux. Et puis ces distractions mondaines ont un effet excellent: elles débarrassent de la « peau d'ours du taupin » dont la plupart de nos jeunes camarades sont revêtus en sortant du lycée pour entrer à l'Ecole, et elles achèvent, ou même quelquefois forment complètement leur éducation sociale.
II y a quelques années, à la séance de réception de la nouvelle promotion par leurs anciens, nous entendions le délégué de ceux-ci dire aux nouveaux : « Ici, nous sommes des gens polis; à vous de le devenir. » Le conseil porte, car il est incontestable qu'en très peu de temps les conscrits prennent le pli de leurs anciens, et, quand les promotions sont réunies, on est frappé de leur « air de famille », qui est par surcroît un « air de bon ton ».
Cette intimité vraiment familiale de nos élèves a introduit peu à peu chez eux des coutumes « d'entr'aide » tout à fait touchantes. Il fallait pour cela un organisme bien au courant de la situation de chaque camarade, et dans lequel tous les élèves aient pleine confiance : c'est ce qu'a réalisé la création de la Commission des élèves. Pendant plus d'un siècle, à dater de la fondation de l'Ecole, le chef incontesté des promotions à l'intérieur de l'Ecole ou dans les courses géologiques était le major des élèves-ingénieurs de la promotion la plus ancienne. L'accroissement progressif du nombre des élèves externes entrés au concours, finissant par dépasser largement celui des polytechniciens, amena d'abord les élèves externes à se faire représenter auprès de la Direction par un camarade élu qui était en même temps leur « délégué » auprès de l'Association des anciens élèves de l'Ecole. Mais la nécessité pour chaque promotion d'avoir au moins un porte-parole se faisait de plus en plus sentir, à mesure que croissait le nombre des élèves, et c'est ainsi qu'à partir de 1905, les élèves constituèrent une Commission où toutes les promotions étaient représentées et qui avait mandat de s'occuper des intérêts communs des élèves. Cette petite assemblée, dont la présidence fut confiée au « délégué » , rencontra, le meilleur accueil auprès de la Direction, qui lui offrit une salle de réunion, une table et un tapis vert - consécration officielle de toute Commission - en l'autorisant en même temps à percevoir des cotisations parmi les élèves pour faire face aux dépenses d'intérêt général.
L'activité de la Commission, d'un caractère plutôt intellectuel, pendant plusieurs années, s'est tournée peu à peu vers des oeuvres sociales qui ont pris dans ces derniers temps un essor remarquable, et rendent d'inappréciables services aux élèves peu fortunés dont la proportion s'est fortement augmentée depuis la guerre. Cet accroissement est en rapport avec celui des bourses complètes d'internat dans les lycées et collèges, grâce auxquelles des jeunes gens dénués de ressources ont pu, par leur intelligence et leur travail arriver au seuil de l'Ecole, sans avoir besoin de recourir à des subventions extérieures que leurs familles auraient été incapables de leur fournir. Une fois entrés à l'Ecole et privés de leurs bourses universitaires, ces élèves sont dans un embarras cruel pour boucler leur budget. Tout ce que l'Ecole peut faire pour eux, c'est de les exonérer des frais de scolarité, sous forme de prêts d'honneur, remboursables dans un délai de dix ans à dater de leur sortie de l'Ecole, et de partager entre les plus dénués de ressources un crédit, hélas ! bien maigre encore, ouvert sur le budget de l'Ecole (il existe en outre quelques bourses de 1.200 francs provenant soit de fondations (bourses Rivot), soit de subventions de grandes sociétés industrielles). Mais tout cela ne fait pas vivre des jeunes gens dont presque tout le temps est pris par leurs études à l'Ecole. Personne, dira-t-on, ne les obligeait à entrer à l'Ecole des Mines, et ils ont commis une dangereuse imprudence en le faisant. La vérité est qu'à la sortie de spéciales on ne choisit pas toujours; on va où l'on peut, et non où l'on veut. Toujours est-il qu'il y a des camarades - et ils sont nombreux - qui doivent se créer des ressources par eux-mêmes. On n'imagine pas l'ingéniosité en même temps que le courage qu'ont déployés beaucoup d'entre eux pour assurer leur vie matérielle par des travaux en dehors de l'Ecole : surveillance de nuit dans les lycées ou les pensions privées, répétitions, leçons de musique, parfois même de gymnastique, travail de nuit dans nombre d'industries, etc.. Nous pouvons encore citer le cas d'un élève - grand industriel aujourd'hui - arrivant à Paris pour entrer à l'Ecole et absolument dénué de ressources, qui s'est assuré le jour même un logement « gratis » chez une vieille commerçante, totalement illettrée, en lui proposant de tenir sa comptabilité. L'année suivante, il se tirait complètement d'affaire en donnant des leçons de science.
Mais il y avait encore bien des mécomptes et des incertitudes dans les démarches à faire pour se procurer de pareilles ressources, et c'est à quoi a remédié le Comité d'entr'aide, fondé il y a deux ans par la Commission des élèves, en créant une organisation méthodique de travaux d'enseignement libre.
Ce comité s'est efforcé de susciter et de centraliser des offres de répétitions, interrogations, corrections de copie, etc., de la part des institutions privées et des particuliers. Le sérieux, la compétence et la ponctualité de nos jeunes camarades ont fait la meilleure impression, leur réputation s'est rapidement répandue dans les établissements libres de la région parisienne, et les demandes de leçons particulières ont été adressées de plus en plus nombreuses au Comité d'entr'aide par divers organismes ayant pour but de renseigner les parents d'écoliers ou d'étudiants et auxquels le Comité envoie des adhérents en échange. C'est ainsi que, grâce au prestige bien mérité de nos élèves, 60.000 francs de travail ont été répartis entre ceux-ci dès la seconde année du fonctionnement du Comité d'entr'aide, et tel de nos jeunes camarades est arrivé à gagner 600 francs par mois, avec 6 heures de travail par semaine. « Pour en arriver là », nous a dit un des organisateurs de cette oeuvre si intéressante et si utile, « il a souvent fallu que nos camarades fassent preuve d'un véritable dévouement. J'ai vu des élèves fort riches perdre trois heures pour aller faire passer en banlieue des colles d'espagnol que personne ne pouvait assurer à leur place, faute de connaissance de la langue, et tout cela pour nous concilier les bonnes grâces de collèges qui nous avaient demandé ce service. D'ailleurs, jamais de récriminations, jamais de camarades mécontents de ce qu'ils obtenaient par rapport aux autres. Le Comité a eu la tâche facile, grâce à la confiance de tous en l'oeuvre commune. »
L'Ecole des Mines est donc, comme on le voit, non seulement une « grande famille » où l'on travaille pour son propre compte, mais où chacun s'efforce de travailler pour le bien-être des camarades les moins favorisés de la fortune: peut-on mieux se préparer aux devoirs de solidarité sociale qui s'imposent à tous les degrés dans les industries auxquelles se préparent nos jeunes camarades?
Nos élèves sont d'ailleurs fortement encouragés et matériellement aidés dans cette voie par l'Association amicale des élèves de l'Ecole nationale supérieure des Mines, fondée en 1864 et déclarée d'utilité publique en 1881. Cette Association subventionne généreusement la caisse des élèves, et participe ainsi largement à l'aide que cette caisse apporte aux camarades dont le trop maigre budget se dérobe aux frais des voyages d'étude, si coûteux aujourd'hui. Et, bien que ce sujet sorte du cadre de la vie à l'Ecole, nous ne pouvons passer sous silence les services incalculables que rend à nos élèves le secrétaire général de l'Association, M. Henri Chapot, en consacrant depuis un quart de siècle, et avec quel succès ! le meilleur de son infatigable activité au placement de nos élèves dans l'industrie, après leur sortie de l'Ecole.
Une dernière amélioration, et non des moindres, va bientôt se produire dans la vie matérielle de nos jeunes camarades. Une Maison des Mines va être édifiée à proximité de l'Ecole, dans la partie élargie de la rue Saint-Jacques, à l'angle de la rue des Feuillantines, et ses dimensions lui permettront de loger dans d'excellentes conditions plus d'une centaine d'élèves. L'exemple de la Cité Universitaire et de la Maison des Elèves de l'Ecole Centrale nous incitait depuis longtemps à créer à notre tour une maison destinée à recevoir à bon compte nos élèves dépourvus de ressources, et à les aider ainsi grandement à surmonter les difficultés que dresse devant eux la cherté croissante de la vie matérielle. Ces difficultés sont telles aujourd'hui qu'elles risquent de tarir un recrutement d'élèves particulièrement intéressant, celui des jeunes gens peu fortunés dont les parents habitent la province, et qui ont ainsi à supporter à eux seuls toutes les charges de leur existence à Paris. Mais pour bâtir cette maison, il fallait avant tout trouver un terrain très voisin de l'Ecole, car l'intervalle entre les cours du matin et les exercices pratiques de l'après-midi ne permet pas d'ajouter au temps du déjeuner plus d'un quart d'heure de marche, et c'est pourquoi nous devions, comme l'Ecole Centrale, renoncer à installer notre future Maison des Mines dans la Cité Universitaire. L'élargissement de la rue Saint-Jacques, décidé par la Ville de Paris, nous a permis fort heureusement de trouver à ce problème une solution excellente, en rendant disponible le terrain occupé par plusieurs maisons à démolir pour cette amélioration urbaine. La création de la Maison des Mines a été alors décidée avec enthousiasme dans une réunion d'anciens élèves de l'Ecole : il n'y avait donc plus qu'à réunir les fonds nécessaires pour en entreprendre la construction.
La Commission Générale des Ecoles du Comité central des Houillères et du Comité des Forges de France a pris l'initiative de la souscription par un versement de 500.000 francs, permettant d'assurer la création de la Société qui sera propriétaire de la maison. La générosité des anciens élèves de l'Ecole et des grands établissements industriels ou financiers s'intéressant à la formation des ingénieurs qu'elle forme, a très rapidement fourni l'appoint des cinq millions nécessaires à la construction envisagée : elle vient d'être commencée en juillet 1931 et l'on peut espérer, grâce à la compétence et à l'activité de notre architecte (M. Leprince-Ringuet, le constructeur des maisons de l'Ecole Centrale), qu'elle sera inaugurée à la rentrée de 1932. En raison de ses vastes dimensions (112 chambres d'élèves), notre maison pourra recevoir non seulement ceux de l'Ecole des Mines, mais encore un certain nombre d'élèves des écoles des Ponts-et-Chaussées, du Génie maritime et des Poudres, qui suivent certains cours ou exercices pratiques de l'Ecole des Mines, et que nos élèves considèrent ainsi à juste titre comme des camarades d'écoles « soeurs ». De plus, les réfectoires prévus seront assez vastes pour que tous les élèves de notre Ecole, qu'ils soient ou non logés dans la Maison des Mines, puissent y prendre tous ensemble leurs repas, ce à quoi ils tiennent beaucoup « par esprit de famille ».
 | Remise de la Légion d'Honneur à l'Ecole par le Président Albert Lebrun (29 juin 1933) |
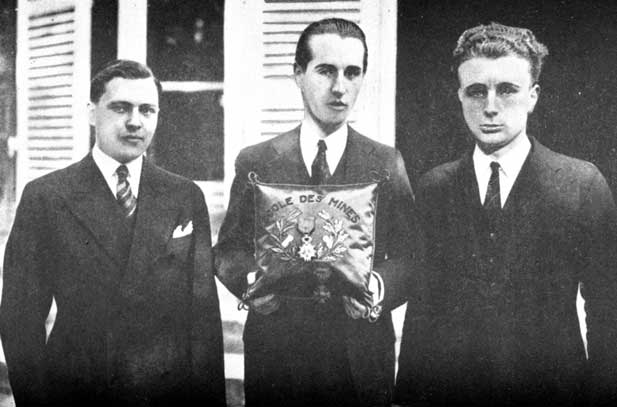
Le rôle de l'Ecole des Mines dans la science et l'industrie a été considérable dans le passé, et certes il ne l'est pas moins dans le présent.
Et d'abord, le passé. Depuis l'origine lointaine de notre Ecole, combien de camarades illustres ont fait rayonner son enseignement dans les plus hautes sphères de la science et dans les branches les plus variées de l'industrie! Nous, les anciens, nous avons tous le souvenir de leurs noms, mais si ce petit livre tombe sous les yeux des jeunes, il n'est pas bien sûr, sinon qu'ils les connaissent, du moins qu'ils fassent sortir de l'Ecole des Mines un Henri Poincaré ou un Frédéric Le Play, dont la gloire mondiale efface le souvenir de leurs études scolaires. Et pourtant, celles-ci ont précédé et peut-être même suscité dans leur subconscient l'envolée de leur génie créateur : il n'est donc pas interdit de rappeler ici quelles ont été les plus pures gloires de notre « Alma mater ».
Parmi celles-ci figurent des savants illustres, comptant parmi les plus grands de notre époque; comme mathématiciens : Joseph Bertrand, Résal, Camille Jordan, Henri Poincaré, Georges Humbert; comme physiciens : Regnault, Cornu, Potier, Râteau; comme astronomes : Delaunay et Paye. Mais leur formation scientifique les rattache plutôt à l'Ecole polytechnique qu'à l'Ecole des Mines, et nous nous contenterons de les avoir cités ici, pour nous attacher plus spécialement à ceux d'entre nos professeurs ou camarades les plus célèbres par des travaux en rapport direct avec l'enseignement technique de notre école : minéralogie et géologie, exploitation des mines, métallurgie, chimie, chemins de fer, économie politique.
C'est dans notre Ecole qu'a été fondée la minéralogie réellement scientifique, par son premier professeur à l'Ecole de Mouchy, l'abbé Haüy, le créateur de la cristallographie. En découvrant que la forme élémentaire des minéraux dépend surtout de leur composition chimique, et que les formes si variées qu'ils peuvent prendre résultent d'un empilage régulier des cristaux primitifs, Haüy a fait sortir la minéralogie du domaine purement descriptif où elle végétait, et en a fait un des plus beaux chapitres de la physique moderne (en raison de son caractère ecclésiastique, Haüy n'a pu être nommé inspecteur des Mines, comme l'avait été son collègue Vauquelin, mais le Conseil des Mines se l'était attaché pour former la collection des minéraux de l'Ecole des Mines et il faisait ainsi partie du Service des Mines). Ses successeurs dans la chaire de minéralogie de l'Ecole des Mines, les Dufrénoy, les de Senarmont, les Daubrée et les Mallard, pour ne citer que les disparus, ont admirablement continué son oeuvre, et notre Ecole a ainsi le grand honneur d'avoir été et d'être encore le flambeau lumineux de cette science admirable.
Le rôle des Ingénieurs de notre Ecole n'a pas été moindre dans la géologie dont l'origine, en tant que science nettement distincte de la « géographie physique », remonte, comme nous l'avons déjà vu, au « Traité des roches » publié en l'an XI par le jeune professeur de l'école de Moutiers, Brochant de Villiers. C'est à l'instigation de celui-ci, devenu professeur de minéralogie et de géologie à l'Ecole des Mines de Paris, que ses deux élèves, Dufrénoy et Elie de Beaumont, furent chargés, en 1823, de dresser, sous sa direction, la carte géologique de la France, et l'on peut dire que c'est ce monument géologique, fruit de leur collaboration, qui constitue vraiment les titres de noblesse de cette science nouvelle. Les magnifiques travaux de Marcel Bertrand et de Pierre Termier, l' « éloquent poète » de la terre, dignes successeurs d'Elie de Beaumont dans la chaire de géologie de l'Ecole des Mines, et les belles études de notre camarade Albert de Lapparent à l'Institut catholique, ont singulièrement élargi les conceptions de leurs illustres devanciers, en complétant ce qu'on peut appeler la « statique » du globe terrestre, par la « dynamique » de ses strates, qui a façonné le « visage de la terre » et le modifie perpétuellement.
Moindre sans doute qu'en géologie, la contribution de nos ingénieurs à la création de la paléontologie (fille tardive de la géologie dont elle n'a été séparée comme cours qu'on 1845), n'en a pas moins été très considérable. Le premier titulaire de cette chaire qu'il a occupée pendant 36 ans, Emile Bayle, a fait de la collection de paléontologie de notre Ecole « un rare monument pour la science, tant par les séries qu'il a su y réunir que par les préparations dont il l'a dotée, et cela grâce à un labeur constant où il alliait une science incontestée à une patience et une habileté de main incomparable » (L. Aguillon). Plus tard, l'Inspecteur général des Mines Zeiller créateur avec Grand'Eury (de l'Ecole des Mines de Saint-Etienne) de la « Paléontologie végétale », a introduit en 1878 cette science nouvelle dans notre enseignement, et complété par de magnifiques spécimens de végétaux fossiles, notre collection de paléontologie, encore accrue et admirablement classée par le successeur de Bayle, M. l'Inspecteur général Douvillé.
Avec ces trois sciences naturelles qui forment le bréviaire du prospecteur, l'exploitation des mines, la métallurgie et la chimie analytique minérale ou docimasie, constituent l'armature de la technique de l'Ingénieur des Mines, et là encore le rôle de notre Ecole a été de premier ordre.
Si pour l'exploitation des mines la France a été devancée jusqu'au XIXe siècle par l'Allemagne et l'Angleterre, en raison du nombre et de l'importance des gisements miniers plus considérables chez celles-ci que dans notre pays, la valeur exceptionnelle de nos professeurs, dès les premières années du fonctionnement, de notre Ecole nous a fait regagner bien vite ce retard. Les cours d'exploitation de Duhamel père, aux Ecoles de la Monnaie et de la Convention, puis de Baillet du Belloy à l'Hôtel de Mouchy, à Moutiers et à l'Hôtel de Vendôme, où il a professé jusqu'en 1832, ont formé des lignées d'ingénieurs de tout premier ordre aussi bien comme exploitants ou prospecteurs que comme fonctionnaires du service des Mines, tels que Beaunier, de Gargan, Juncker et Combes, lequel, après avoir formulé comme ingénieur ordinaire les premières règles de l'aérage des mines, devait succéder à Baillet du Belloy dans la chaire d'exploitation, et l'illustrer par la publication de son célèbre et grand « Traité d'Exploitation », qui a fait époque dès son apparition et dont l'autorité a persisté pendant bien des années. Les successeurs de Combes dans la chaire d'exploitation, Callon, puis Haton de la Goupillière n'ont pas eu un rôle moindre dans la formation des exploitants de mines sortis de notre Ecole; leur nombre dépasse toute énumération et je me contenterai d'en citer un seul à titre d'exemple, estimé et admiré de tous : Elie Reumaux, directeur général des Mines de Lens, type accompli de la compétence et de l'honneur professionnels.
L'étude des mesures de sécurité dans les mines de houille se rattache étroitement à notre Ecole par les « Commissions du grisou » dont les travaux ont été exécutés par les professeurs ou les ingénieurs de notre Ecole, et nous ne pouvons les passer ici sous silence.
C'est à la suite d'une série de catastrophes particulièrement douloureuses que fut constituée, par la loi du 26 mars 1877, la première Commission du grisou, avant-garde de toutes les autres commissions similaires établies à l'étranger. Les travaux de la première Commission, clos en 1881, furent repris en 1887 par une seconde Commission instituée d'abord pour l'étude des explosifs, puis transformée en 1890, cette fois d'une façon définitive, en « Commission permanente des recherches scientifiques sur le grisou et les explosifs employés dans les Mines ». C'est au cours des travaux de la première Commission, qu'ont été mis en lumière par Mallard et H. Le Châtelier, les propriétés spéciales du grisou et les conditions, encore mal connues à cette époque, de son inflammation; à eux revient le mérite de la découverte du retard à l'inflammation du grisou, atteignant plusieurs secondes à 650° et diminuant progressivement avec la température pour ne s'annuler complètement qu'à quelques milliers de degrés - propriété qui explique le rôle protecteur contre le grisou des tamis métalliques dans les lampes de sûreté constituées par Davy en 1813, et qui a permis bientôt aux mêmes ingénieurs de concevoir la possibilité d'obtenir des explosifs n'enflammant pas le grisou grâce à leur basse température de détonation et à la rapidité de celle-ci. Les travaux de la seconde Commission du grisou ont tout d'abord consacré cette conception par l'établissement des explosifs de sûreté, puis ont porté sur l'étude des lampes, dont seuls ont été désormais autorisés dans les mines grisouteuses, les types résistant aux courants d'air explosifs de grande vitesse. Elle s'est ensuite occupée de l'organisation de la grisoumétrie dans les houillères et a indiqué dans ce but l'emploi de divers appareils construits par la sous-Commission d'expériences de la Commission (cette sous-commission se composait de E. Mallard, H. Le Châtelier et G. Chesneau. Les appareils grisoumétriques établis par elle et encore usités dans les mines grisouteuses sont : la lampe grisoumétrique Chesneau, l'appareil Coquillon-Le Châtelier, et la burette Le Châtelier à limite d'inflammabilité) : lampe de sûreté grisoumétrique pouvant être introduite dans les galeries et chantiers et indiquant la présence du grisou à partir de très faibles teneurs inexplosibles, appareils très simples pour l'analyse de l'air des mines dans les laboratoires.
Le danger des poussières charbonneuses encore controversé et mal élucidé jusqu'en 1906, a été remis en question d'une façon tragique par la catastrophe de Courrières, due cette fois, sans aucune incertitude, aux poussières seules, l'absence du grisou ayant été constatée avec la lampe grisoumétrique, très peu de temps avant l'accident. Toutes les expériences de la Commission avaient pu être faites jusqu'alors dans les laboratoires de l'Ecole des Mines; il n'en pouvait être de même pour l'étude des poussières qui exige des installations considérables et très coûteuses à proximité de mines de houille. Grâce à la coopération financière et morale du Comité Central des Houillères de France, une grande station d'essais, conçue d'après un programme dressé par la Commission du Grisou, a pu être installée et fonctionner dès 1908 sur les mines de Liévin. On sait quels importants résultats scientifiques et pratiques ont été obtenus dans cette station par son directeur, l'ingénieur des Mines Taffanel. La barbarie aveugle et jalouse de nos ennemis leur a fait détruire de fond en comble, en 1914, cette belle installation, édifiée uniquement pour le bien de l'humanité. Les conclusions de M. Taffanel étaient heureusement traduites, dès avant la guerre, en dispositifs susceptibles d'empêcher la propagation des explosions de poussière : la schistification des galeries et les arrêts-barrages.
Tous les problèmes que soulève l'emploi des explosifs dans les mines grisouteuses n'étaient cependant pas encore élucidés complètement par les travaux de la station de Liévin. Aussi, après la guerre, le Comité Central des Houillères a-t-il résolu de reconstituer à Montlucon une station d'essais permettant de reprendre l'étude des questions restées obscures en 1914, et deux jeunes ingénieurs du corps des Mines, M. Audibert et son collaborateur, M. Delmas, y continuent avec le plus grand talent les traditions de leur prédécesseur à Liévin, M. Taffanel.
On voit par ce rapide exposé le rôle très important des ingénieurs des Mines de notre Ecole dans cette lutte contre les dangers inhérents aux mines de charbon. Nos ingénieurs ont été bien souvent des précurseurs dans cette lutte, car leurs travaux ont été pour la plupart l'origine des études entreprises à l'étranger dans le même but. Il est juste aussi de rendre hommage au concours si dévoué et extrêmement utile qu'ont donné à la Commission du grisou les exploitants de mines, en mettant à l'essai dans leurs travaux les appareils et les dispositifs proposés par la Commission.
Dans les industries métallurgiques, plusieurs de nos professeurs, bien que n'ayant pas dirigé personnellement des établissements métallurgiques, ont cependant contribué fortement aux progrès de la sidérurgie par leurs observations et leur enseignement. C'est ainsi que deux des professeurs de docimasie, Berthier et Ebelmen, grâce aux déductions qu'ils avaient tirées de leurs analyses de métaux, ont été pour les métallurgistes des guides précieux pour l'amélioration de leurs procédés. Tel est aussi le cas de Louis Gruner, qui tout en professant la métallurgie dans notre école de 1858 à 1872, a contribué dans une large mesure aux améliorations et au développement de la sidérurgie moderne par ses études et ses publications sur l'affinage de la fonte et sur les hauts-fourneaux. C'est lui qui, dès 1867, a indiqué la possibilité de débarrasser les fontes du phosphore qui nuit à la qualité du fer qu'on en retire, au moyen de scories basiques, et qui, en 1875, signalait le premier l'emploi dans ce but de la dolomie, point de départ, trois ans après, du procédé Thomas et Gilchrist. La métallurgie du plomb et celle du cuivre ont également bénéficié des indications données par L. Gruner dans ses publications. Nos professeurs actuels n'ont pas cessé de mériter la reconnaissance des métallurgistes, et le nom d'H. Le Châtelier ne doit pas être moins honoré par eux que celui de ses illustres devanciers.
Nos ingénieurs entrés dans les industries métallurgiques ont eu également, comme praticiens, une part très grande dans les progrès de la sidérurgie. Tout en laissant à Louis Le Châtelier le mérite d'en avoir eu l'intuition première, il ne faut pas oublier que le four Martin a été réalisé par l'un de nos camarades, Louis Martin (promotion 1856), qui, le premier, avec l'aide de son fils, a fabriqué de l'acier fondu sur sole et dont le nom est resté attaché à cette invention d'importance encore fondamentale dans l'industrie sidérurgique actuelle. [Note de R. Mahl : Ce point suscite une certaine confusion de la part des historiens, la plupart des témoignages de l'époque attribuent la paternité du nom du four Martin à Pierre Martin (promotion 1844)]
L'analyse chimique des produits minéraux ou « docimasie », si nécessaire aux mineurs et aux métallurgistes, a été de tout temps l'une des sciences aux progrès de laquelle nos professeurs ont le plus contribué. Quand on étudie les mémoires du professeur de docimasie à l'Ecole de la Convention, l'Inspecteur des Mines Vauquelin, et qu'on les compare à ceux des chimistes français et étrangers de son temps, ou qui l'ont précédé de quelques années, on constate qu'il a été vraiment le créateur de la science qu'il professait. Ses nombreuses analyses de minéraux et de minerais parues dans le Journal des Mines, qui publiait en même temps celles de son émule allemand, le chimiste Klaproth, montrent que Vauquelin s'est préoccupé le premier de déterminer tous les éléments du corps étudié et de « fermer son analyse à cent pour cent » suivant notre expression actuelle. Quand il n'y arrive pas en raison de l'insuffisance des moyens d'analyse de cette époque, il discute soigneusement les raisons de cet échec et ses prévisions dénotent une intuition remarquable de la chimie future. Ses résultats sont d'ailleurs en général très exacts, et toutes les critiques que lui suggèrent les analyses des chimistes étrangers, notamment celles du célèbre savant suédois Bergmann, sont fondées de tous points. Son collègue Haüy a certainement trouvé dans les analyses de gemmes et de minéraux effectuées par Vauquelin, une aide précieuse pour établir ses théories nouvelles de cristallographie, dans lesquelles la composition chimique des substances joue un si grand rôle.
La plupart des successeurs de Vauquelin dans la chaire de docimasie : Berthier, Ebelmen, Rivot, A. Carnot, ont brillamment continué et parachevé son oeuvre. Il n'est certainement pas de centre scientifique dont l'enseignement ait formé plus d'analystes « minéraux » et de plus habiles que l'Ecole des Mines, et ce n'est pas sans raison que nos plus grandes industries chimiques ont actuellement à leur tête d'anciens élèves de notre Ecole, qui ont également bénéficié du précieux enseignement de la Chimie industrielle inauguré en 1888 par H. Le Châtelier.
Les chemins de fer, bien que moins directement rattachés à l'Art des Mines que les industries ou les sciences précédentes, ont, depuis leur origine en France, eu recours à la compétence et à l'activité de nos ingénieurs, et dès 1846, un cours de chemins de fer a figuré dans l'enseignement de l'Ecole. C'est d'ailleurs à l'un de nos ingénieurs, Beaunier, qu'est due la construction du premier de nos chemins de fer, celui d'Andrézieux à Saint-Etienne, livré au public en août 1827. Bien des nôtres, soit comme professeurs, soit comme exploitants, se sont illustrés par la suite dans cet important domaine de nos industries nationales : Charles Couche et Jean Vicaire comme professeurs, Clapeyron, Clément Sauvage, Louis Le Châtelier, Noblemaire, E. Heurteau et tant d'autres, comme exploitants.
Nous arrivons enfin à l'économie politique. Cete science, si en honneur aujourd'hui, présente pour nous, mineurs, cette singulière et glorieuse particularité que le développement, dans le cours du XIXe siècle, des idées premières de ses fondateurs Adam Smith, Ricardo et J. B. Say, est dû en très grande partie à trois ingénieurs des Mines, camarades d'Ecole: Michel Chevalier (promotion 1825), Jean Reynaud (1826) et Frédéric Le Play (1827). A cette époque, le « romantisme », en rupture avec toutes les règles du passé, bouillonnait dans tous les esprits et suscitait des préoccupations et des rêves restés en sommeil pendant les guerres napoléoniennes. Les doctrines de Saint-Simon mettaient en effervescence tous les jeunes polytechniciens dont un grand nombre emboîtaient le pas derrière les grands prophètes du Saint-Simonisme : le carbonaro Bazar et le « père » Enfantin, entré à l'Ecole polytechnique en 1813, et sorti démissionnaire le 1er août 1814. Au moment où nos trois jeunes camarades entraient à l'Ecole des Mines, Enfantin commençait à publier un périodique Le Producteur, avec cette épitaphe : L'âge d'or, qu'une tradition a placée jusqu'ici dans le passé, est devant nous. On conçoit que la jeunesse d'alors, enthousiasmée par de telles prémisses, n'ait plus rêvé que le bonheur de l'humanité et se soit lancée à corps perdu dans le mouvement créé par le Saint-Simonisme. Michel Chevalier et Jean Reynaud, après leur sortie de l'Ecole des Mines, firent même partie de l'Ecole de Saint-Simon, mais fort heureusement s'en retirèrent quand cette école devint une église, avec un rituel dont ils ne se souciaient pas, et pour cause. Pendant leur séjour à l'Ecole des Mines, Jean Reynaud et Leplay, amis inséparables, avaient fait un voyage de mission en Allemagne, dans lequel ils s'étaient assigné pour but de combiner l'étude du métier d'ingénieur avec « la solution de la question sociale » : ils ne parvinrent sans doute pas à la résoudre en trois mois, mais les observations qu'ils firent au cours de leur voyage les orientèrent définitivement, Jean Reynaud vers le côté administratif et financier, Frédéric Le Play vers le côté social des études économiques, tandis que d'autre part Michel Chevalier, d'esprit plus philosophique que ses deux conscrits, se consacrait à des études d'organisation rationnelle de l'industrie mondiale. Ce sont certainement les ouvrages de ces trois ingénieurs, publiés au cours du XIXe siècle, et les cours qu'ont professés Michel Chevalier au collège de France et J. Reynaud à l'Ecole des Mines, qui ont achevé l'évolution définitive de l'Economie politique générale et de l'Economie industrielle et sociale plus particulièrement adaptée aux buts que doivent poursuivre les Ingénieurs.
Nous ne pouvons clore cette revue de nos gloires scientifiques et industrielles, sans mentionner que l'Institut a compté ou compte encore 54 membres et 11 correspondants ayant appartenu au Corps ou à l'Ecole des Mines.
Il ne nous appartient pas de faire ici l'éloge personnel des ingénieurs qui, de nos jours, honorent le plus notre Ecole. Il nous suffira de dire, sans crainte d'être démenti, que le corps enseignant actuel de l'Ecole des Mines, ainsi que les Ingénieurs du Corps des Mines en activité de service, ont une valeur rarement égalée dans le passé, et que les Ingénieurs civils des Mines ou les Ingénieurs du Corps occupant des situations industrielles, forment dans le monde des Ingénieurs une élite qui perpétue la haute estime dont jouit dans le public le diplôme conféré par notre Ecole à ses élèves. Les nombreux postes de directeurs ou d'administrateurs qu'occupent nos camarades, aussi bien aujourd'hui qu'autrefois dans les mines, la métallurgie, les industries chimiques, les chemins de fer, etc., ainsi que les hautes situations professorales que détiennent plusieurs d'entre eux dans l'enseignement supérieur, nous permettent d'affirmer que, pour longtemps encore, le prestige de notre Ecole ne cessera de briller aussi bien dans les carrières scientifiques que dans le domaine industriel.
En sera-t-il toujours ainsi, du moins dans la science pure? Les difficultés croissantes de la vie matérielle depuis la grande guerre ont certainement influé sur l'état d'esprit des jeunes générations, et l'ont forcément orienté vers des préoccupations moins désintéressées que celles qui dominaient jadis. Comment donc peut se caractériser à cet égard l'état d'esprit des élèves actuels de notre Ecole? Nous ne pouvons faire mieux pour répondre à cette question que de citer la conclusion d'une conférence faite cette année, devant un auditoire sans attache avec notre Ecole, par un élève sur le point d'en sortir : « Le mineur de Paris, tel que le fait l'Ecole d'après-guerre, est épris de science, doué de sens social, animé de nobles ambitions et bien décidé à les satisfaire, mais ni par la violence, ni par la ruse, et uniquement par un travail patient et adroit. Il sait que pour réussir il lui faudra deux choses : la compétence et le sourire. »
Ce mélange charmant de douceur et de sérieux nous satisfait pleinement, et nous ne demandons rien de mieux, ni de plus, aux promotions futures, avec la certitude qu'elles ne seront pas moins soucieuses que les anciennes du bon renom de notre chère Ecole. C'est pourquoi après avoir fait revivre le passé dans ce petit livre avec la joie de fils qui sont fiers de leurs pères, nous pouvons aussi nous tourner vers l'avenir avec confiance et nous, les vieux, regarder les jeunes avec fierté; l'histoire de l'Ecole des Mines sera toujours une très belle histoire : ex proeterito spes in futurum.

Mis sur le web par R. Mahl